 Daniel Lagache. Le travail de deuil. Article parut dans la « Revue française de psychanalyse », (Paris), volume 16, n°4, 1938, pp., et tiré-à-part : Paris, Les éditions Denoël, 1939. 1 vol. in)8 ; 22 p., 1 fnch. Dans la « Bibliothèque de psychanalyse ».
Daniel Lagache. Le travail de deuil. Article parut dans la « Revue française de psychanalyse », (Paris), volume 16, n°4, 1938, pp., et tiré-à-part : Paris, Les éditions Denoël, 1939. 1 vol. in)8 ; 22 p., 1 fnch. Dans la « Bibliothèque de psychanalyse ».
Daniel Lagache (1903-1972). Philosophe de formation, psychiatre et psychanalyse, élève de Georges Dumas, puis de Henri Claude, il sera, avec Jacques Lacan, un des fondateurs de la Société française de psychanalyse, puis en 1954 le fondateur de l’Association psychanalytique de France ; il est bien connu pour avoir initié un classique de la psychanalyse, Le Vocabulaire de la Psychanalyse, rédigé par Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis en 1962. Quelques uns de ses travaux :
Les hallucinations verbales de ma parole. (Thèse de médecine). 1934.
La jalousie amoureuse. (Thèse de lettres). 1947.
L’unité de la psychologie : psychologie expéromentale et psychologie clinique.1949.
La psychanalyse. 1955.
Le psychologue et le criminel. 1979.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons corrigé les fautes de frappe. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription du tiré-à-part original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 7]
LE TRAVAIL DU DEUIL
Ethnologie et Psychanalyse
« Deuil », fait penser aux obligations que la société impose aux parents d’un mort pendant un temps plus ou moins long ; on oublie que par ses origines et par certaines survivances « deuil » désigne un phénomène psychologique de l’ordre de la douleur physique et morale.
L’insolite expression « travail du deuil » évoque l’idée d’un effort intense et ardu en vue d’un résultat à obtenir. Tel ne paraît pas le spectacle banal de là mort : n’est-ce pas précisément un « spectacle » auquel on « assiste », un événement auquel on se résigne ? Rien de tout cela ne suggère l’idée d’une activité, d’un travail. Il se peut cependant que cette banalité soit « banalisation », que cette résignation soit le fruit d’un travail souterrain de défense et d’adaptation. Il est en effet des formes pathologiques du deuil dans lesquelles il apparaît qu’un tel travail ne se fait pas ou qu’il se fait mal. L’existence d’un tel travail est aussi suggérée par les institutions du deuil dans les sociétés primitives. Ainsi l’étude du deuil dans son contenu psychologique ou dans les institutions sociales qui l’informent se trouverait ouvrir quelques perspectives sur le problème général de la fonction de la douleur.
La méthode comparative adoptée risque de soulever quelques objections de principes. Quelles relations, dira-t-on, peuvent exister entre les institutions du deuil dans les sociétés primitives et les faits que révèle l’exploration psychologique du deuil et de ses formes pathologiques ? Sans doute le chagrin peut accompagner le conformisme ; mais il peut y avoir chagrin sans conformisme, [p. 8] conformisme sans chagrin ; ainsi, chez les Trobriandais, le chagrin réel et discret des parents de sang s’oppose au conformisme bruyant des parents par alliance (Malinowski, la vie sexuelle des sauvages…. 153). On peut aller jusqu’à dire que le deuil accuse la distinction entre réactions psychologiques et conformismes sociaux.
Il y a là quelque exagération. On conformisme social a une signification, une origine, un retentissement psychologiques. Et il n’est pas de « psychologie individuelle » qui ne soit science de la vie de l’homme dans un monde et dans un monde social. Réaction psychologique et conformisme social, plutôt que des réalités opposées, apparaissent comme deux pôles d’une même réalité.
On ne saurait d’ailleurs faire du « deuil-douleur » une affaire exclusivement privée. Le deuil n’est vécu comme un chagrin que lorsque la mort a rompu une relation sociale particulièrement intense. Cette relation même, il est difficile de l’enfermer dans l’existence individuelle ; on y retrouve ce critère du social, que l’individu est « altéré » par ses relations avec un autre, que les phénomènes psychiques qui surviennent alors sont irréductibles à ceux d’ailleurs hypothétiques d’une existence psychique isolée. Rejeter hors du social les relations « privées » parce qu’elles ne mettent en jeu qu’un nombre d’hommes restreint revient à poser un problème analogue à celui du sorite : combien faut-il d’hommes pour qu’une relation interhumaine devienne sociale ? Qu’on· prenne garde que la « solitude vécue » n’a de sens que dans une société.
Le recours à la psychologie en profondeur et aux formes anormales du deuil requiert d’autres justifications. On ne comprend rien à ces problèmes sans le concept basal d’une réalité inter-humaine. Ce concept paraît bien correspondre à une réalité, dans les sociétés primitives : la vie émotionnelle, avec sa fonction socialisante, y prévaut sur la rationnelle ; plus aisément les réactions psychiques se projettent dans des croyances, s’expriment dans des rites et des cérémonies. Dans nos sociétés, la distinction du social et de l’individuel est beaucoup plus stricte ; une sorte de clivage y permet une séparation presque radicale du moi et du toi ; le positivisme y réduit la mort à une propriété de la vie. Aussi même devant la mort d’un être cher, la psychologie descriptive dépasse difficilement le plan d’un conflit entre la présence et l’absence, elle [p. 9] ne décèle guère plus que la persistance de l’image du mort « dans » la conscience des survivants ; et c’est peut-être parce qu’il y a un travail du deuil que la psychologie descriptive, au moins dans le cas du deuil normal, ne permet pas de pénétrer plus avant. Cette difficulté justifie la comparaison, aux institutions du deuil dans les, sociétés primitives, des données de la pathologie et de la psychanalyse du deuil. Etude ébauchée par Freud dans « Totem et tabou », mais d’une façon incomplète ; car il s’est borné à’ souligner le rôle de l’ambivalence dans les deux ordres de faits.
Indiquons dès maintenant les grandes lignes de l’interprétation fonctionnelle et structurale du travail du deuil, c’est-à-dire d’une conception générale du but et des moyens du deuil. La mort d’autrui nous fait « prendre conscience » de la « réalité interhumaine » en ce que cette mort est ressentie comme une blessure personnelle : le but du deuil est d’accomplir un clivage entre le mort et les survivants. Ses moyens consistent à transposer sur le plan humain le fait biologique, c’est-à-dire à « tuer le mort ».
Solution étrange pour qui n’est pas familiarisé avec les problèmes mettant en jeu l’interpsychologie de l’ego et de l’alter ego, tant nous sommes habitués à considérer leur séparation comme une donnée primitive et immédiate de l’intuition ; solution étrange encore parce que ‘les mécanismes qu’elle met en jeu sont étrangers au fonctionnement de la pensée rationnelle qui cependant peut seule poser et résoudre le problème. Le deuil nous est obscur à cause du travail du deuil même qui nous a permis de dépasser le deuil. Notre « filet de secours » sera la notion d’une mentalité prérationnelle ou primitive, dans le sens descriptif du terme, c’est-à-dire d’une pensée caractérisée essentiellement par le syncrétisme et la juxtaposition, l’indifférenciation et l’ambivalence, l’ignorance de ses propres opérations.
La mort d’un indifférent peut être une mort banale, à laquelle on « assiste ». Mais la mort d’un être à qui nous unissent des liens puissants, positifs ou négatifs, suscite les pleurs ou le rire. Nous « comprenons » la douleur qui suit la mort d’un être cher, l’isolement dans lequel se tient le « dolent » perdant tout intérêt pour le monde, les êtres et les valeurs et se concentrant sur la pensée du mort. Ainsi constitué, le deuil évolue d’une façon plus ou moins prolongée jusqu’à ce que l’affliction s’éteigne et que renaissent les intérêts mondains. [p. 10]
Une comparaison entre le début et la fin du deuil fait saisir la signification fonctionnelle du travail qui s’est accompli. Au début, des conduites de « non-réalisation » : tandis qu’objectivement le mort est passé de la co-présence et de l’existence « pour soi » qui caractérisent le « toi » à l’existence « en soi » qui caractérise la chose, la conduite du dolent reste intermédiaire entre les réactions à la présence et les réactions à l’absence ; à la fin, la conduite de l’absence prend le pas, le mort tend à devenir vraiment un « disparu ». Dans l’intervalle, suivant l’expression de Pierre Janet, se déroulent des « conduites de liquidation » en rapport avec la mort, il faut « réaliser » la mort, « faire son deuil » afin que le phénomène anormal « s’encadre » et que « la vie continue ».
Déjà les formes morbides du deuil permettent d’en pénétrer plus profondément la structure en exagérant certains phénomènes qui peuvent normalement se présenter dans le deuil.
Des phénomènes bien connus sont l’illusion de vie du cadavre et la négation de la mort qui donnent naissance au symptôme de la « méconnaissance systématique de la mort » dont la clinique a été bien étudiée par Jacques Borel.
Des illusions diverses, la rêverie, le rêve affirment contre la réalité la présence du mort. Cette présence du mort se projette dans les visions et les voix de certains délires oniroïdes. Il y a là une identification partielle au mort, puisque c’est l’activité propre du délirant qui est attribuée au mort. Le délirant joue encore plus nettement le rôle du mort dans les délires d’influence ou de possession, en particulier dans la forme spirite du deuil.
La mort d’autrui est une allusion à ma propre mort. La mort m’est prochaine dans la mesure où le mort m’est proche. Dans la forme anxieuse et hypocondriaque du deuil, le survivant s’identifie nettement au mort : il éprouve les symptômes de la maladie même qui a entraîné la mort du défunt.
Souvent des sentiments de culpabilité apparaissent après la mort : on se reproche de n’avoir pas assez aimé le mort, de ne pas le regretter assez ; s’il s’est suicidé, on se reproche de ne l’avoir pas empêché de mourir ; on idéalise les morts, on vante leurs vertus en oubliant, suivant la remarque de Fontenelle, que « leur principale vertu est d’être mort ». Cette forme obsessionnelle du deuil met en jeu le mélange d’amour et d’hostilité, l’ambivalence qui pesait sur les relations avec le défunt. [p. 11]
Ces exagérations des phénomènes du deuil normal permettent déjà de dégager quelques mécanismes essentiels du travail du deuil : l’inacceptation de la mort, l’ambivalence vis-à-vis du mort, l’identification au mort. L’analyse des formes mélancolique et maniaque du deuil, en pénétrant plus profondément le contenu de ces phénomènes, définira mieux la nature et les relations des mécanismes qui nous sont apparus.
Le deuil mélancolique emprunte des symptômes aux tableaux du deuil et de la mélancolie. On y retrouve à un plus fort degré la douleur morale et la perte de tout intérêt mondain qui caractérisent le deuil A ces symptômes s’ajoute le conflit dramatique de la mélancolie : perte ou forte diminution du sentiment de la valeur personnelle ; auto-accusations, en particulier de la mort de l’être aimé ; auto-punition : le sujet réclame instamment un châtiment qui mette fin à ses tourments, à ses remords ou, à d’autres moments le redoute, l’attend avec angoisse : il est anorexique, il tente de se suicider : souvent il refuse satisfaction à ses besoins naturels, il reste silencieux et immobile, comme s’il était lui-même mort ; beaucoup de mélancoliques stuporeux se comparent à un automate, à une momie. En termes psychanalytiques, on résume cette situation dans la notion d’un conflit interne entre le moi et un sur-moi particulièrement rigoureux.
Freud a explicité ce qu’une telle attitude a de paradoxal : le moi a perdu un être cher mais il se comporte comme s’il éprouvait une perte « dans le moi », comme s’il était non pas seulement « appauvri » mais intrinsèquement « diminué » : le moi est donc identifié à l’objet perdu. Les rigueurs du sur-moi s’appliquent au moi identifié à cet objet. La psychanalyse caractérise la structure du deuil par un conflit ambivalent, et dirigé contre le moi modifié « par l’ombre de l’objet ».
L’interprétation fonctionnelle du deuil va s’efforcer de montrer comment cette structure permet au travail du deuil de s’accomplir.
Pour en bien comprendre l’économie, il faut partir de l’interprétation structurale et fonctionnelle de la relation inter-humaine qui existait avant la mort.
En général, tout attachement à autrui implique à la fois ambivalence et confusion avec autrui. L’ambivalence de la relation permet à la composante érotique de lier la composante agressive, [p. 12] c’est-à-dire qu’elle permet à l’amour et à la bienveillance de dominer. La confusion du moi et de l’autrui correspond à la constitution d’une réalité inter-humaine, d’une communion ; toute relation de l’ego et de l’alter ego suppose elle-même une ambivalence de similarité et d’altérité: l’ego et l’alter ego ne sont jamais complètement distincts pas plus qu’ils ne sont jamais complètement confondus.
L’indifférenciation de l’ego et de l’alter ego, de l’amour et de la haine est, beaucoup plus prononcée chez les individus prédisposés aux formes pathologiques du deuil. Déjà dans la prédisposition à la névrose obsessionnelle manque ce primat de la génitalité qui paraît bien la base instinctuelle des relations intentionnelles de personne à personne, relations dont la forme suprême est l’amour ; l’attitude vitale reste fortement « narcissique », l’attitude vis-à-vis d’autrui « captative », les pulsions sadico-anales conservent un rôle éminent. Les mêmes traits se retrouvent dans la prédisposition à la mélancolie mais sous une forme plus régressive encore ; le choix amoureux est de type narcissique, le sujet s’aime dans l’autre et aime l’autre en lui-même ; profondément dépendant de l’autre, il a besoin de participer à ses activités et à ses émotions ; les pulsions orales sont prédominantes et cette fixation au « stade oral tardif » se laisse fort bien comprendre : c’est un stade de « cannibalisme » suivant la découverte d’Abraham où l’amour pour l’autre, consiste à le dévorer, à s’identifier à lui par « introjection ». La composante agressive est donc particulièrement forte puisqu’elle vise à la complète destruction de l’autre. La dépendance excessive par rapport à l’autre permet de maîtriser l’agression : on dit que les pulsions, l’érotique et l’agressive, sont « intriquées ».
La situation étant telle, on conçoit que la perte de l’être aimé puisse susciter, un deuil mélancolique. La composante érotique dont on a vu qu’elle était à peine détachée du moi perd ce qu’elle pouvait avoir d’investissement sur autrui. La composante agressive n’étant plus liée se libère, se « désintrique » ; et la fonction de cette libération d’agression est facile à saisir : le moi est plein de haine et de colère contre l’autre qui l’a abandonné, il faut détruire l’autre, affranchir le moi des liens qui l’unissent à l’autre. Or, ni la réalité ni la conscience morale ne permettent au moi de consommer cette destruction : l’idéalisation du mort surcompense l’agression que son départ a suscitée contre lui ; l’agression détournée [p. 13] de l’autre fait retour sur le moi et s’exerce sur lui dans les rigueurs auto-critiques, auto-accusatrices et auto-punitives du surmoi.
Si l’amour de soi (narcissisme) est assez fort, le moi se libère de la pression morale du sur-moi, en même temps qu’il renonce à l’autre et qu’une attitude bienveillante finit par triompher dans sa relation avec le mort : ainsi, au terme, du travail du deuil, se trouve à nouveau intriquée l’agression que la mort de l’autre avait désintriquée.
Un cas de deuil mélancolique analysé par nous montrera à quels faits correspondent les mécanismes exposés ci-dessus.
Une femme de 44 ans, veuve, nous est envoyée pour un état mélancolique typique constitué il y a environ huit mois, quelques jours après la mort de son fils unique, tué dans un accident d’auto ; quelques traits sont à signaler : elle dormait à peine et ses courts instants de sommeil étaient interrompus par des cauchemars dans lesquels elle revoyait le cadavre mutilé de son fils ; tout ce qui concernait la mort, amis, objets, souvenirs, après avoir sollicité pendant quelques jours une recherche passionnée, était devenu « tabou ». Bien entendu, elle se reprochait la mort de son fils, notamment parce qu’elle n’avait pas favorisé son mariage, ce qui aurait pu empêcher l’accident, et elle avait fait plusieurs tentatives de suicide.
L’enfance de la patiente avait été dominée par un conflit entre la mère frigide et le père infidèle et par de vifs sentiments d’infériorité sociale et morale. A la puberté, malgré une intense curiosité, elle était restée très ignorante des choses sexuelles. A dix-huit ans, elle avait subi un grave traumatisme, du fait de la naissance d’un frère, naissance d’autant plus ressentie comme une intrusion qu’elle dut s’occuper du nourrisson. Peu après, elle se maria ; en conflit avec son mari, égoïste et peu délicat, elle revint chez ses parents ; la naissance d’un fils permit un rapprochement sans lendemain, le mari ayant été tué à la guerre en 1915.
Dès lors commença une vie de travail, d’ailleurs fructueuse, entre ses parents et son fils. La recherche de satisfactions érotiques et sexuelles ne donna lieu qu’à des tentatives à peu près vaines, en raison du double obstacle de son fils et de ses parents, surtout de sa mère, particulièrement rigide et incompréhensive.
En deux occasions – rupture avec un homme et mort de son père – elle fit une réaction dépressive sans gravité. [p. 14]
Elle devint de plus en plus heureuse à mesure que son intérêt se concentrait sur son fils devenu homme. De multiples indices montrent, dans son amour pour son fils, la présence d’une composante incestueuse. Le caractère narcissique de la relation résulte de ce que le fils réalisait l’idéal physique, moral, social qu’elle n’avait pu atteindre ; en particulier, il était un homme. Cependant, malgré tout l’amour de la mère, la persistance d’un ressentiment se révélait dans des rêves où elle se débarrassait de son enfant encombrant.
Le traitement analytique permit de reprendre le travail du deuil immobilisé dans l’état mélancolique.
Dès les premières séances, le sommeil s’améliora, les cauchemars disparurent et l’on vit reparaître les rêves dans lesquels elle se séparait d’un enfant. Progressivement elle prit conscience de son ambivalence vis-à-vis de son fils : elle l’aimait et ne l’aimait pas ; les manifestations bruyantes de douleur auxquelles elle s’était livrée lors des obsèques n’avaient eu pour but que d’attirer sur elle l’attention et la pitié des gens. La démonstration de la confusion entre elle et son fils repose notamment sur le fait que les innombrables défauts qu’elle lui découvrait, elle se les reprochait tous à elle-même. En même temps le tabouisme qui isolait d’elle tout ce qui concernait le fils commença à se dissiper.
La situation analytique lui offrait artificiellement la possibilité de sortir de sa concentration sur le mort et de choisir dans le médecin un nouvel objet d’amour. Le transfert se manifesta notamment par des obsessions à contenu sexuel, le conflit obsessionnel exprimant le conflit entre la fidélité -au mort et l’amour pour le médecin. Bien entendu ce nouvel investissement était des plus ambivalents ; elle dépréciait sans cesse le médecin, l’assimilait à un petit enfant ; elle s’écria un jour ; « Faut-il donc que je vous aime pour être aussi méchante ! »
L’hostilité contre le médecin exprime aussi une défense contre la tentation. Par son attitude « démoralisatrice », le médecin prenait position contre les instances morales représentées par la mère moralisatrice. Un rêve de la dixième séance illustre bien ce conflit qui est au centre de la maladie et de la vie de la patiente : elle boit au goulot une bouteille de liqueur ; la mère explique au frère qu’elle la laisse faire parce qu’elle est malade. Les propos spontanés de la malade portent sur un acte analogue accompli par le père au cours d’une discussion avec la mère, à l’occasion d’une [p. 15] infidélité ; elle parle aussi longuement des seins de sa mère et des siens, de l’allaitement, de la fellation, Ainsi, au nom de sa maladie, la patiente a pu arriver à fléchir la sévérité de sa mère qui lui accorde la même licence qu’à l’homme ; le frère rival est évincé avec ménagement : le choix de la bouteille bue au goulot comme symbole de la liberté est typique de la fixation orale ; le passage du sein au pénis montre que dans les profondeurs inconscientes la mère-nourriture et moralisatrice est restée le modèle de tous les autres objets d’amour. Bien entendu ce que le rêve exprimait avant tout, c’est le désir que la mère permît à la patiente de continuer ses relations avec le médecin.
L’événement donna de cette interprétation une confirmation tragique. Seule la mère restait à l’abri de l’agressivité de la patiente ; trop faible pour secouer ce joug elle n’attaque la mère qu’indirectement, dans la garde à qui elle est confiée. Les vacances arrivèrent ; l’impossibilité d’interrompre le traitement me fit engager la malade à me suivre dans ma villégiature, ce qu’elle accepta. Mais la mère dépossédée enleva littéralement sa fille. Quelques semaines plus tard, la patiente désespérée d’avoir interrompu le traitement, « sa seule planche de salut », se fit brûler.
La forme maniaque du deuil est incompréhensible sans la notion d’une ambivalence qui se manifeste déjà dans le rire que la mort peut susciter et dans la valeur comique du macabre, Le deuil maniaque repose sur le même complexe que le deuil mélancolique mais, tandis que dans la mélancolie le moi succombe sous ce complexe, dans la manie il s’en affranchit. Une vive surrection de l’amour de soi, de « l’instinct de conservation » (instinct du moi, narcissisme), permet au moi de dépasser tout un passé pénible. Les pulsions érotiques et agressives se libèrent de la pression des instances morales : la manie, c’est la psychologie du « quand même ». Les recherches physiopathologiques n’ont pas encore résolu le problème de la tonalité mélancolique ou maniaque de ces réactions psychologiques morbides. A titre d’hypothèse, la psychopathologie peut mettre en cause la force relative du moi en face des pulsions instinctives et des instances morales,
Nous avons déjà publié l’observation d’une femme de 37 ans, pourvue d’incontestables antécédents maniaco-dépressifs, chez laquelle un état maniaque se constitua quelques jours après le suicide de son père, trouvé pendu dans la cave. La seule observation [p. 16] clinique permet de mettre en évidence l’interprétation qui vient d’être esquissée. Après la mort de son père, au lieu de le pleurer, la malade s’attaque à lui ; « Il m’a fait ce que je n’aurais pas voulu lui faire… Je lui en ai assez dit quand on l’a mis en bière » ; s’il avait recouru au rasoir ou au revolver « Je l’aurais agoni » ; elle proteste contre le poids de ce passé pénible ; « Je ne suis pas le pape, j’en ai assez d’une hérédité comme ça ». Elle présente avec une certaine fréquence une alternance d’excitation maniaque et de lucidité ; dans l’état maniaque, elle nie la. Mort du père, elle est grossière, impudique, érotique, violente ; dans l’intervalle lucide, elle reconnaît la mort et elle explique la grossièreté et la salacité de l’état maniaque en disant qu’elle fait comme son père. La mère paraissait représenter la source principale de la répression sexuelle.
La psychologie des formes maniaques et mélancoliques du· deuil est le fil conducteur de l’interprétation de la mélancolie et de la manie ; l’exploration clinique et analytique met en évidence la même fonction, la même structure, les mêmes prédispositions. La différence la plus apparente consiste en ce que les états maniaques et mélancoliques paraissent souvent survenir d’une manière spontanée et incompréhensible. Mais l’investigation analytique ou un examen clinique averti et minutieux mettent en évidence de menus faits qui paraissent dépourvus d’importance mais dont le retentissement a été énorme ; leur contenu vivant et implicite en fait une répétition d’un deuil passé, plus généralement de la perte d’un être cher. Le dogme organiciste, sans parler de l’échec peut être provisoire des énormes recherches qu’il a inspirées, n’est pas une objection de principe irréductible ; une atteinte organique réalise précisément une perte éprouvée dans le moi ; tel ce malade observé par nous il y a quelques années, dont l’excitation maniaque avait suivi une hémorragie importante, sans aucune trace de confusion.
Si nous revenons au deuil au sens strict, nous pouvons résumer notre conception en définissant le deuil comme un travail par lequel le survivant se clive du mort et rétablit finalement l’intrication des pulsions agressives et érotiques que la mort de l’être aimé avait rompue.
Les travaux ne manquent pas où nous pouvons nous renseigner [p. 17] sur la fonction du deuil dans les sociétés primitives ; nous nous réfèrerons surtout à la synthèse de Robert Hertz « Contribution à une étude de la représentation collective de la mort ». L’auteur y expose, dans un ordre de succession naturelle, les données relatives au cadavre, à l’âme et aux survivants. Il emprunte sa documentation exclusivement aux Dayaks de Bornéo et généralise ses résultats à l’aide de documents provenant d’autres sources et appartenant notamment à des civilisations totémiques. Ce qui a frappé Robert Hertz, c’est le fait des secondes obsèques ; à la fin de son essai, il résume ainsi sa conception : « Pour la conscience collective, la mort dans les conditions normales est une exclusion temporaire de l’individu hors de la communion humaine, qui a pour effet dé le faire passer de la société visible des vivants à la société invisible des ancêtres. Le deuil est à l’origine la participation nécessaire des survivants à l’état mortuaire de leur parent ; il dure aussi longtemps que cet état lui-même, En dernière analyse, la mort, comme phénomène social, consiste dans un double et pénible travail de désagrégation et de synthèse mentales ; c’est seulement quand ce travail est achevé que la société, rentrée dans la paix, peut triompher de la mort » (pp. 97-98),
Dans d’autres passages, Hertz insiste à diverses reprises sur l’idée que le deuil est un travail (pp. 40, 60, 90-91), Et c’est un travail en raison des investissements dont le mort était l’objet (p. 89-91) ; la preuve en est qu’on ne porte pas le deuil des êtres sans importance sociale, des jeunes enfants par exemple. Sous bien d’autres rapports encore, Hertz montre qu’il n’est pas seulement un sociologue disciple de Durckheim mais un psychologue né ; il insiste notamment sur cette idée, d’une grande importance méthodologique pour nous : les représentations collectives relatives aux vicissitudes de l’âme ne sont que la projection des sentiments des survivants (pp. 12, 15, 91 et passim).
Dans notre étude psychologique du travail du deuil, nous avons reconnu à l’agression trois sources principales : l’agression immanente à toute relation inter-humaine, le ressentiment suscité par le départ du mort, l’agression immanente au travail du deuil, qui est de détruire l’objet d’amour et liquider les investissements affectifs faits sur lui,
L’agression immanente à toute relation inter-humaine est celle que Freud met en évidence dans Totem et Tabou (p. 87). [p. 18] Le mort est considéré comme un ennemi parce que nous projetons sur lui la composante agressive libérée par la mort, afin de nous défendre de la prise de conscience des souhaits de morts dirigés contre lui. Westermarck souligne que pour le primitif aucune mort n’est normale, naturelle, que toute mort· est suspecte, attribuable à de mauvais procédés, à la magie (L’origine et le développement des idées morales, I, pp. 28, 32, 33). Hertz (p. 83 et n. 1, 2), Malinowski (V.S., pp. 162-163) appuient la même idée sur de nombreux faits. Cette projection de l’agression explique la transformation du mort en esprit malfaisant et la croyance aux démons.
La seconde source d’agression est le ressentiment contre le mort, à cause de sa mort. Il arrive qu’au lieu de s’en prendre aux esprits, on s’en prenne au mort lui-même : « Quelle raison avais-tu, ingrat, de nous abandonner ? » (Hertz, p. 84).
Cette colère met déjà en jeu l’agression immanente à la fonction destructrice du deuil. Le mort est rejeté violemment hors de la société, entraînant avec lui ses parents les plus proches (Hertz, 84). Il faut que le corps soit détruit pour que le mort puisse passer de ce monde dans l’autre (Hertz, 31). L’art humain, des pratiques diverses, dont l’endocannibalisme, hâtent ou devancent l’efficacité des forces de la nature. Le phénomène des secondes obsèques consomme la mort sur le plan humain : il est corrélatif d’une seconde mort, non plus naturelle mais sociale, accomplie par la société ; il n’y a pas de secondes obsèques pour les êtres dépourvus d’importance sociale. Il existe même des rites funéraires, sortes de drames ou de mystères, dans lesquels le mort est tué (Hertz, 76-77). Enfin, on sait avec quelle fréquence le deuil comporte des sacrifices humains, souvent très cruels, surtout au moment de la cérémonie finale.
Cette libération de l’agressivité au décours du deuil est un des facteurs qui permettent la réconciliation finale du mort et des survivants. Après avoir été un démon dangereux et malfaisant, le mort devient un ancêtre bienveillant et protecteur (Hertz, 50, 53, 57, 75). Il est donc juste de dire que la période intermédiaire entre la mort et les secondes obsèques est caractérisée par la désintrication et la projection de l’agression.
Une confirmation de ces vues résulte de l’attitude vis-à-vis des ennemis tués: dans beaucoup de sociétés, le meurtre des ennemis est suivi par tout le déploiement du deuil et les coutumes de [p. 19] réconciliation vont jusqu’à faire d’eux des gardiens et des protecteurs (Freud, Totem et Tabou, p, 56, 199). Vis-à-vis des ennemis aussi la relation était par conséquent ambivalente : d’autres sentiments l’animaient que la seule hostilité : le repentir, l’hommage à l’ennemi mort, le regret de l’avoir tué (p. 59).
Si la société exclut le mort par un travail actif comme un organisme élimine une partie mortifiée, le fait que dans son exclusion le mort entraîne ses proches parents avec lui suggère l’idée d’une identification du mort et des survivants contaminés par la mort. Tout d’abord, du fait de leur relation avec la mort, ses proches se sentent atteints dans leur existence propre (Hertz, 14, 17, 59). Et cela est si vrai que dans les sociétés matriarcales les parents de sang sont considérés seuls comme atteints par la mort ; d’où le rôle éminent des femmes dans les pratiques funéraires (Malinowski, V.S. 22-23). Pendant la période intermédiaire, le mort continue à être traité comme un vivant (Hertz, 34 ; Malinowski, 156) ; c’est ainsi qu’un homme mort conserve sur sa veuve, si elle ne l’a pas suivi dans la tombe, des droits sur lesquels les parents du défunt veillent jalousement.
Si le mort est traité comme un vivant, inversement les survivants sont traités comme des morts : ce sont les « gens de la mort » dont toutes sortes d’interdictions assimilent le corps au cadavre : l’immobilité, le silence sont des prescriptions fréquentes dans le deuil (Hertz, 41). Il arrive qu’un seul terme désigne tout ensemble le cadavre, la période de deuil et l’état de deuil (Hertz, 38, n. 4). L’identification se réalise matériellement par le port de reliques du mort, d’ossements plus ou moins ornementés et par la pratique de l’endocannibalisme (Hertz, 40).
La notion de projection, bien mise en lumière par Hertz, résout la question des relations de l’ambivalence et de l’identification ; l’agression dirigée contre le mort par les vivants devient agression du mort contre les vivants ; les interdictions, les pénitences sont à la fois des devoirs envers le mort et des sévices que les vivants s’infligent afin de fléchir le mort, Ce qui achève de le démontrer, ce sont les cas où les restes du mort se retournent contre un survivant qui a enfreint les prohibitions (Hertz, 39, n. 1).
A la question des relations de l’ambivalence et de l’identification se rattache l’interprétation de l’endocannibalisme. Il est tentant d’y voir une manœuvre à la fois destructrive (agressive) et identificatrice, que l’on rapprocherait de l’introjection dont la [p. 20] psychanalyse a· fait le pivot de sa théorie du deuil. Quant à l’identification, aucun doute n’est permis : il s’agit bien, en absorbant le mort, de lui donner une sépulture honorable, de s’assimiler sa puissance et ses vertus. Mais la relation de l’endocannibalisme avec l’agression n’est pas aussi claire ; Hertz, par exemple; rejette complètement l’intervention, comme dans l’anthropophagie banale, d’un « raffinement de cruauté ou la satisfaction d’un appétit physique » (Hertz, 27). Dans bien des cas, les survivants qui accomplissent ce devoir de piété doivent triompher de leur répugnance et s’interrompre pour aller vomir.
Freud, dans « Deuil et mélancolie », remarque qu’aucune explosion maniaque ne survient au décours du deuil, sans doute, suggère-t-il, parce que les forces nécessaires au travail du deuil se sont dépensées progressivement (p. 113). Cela est vrai, à coup sûr, de l’existence individuelle : le deuil maniaque est une réaction aussi précoce que le deuil mélancolique, non pas une réaction qui vient clore et couronner celui-ci. Mais l’ethnographie du deuil décrit des phénomènes comparables à la manie. C’est ainsi qu’une période d’anarchie, de véritables saturnales peuvent suivre immédiatement la mort d’un chef ou d’un de ses parents. (Hertz, 36, et les notes), ou encore la mort d’un vieillard (Hertz, 95, n. 1). Contrairement à ces explosions précoces qui se rencontrent assez rarement, de telles réactions apparaissent d’une façon habituelle dans la cérémonie finale souvent marquée par des banquets et des orgies dans lesquels on se libère de tous les tabous du deuil, où l’on dépense des provisions accumulées parfois pendant plusieurs années, au prix de pénibles sacrifices (Hertz, 44). Dans les mystères funéraires, c’est un véritable triomphe lorsque le mort est sensé être parvenu dans l’au-delà (Hertz, 54). Ici encore, l’identification des vivants et des morts s’affirme jusque dans la cérémonie finale qui les sépare, puisqu’elle consacre ‘simultanément la libération des uns et des autres.
On peut appliquer à là cérémonie finale l’interprétation que Freud a donnée des saturnales romaines et du carnaval qu’il a rapprochés de la manie : les pulsions instinctives s’y affranchissent de la pression des instances morales. (Freud, Psychologie Collective, 117 ; Totem et Tabou, 194). Nous avons dit de la manie qu’elle était un triomphe sur le malheur, une psychologie du « quand même » : cette interprétation est celle même que Hertz, en 1907, [p. 21] donnait de la cérémonie finale : « une victoire sur le malheur » (62), « le triomphe de la société sur la mort » (98).
Le rituel du repas totémique regroupe tant de rapprochements convaincants : meurtre rituel et collectif du totem auquel les participants s’identifient ; deuil soustrayant le clan à la responsabilité du meurtre ; puis fête et repas en commun, dans lequel s’affirme et se rénove l’identification au totem de tous les membres du clan (Freud, Totem et Tabou, 183 sqq.).
De même que dans l’étude de l’existence individuelle la notion de deuil a été élargie jusqu’à coïncider avec celle de perte en général, de même dans la vie collective les notions de mort et de deuil s’élargissent jusqu’à coïncider avec tous les faits de passage tels que la naissance, l’initiation, le mariage.
Cette double étude conduit donc à la notion d’une analogie profonde des processus du deuil dans l’existence individuelle et dans les institutions des sociétés primitives : dans les deux cas, un travail est nécessaire qui exclue le mort de la réalité interhumaine et au terme duquel le vivant se trouve affranchi de son identification avec le mort.
La mort d’autrui, dit-on, est tout autre chose qu’un fait biologique. Si ces vues sont exactes, le phénomène de la mort ne serait pas autre chose qu’une sorte de répétition de la mort sur le plan humain : vivre la mort d’autrui serait une sorte de mise à mort. On voit comment, sur ce point, l’envisagement de la psychologie humaine se distingue nettement de celui des sciences de la nature.
On aperçoit maintenant peut-être mieux pourquoi les formes pathologiques du deuil ou la psychologie en profondeur permettent seules de dégager sa structure et sa fonction. L’altération de l’ego, essentielle à l’intelligence du travail du deuil, échappe à la psychologie descriptive qui se développe sur un plan où l’ego et l’alter ego sont nettement distincts et séparés, Ce clivage de l’ego et de l’alter ego a eu entre autres conséquences celle de nous faire perdre le sens de la réalité inter-humaine dans laquelle vivent les primitifs. L’obscurité du problème du deuil est lié à la formation de l’ego et de l’alter ego : la distinction corrélative de ces notions a précisément pour condition, avec l’exclusion de l’alter ego et l’acceptation de la solitude de l’ego, un travail foncièrement analogue [p. 22] au travail du deuil : l’être humain ne devient un Je isolé et fermé qu’à la suite d’une série de séparations actives, dans lesquelles il abandonne successivement l’union organique, l’union parasitaire, l’union grégaire. La succion du sein maternel est, dans l’existence individuelle, l’origine de la communion ; la prédisposition aux formes pathologiques du deuil trouve une base instinctuelle dans la fixation orale au sein maternel.
Disons enfin que la profonde analogie que nous avons cru établir entre le travail du deuil dans les sociétés primitives et le travail du deuil dans l’existence individuelle ne nous parait nullement justifier les hypothèses d’une régression du malade à un psychisme archaïque ou l’hypothèse d’un inconscient collectif ; nous sommes plutôt portés à croire que les deux ordres de faits ont leurs conditions dans les nécessités d’une réalité inter-humaine profonde et comme telle « primitive », cela en un sens purement descriptif.
LES PRESSES. MODERNES
96, Galerie Beaujolais – Palais-Royal
PARlS




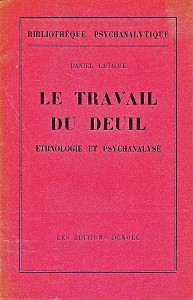
Pour info