 Ludovic Dugas. Dépersonnalisation et absence. Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), XXXIIIe année, n°5-6, 1936, pp. 359-367.
Ludovic Dugas. Dépersonnalisation et absence. Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), XXXIIIe année, n°5-6, 1936, pp. 359-367.
Ludovic Dugas (1857-1942). Agrégé de philosophie, Docteur es lettre, bien connu pour avoir repris de Leibnitz, dans ses Essais sur l’Entendement humain, tome II, chapitre XXI, le concept de psittacus, et en avoir inscrit définitivement le concept de psittacisme dans la psychiatre française par son ouvrage : Le psittacisme et la pensée symbolique. Psychologie du nominalisme. Paris, Félix alcan, 1896. 1 vol. in-8°, 2 ffnch., 202 p. Dans la « Bibliothèque de Philosophie Contemporaine ». Il s’est intéressé précisément au « rêve » sur lequel il publia de nombreux articles. Il est également à l’origine du concept de dépersonnalisation dont l’article princeps est en ligne sur notre site. Nous avons retenu quelques uns de ses travaux :
— Observations sur la fausse mémoire. Article parut dans la « Revue de philosophie de la France et de l’étranger », (Paris), dix-neuvième année, tome XXXVII, janvier-juin 1894, pp. 34-45. [en ligne sur notre site]
— A propos de l’appréciation du temps dans le rêve. Article paru dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), vingtième année, XL, juillet décembre 1895, pp. 69-72. [en ligne sur notre site]
— Le sommeil et la cérébration inconsciente durant le sommeil. Article paru dans la « La Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), XLIII, janvier à juin 1897, pp. 410-421. [en ligne sur notre site]
— Un cas de dépersonnalisation. Observations et documents. In « Revue philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), vingt-troisième année, tome XLV, janvier-février 1898, pp. 500-507. [en ligne sur notre site]
— Observations et documents sur les paramnésies. L’impression de « entièrement nouveau » et celle de « déjà vu ». Article parut dans la « Revue de philosophie de la France et de l’étranger », (Paris), dix-neuvième année, tome XXXVIII, juillet-décembre 1894, pp. 40-46. [en ligne sur notre site ]
— (François Moutier). Dépersonnalisation et émotion. Article paru dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente-cinquième année, tome LXX, juillet à décembre 1910, pp. 441-460. [en ligne sur notre site]
— Un nouveau cas de paramnésie. Article parut dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente-cinquième année, LXIX, Janvier à juin 1910, pp. 623-624. [en ligne sur notre site]
— Quelques textes sur la fausse mémoire : Dickens, Tolstoï, Balzc, Lequier. Extrait du « Journal de psychologie normale et pahologique », (Paris), onzième, 1914, pp. 333-338. [en ligne sur notre site]
— De la méthode à suivre dans l’étude des rêves. « Journal de Psychologie normale et pathologique », (Paris), XXXe année, n°9-10, 15 novembre-15 décembre 1933, pp. 955-963. [en ligne sur notre site]
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Par commodité nous avons renvoyé les notes de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoute par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 359]
DÉPERSONNALISATION ET ABSENCE
J’ai précédemment groupé les principaux traits caractéristiques de la dépersonnalisation (1) et montré qu’elle est autre chose que le simple phénomène d’absence dans lequel Ribot a cru la reconnaitre et auquel il l’a identifiée. Mais je ne méconnais pas pour autant l’intérêt qu’il y aurait à la rapprocher de l’absence, à étudier celle-ci a son tour, à la prendre même comme point de départ et comme centre d’une étude générale des troubles de la conscience ou du moi. Il convient, à cet effet, d’élargir le sens du mot dépersonnalisation et de la définir la personne devenue étrangère à ses états, dont elle n ‘a plus conscience. Ainsi entendue, elle est l’automatisme mental, la perte du sentiment du moi. Elle prendra autant de formes qu’il y a de façons différentes de concevoir le rapport du moi à ses états. Or, à l’état normal, chez tout individu sain, chacun des états de conscience a, comme dit Ribot, ce double caractère d’être tel ou tel et en sus d’être affecté d’un coefficient personnel ; autrement dit, il a outre sa qualité, sa marque individuelle, par laquelle il apparait au sujet comme propre à lui seul, sans laquelle il lui apparait comme étranger. La conscience est donc, comme l’a définie Renouvier, une relation du moi au non-moi ; elle comprend un élément objectif, la qualité, et un élément subjectif, le sentiment du moi ; elle est la synthèse de ces deux éléments. Cette synthèse paraît irréductible; en fait, il arrive qu’on ait conscience d’une sensation sans la rapporter au moi ; mais c’est là un état anormal et qui paraît tel au sujet qui le perçoit. Il est contradictoire en effet d’éprouver une sensation et de n’avoir pas conscience d’être celui qui l’éprouve. Telle est la dépersonnalisation véritable ou proprement dite. Mais il s’agit ici, suivant la remarque expresse de Ribot, [p. 360] de la conscience spontanée ; en est-il de même de la conscience réfléchie ? Celle-ci pourrait s’appeler d’un mot l’attention. Or, quand le moi réfléchit sur ses états, il opère sur eux une dissociation analogue à celle qui se produit dans la dépersonnalisation : il retire son attention au côté subjectif ou personnel de la sensation pour la reporter toute sur son caractère objectif, sur ce qu’on appelle sa qualité. Mais il est manifeste que, quoiqu’elle porte sur les mêmes éléments, la dissociation n’est pas la même dans les deux cas : dans l’attention, elle a sa raison d’être et répond à une fin, la volonté du sujet s’accomplit ; dans la dépersonnalisation, le moi subit une contrainte ; il est en proie à une illusion qu’il sait tello sans pouvoir s’en déprendre; il a des impressions qu’il sent qu’il ne devrait pas avoir, il se heurte à une impossibilité psychologique sentie comme telle ; il n’en croit pas ce qu’il éprouve et doute de lui-même. Les deux cas sont nettement différents. Sont-ils même comparables ? Peut-on dire qu’il y a abolition de la conscience et perte du sentiment du moi quand le moi détourne sa pensée de lui-même pour la reporter toute sur les opérations qu’il accomplit ? La volonté n’est-elle pas inséparable de la conscience, et la distinction du conscient et de l’inconscient ne se réduit-elle pas ici à celle de l’activité volontaire et de l’activité automatique ?
Considérons en effet ce qui se passe dans l’attention : quand l’esprit s’adonne à une tâche pour laquelle il se passionne, il s’y absorbe, il tend à s’y oublier, à s’y perdre, et il perdrait en effet jusqu’à la conscience d’être, s’il ne lui restait le sentiment de la part qu’il prend à cette tâche, en continuant à la vouloir, à en diriger et à en surveiller l’exécution. Mais supposons que l’activité qu’il déploie à cette occasion soit spontanée et toute automatique; il aura alors le sentiment de n’être pour rien dans ce qu’il fait, d’être détaché de ses actes, d’être à leur égard ce que serait un spectateur du dehors, d’être ce spectateur. C’est précisément ce qu’éprouve le dépersonnalisé, mais il a en même temps le sentiment aigu de l’absurdité de ses impressions. Il sait, ou plutôt il sent qu’il ne peut pas avoir conscience de phénomènes se passant en lui, dont il ne serait pas plus le sujet que la cause.
Toute son expérience passée proteste contre son état mental présent; il a dans cet état le sentiment d’une déficience; il manque à [p. 361] ses impressions, pour qu’il puisse y croire, de faire partie du moi, d’être attachées à sa personnalité. En effet, si le moi ne se connaît, ne se révèle à la conscience que par ses modifications et ses actes, s’il faut qu’il s’exprime en eux et par eux, les états de conscience ne peuvent pas davantage être perçus en dehors du moi. La conscience est donc la relation nécessaire du moi a ses états. Si cette relation cesse d’exister, les sensations, comme les images du rêve, flottent devant l’esprit, éparses et sans lien, et s’évanouissent à mesure ; le moi aussi s’évanouit, qui est le lien que forment les sensations et les images, l’accord qu’elles réalisent et l’unité qui s’en dégage.
Nous voyons comment la conscience se dissout ou est empêchée de se former. Il suffit pour cela que ne se produise plus l’acte par lequel le moi s’empare de ses états, les marque du sceau de sa personnalité, les rattache à soi, les fait et les déclare siens.
Cet acte est, à l’état normal, impliqué dans tous les faits de conscience, mais on n’a pas de mot pour le désigner ; il est malaisé à définir ; il faut pour se convaincre qu’il existe un effort de réflexion ou, comme dit Leibniz, un de ces « actes réfléchis par l’énergie desquels nous pensons ce qui s’appelle moi, actus reflexi, quorum vi istud cogitamus quod egoappellatur ». Comme type de ces actes, Maine de Biran cite l’effort moteur dans le mouvement volontaire, et André Ampère l’effort d’attention. Il en donne pour exemple le rappel volontaire. On sait qu’il y a deux sortes de souvenirs : ceux qui reviennent à l’esprit d’eux-mêmes, au hasard des associations d’idées et ceux qui répondent à la sollicitation et à l’appel de la volonté. L’apparition des premiers est acceptée comme un fait naturel, celle des seconds semble paradoxale et est jugée a priori impossible. Gomment, en effet, évoquer à volonté des faits oubliés, comment faire revivre ce qui n’est plus, comment chercher ce dont on n’a pas l’idée ? C’est ce qu’on ne peut comprendre que si on admet à l’origine de certaines sensations un effort d’attention qui s’y joint, susceptible de laisser une trace et de renaître sous forme de souvenir, comme les sensations elles-mêmes. Cet acte reproduit, comme il est produit, volontairement, ramènerait il sa suite les sensations évanouies ; il n’est pas nécessaire pour cela de recourir à l’hypothèse péripatéticienne de deux mémoires spécifiquement distinctes, l’άνάμνησις et la μνήμη, l’une dont la volonté dispose, l’autre sur laquelle elle n’a pas [p. 362] de prise. Il est plus simple d’admettre que la mémoire est une et qu’il n’est pas au pouvoir de la volonté d’en changer la nature ; le rôle de celle-ci consiste uniquement à créer une association entre l’effort d’attention et certaines sensations, de façon à accroître pour ces dernières le nombres des chances de rappel, le souvenir de l’effort ramenant à sa suite le souvenir des sensations, et inversement. C’est par la vertu de l’association, et non par le pouvoir de la volonté, que les souvenirs sont, en fait, évoqués. La volonté intervient sans doute dans le rappel, mais uniquement pour tirer parti du jeu des lois de l’association qui met l’esprit sur la voie du souvenir cherché. La mémoire est autonome et la volonté ne la gouverne qu’en se conformant à ses lois. D’autre, part, si par l’effort d’attention volontaire dont parle Ampère on entend l’acte, par lequel le moi s’associe les sensations, les fait siennes, on peut prévoir les troubles qui se produiront dans la conscience du fait de la rupture du lien d’association qui existe entre le moi et les sensations. Nous aurons à considérer deux cas : l’un, où l’effort d’attention manque à se produire, c’est l’absence ; l’autre, où il se produit, mais n’aboutit pas, c’est la dépersonnalisation. De ce que, dans les deux cas, il y a inhibition de la conscience par anémesthèse (perte du sentiment du moi), il ne s’ensuit pas qu’on puisse les identifier : l’absence, comme on verra, peut-être, au moins dans certains cas, considérée comme normale, tandis que la dépersonnalisation est toujours pathologique. C’est ce qu’il nous reste à montrer.
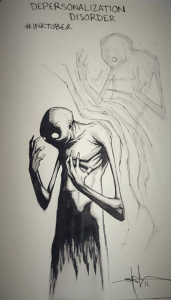 Parce que l’absence est un fait d’expérience courante, familier à chacun, on pourrait croire qu’elle est mieux connue et plus aisée à connaître que la dépersonnalisation, anomalie psychique, qui ne se rencontre que chez de rares sujets. Elle est en réalité plus complexe et peut revêtir plusieurs formes. Il m’a été donné d’en observer deux à différentes époques de ma vie.
Parce que l’absence est un fait d’expérience courante, familier à chacun, on pourrait croire qu’elle est mieux connue et plus aisée à connaître que la dépersonnalisation, anomalie psychique, qui ne se rencontre que chez de rares sujets. Elle est en réalité plus complexe et peut revêtir plusieurs formes. Il m’a été donné d’en observer deux à différentes époques de ma vie.
Lorsque je me reporte à mes premières années d’internat au lycée, je me vois jouant consciencieusement et avec conviction mon rôle d’écolier, prenant part aux jeux de la cour et aux exercices de la classe, mais vivant en pensée dans mon village, parmi les miens que je me figurais par moments n’avoir point quittés, brouillant tout alors comme dans un rêve, événements, personnages, situation et milieu. J’avais fait de ma vie deux parts : l’une, sentimentale, [p. 363] personnelle et intime, dont je gardais jalousement le secret, l’autre, intellectuelle et, si on peut dire sociale, bien remplie et assez active en apparence pour qu’on pût croire que je m’y livrais tout entier. De ces deux vies, on n’eût pu dire quelle était la vraie de les menais de front, j’oscillais de l’une à l’autre mais c’est dans la première que je trouvais mon équilibre. Par les lettres de mon père, toujours trop rares et trop courtes à mon gré, je suivais les menus événements de la vie des miens, je leur donnais place dans ma vie et me plongeais dans la leur ; je les mêlais aussi à la mienne que je découvrais en quelque sorte et dont je prenais conscience en la détaillant dans des lettres auxquelles je donnais sagement les mêmes soins et la même application qu’à mes devoirs, avec la délectation en plus. Le dédoublement du moi dont on parle comme d’un phénomène morbide m’était naturel et sain : je trouvais dans ma vie imaginative un refuge contre une vie réelle ; qui m’eût été autrement insupportable ; je me sentais dépaysé au lycée ; les besognes scolaires m’étaient extérieures ; cependant je m’en acquittais assez bien, et peut-être d’autant mieux, que j’en étais plus détaché. J’étais en étude et en classe perpétuellement, absent ; je vivais comme dans un rêve. Qu’un pareil état pût s’accompagner d’un bon travail, cela montre que l’activité de l’esprit n’est pas une chose aussi simple qu’il paraît, que l’attention est liée au ton vital et se multiplie sous l’influence d’une heureuse distraction dont le travail bénéficie.
L’intérêt, qu’on prend à la vie intérieure empêche de sentir l’ennui : de la besogne quotidienne, la fait accepter et permet d’y apporter une attention consciencieuse qui ignore la répugnance et les caprices de l’humeur. Le travail fourni, dans ces conditions à la régularité et la précision d’un travail de machine, et c’est une condition pour assurer bien des succès même dans certains exercices intellectuels. Lorsque l’automatisme est lié à une dissociation de l’attention, il peut avoir des effets plus heureux encore : l’intérêt étranger au travail tient la personnalité en éveil, renouvelle les forces qu’on applique à sa tâche.
Cependant il peut arriver aussi que les images étrangères à la vie présente envahissent peu à peu la conscience aux dépens de toute activité. Nous laissons l’esprit aller où bon lui semble, vivre dans un monde de fantaisie où rien ; ne lui résiste, où les idées évoquées sont [p. 364] agréables, ne serait-ce que par la facilité avec laquelle elles se déroulent : c’est la rêverie qu’Amiel appelle « le dimanche de la pensée », et qui était pour Rousseau un état délicieux.
Le dédoublement du moi, dans les conditions qu’on vient de dire, est la forme sous laquelle se traduit à la conscience la répartition des tâches entre les fonctions psychiques. Il y a intérêt à ce que, tout en restant solidaires, les fonctions diverses gardent chacune une indépendance relative, à ce que la volonté, par exemple, se réserve les tâches qui demandent de l’initiative et abandonne à l’automatisme celles qui lui reviennent dans l’ordre intellectuel aussi bien que physique. Ainsi défini, le dédoublement du moi, loin de jeter un trouble dans la conscience, de porter atteinte au sentiment du moi, renforce et précise ce sentiment, puisque plus ses fonctions sont multiples, plus s’accuse et mieux se fait sentir leur interdépendance, leur accord, et que c’est cet accord qui constitue le moi. C’est quand une fonction devient prédominante, se développe aux dépens des autres, rompt l’équilibre mental, qu’on peut parler d’une rupture du moi. Ainsi, dans la rêverie, sous sa forme extrême, les perceptions deviennent confuses, s’évanouissent, les pensées que nous essayons de suivre nous échappent, s’oublient à mesure et se dérobent à l’effort que nous faisons pour les ressaisir.
La rêverie que j’ai ici en vue, c’est la pensée à vide dont l’esprit se désintéresse, qu’il n’enregistre même plus. Il y en a une autre, que Rousseau a pratiquée et décrite avec un rare bonheur, dans laquelle on se complaît, qu’on cultive avec art. C’est, à vrai dire, la réflexion s’appliquant à la première, non pour s’y anéantir et s’y perdre, mais pour y trouver l’extase, le plaisir de « l’existence nue », ce que d’autres ont appelé les joies du nirvana.
Les états que nous avons décrits ont pour caractère commun de se passer en dehors du moi conscient ; groupons-les sous le nom général d’absence ; l’absence est la personnalité étrangère à ses états ; on pourrait donc l’appeler dépersonnalisation au sens large. Il y a absence, lorsque le moi a deux vies et ignore dans l’une ce qui se passe dans l’autre, autrement dit, dans le cas du dédoublement du moi. Encore faut-il distinguer le cas pathologique, où ce dédoublement est pris au sens propre (celui de Félida X), et le cas normal, où il n’y a dédoublement qu’au sens figuré. De même, il y a [p. 365] dépersonnalisation au sens propre, lorsque le moi a le sentiment d’assister à ses états comme ferait un spectateur du dehors et cesse de se les attribuer, et dépersonnalisation au sens figuré dans la rêverie.
Ces différents états sont situés dans le temps. Tout âge a ses absences, chaque âge a les siennes propres. La jeunesse n’en est pas exempte. L’enfant, comme on l’a vu, a souvent une vie personnelle et secrète où il s’isole de la vie extérieure qui lui devient comme étrangère. On ne peut pourtant pas parler ici d’un dédoublement au sens strict : ses deux vies se rejoignent et se complètent, l’une anime l’autre, elles ne sont pas parallèles, mais conjointes. Dans le fait qu’elles coexistent, je vois déjà la preuve non seulement qu’elles ne s’entravent pas l’une l’autre, mais qu’elles se prêtent un mutuel appui et qu’ainsi il faut les représenter, non comme rivales, mais comme unies et complémentaires. Leur union, encore qu’on n’en aperçoive pas le principe, est un fait qu’il faut admettre avec ses conséquences. La jeunesse (et par là je n’entends pas un âge, mais une forme de tempérament) est une plasticité et une surabondance de vie qui permet à la personnalité d’avoir en même temps deux vies et de passer de l’une à l’autre sans cesser d’être et de se sentir présente tout entière en chacune. Je serais tenté de la caractériser en disant qu’elle peut se dédoubler sans se dépersonnaliser ; mais cette faculté se perd ou se transforme. Par suite de la fatigue ou de l’âge, une des deux vies devient automatique et inconsciente, elle n’est plus qu’un rôle qu’on répète, qu’une attitude où l’on se fige. L’esprit n’y a plus part, s’en retire : c’est la dépersonnalisation ou l’absence ; cet état est fréquent et tend à devenir chronique dans la vieillesse. Aujourd’hui, il m’arrive d’être distrait malgré moi, d’oublier à mesure qu’elles passent, ou délaisser passer, sans m’en apercevoir, les perceptions que je m’applique à retenir, d’accomplir, sans y penser, des actes auxquels je dois et je veux m’intéresser. Cet état est pénible, non seulement à cause des inconvénients pratiques de tout ordre auxquels il donne lieu, mais encore en lui-même. Lorsque j’essaie de le définir, il m’arrive d’y retomber, au lieu de le garder présent à ma pensée comme un objet d’étude. Tout acte d’attention, pour peu qu’il se prolonge, aboutit à cette fâcheuse torpeur qui envahit d’abord les actes habituels, puis gagne tous les actes en suivant une marche progressive qui va des réflexes à l’habitude et [p. 366] de l’habitude à la volonté. Par là je mesure la distance qui répare l’automatisme troublant et pénible. du vieillard de l’heureuse inconscience de l’enfant comme de la rêverie agréable de l’adulte. La distraction chez moi est maintenant involontaire et invincible, tandis qu’elle était autrefois un répit que je me donnais, un état auquel je ne faisais que me prêter. Et si je remonte jusqu’à mon enfance, j’envie l’écolier qui faisait de sa vie deux parts, mais trouvait moyen sans sacrifier l’une à l’autre, de fournir un travail sérieux dont il réglait le mécanisme et de suivre son penchant à la rêverie en se livrant au jeu d’une imagination active. La vie était pour lui comme un bien apprécié dont il ne laissait rien perdre, tandis qu’on dirait qu’elle est, pour moi un fardeau que je ne songe qu’à alléger, que j’abandonne de plus en plus à l’automatisme, dont je libère ainsi ma conscience et que j’arrive à ne plus sentir. L’absente s’éclaire par la dépersonnalisation. Elle est la dépersonnalisation aggravée, passée de l’état aigu à l’état chronique. C’est le même-phénomène, la dissociation du moi et de ses états, produit par la même cause, la fatigue.
Dans la dépersonnalisation et l’absence le sujet a des sensations dont il a conscience sans pouvoir les rattacher à sa personnalités Mais nous avons dit que la conscience consiste avant tout dans le sentiment du moi et que ce sentiment s’affirme dans un acte par lequel le moi prend possession de ses états. Pour croire à la réalité de cet acte, nous n’avons pas besoin d’en prendre conscience dans une expérience actuelle. Nous n’avons pas besoin non plus de pouvoir nous représenter de façon distincte en quoi physiologiquement il consiste. Il suffit que nous ayons le sentiment, quand nous voulons le produire et que nous sommes incapables de le faire, que c’est précisément cette incapacité de le produire qui nous empêche de le percevoir. Or ce sentiment existe très fort dans la dépersonnalisation, sinon dans l’absence. Le sujet s’efforce de ressaisir les sensations qui lui échappent ; ses efforts, aussi énergiques que vains, prouvent que, dans sa conviction, ils devraient aboutir, et cette conviction se fonde sur ce qu’en effet ils ont abouti en d’autres circonstances. Le sentiment de son impuissance actuelle lui rend donc le souvenir de ce qu’il a pu faire et a fait réellement autrefois. Or le souvenir, supposé exact, d’avoir accompli un acte, prouve [p. 367] évidemment la réalité de cet acte aussi bien que la conscience qu’on aurait de l’accomplir au moment où il se produit.
Resterait à expliquer pourquoi la réaction du sujet n’est pas la même dans la dépersonnalisation et l’absence. Dans l’une, il ne cède pas à son impression, il s’en étonne et y résiste ; dans l’autre, il s’y abandonne, il n’a pas la force, pas même l’idée d’aller contre. Mais au reste, l’impression, et finalement le résultat, sont identiques : le sujet ne cesse pas d’éprouver des sensations et d’accomplir des actes, mais tout cela à son insu. De là une inconscience très spéciale, qui n’a rien de commun avec les formes, d’inconscience ordinairement inconnues et classées, à savoir l’inconscience, non par anesthèse, insensibilité à l’égard des sensations et des actes, mais par anémesthèse, perte du sentiment du moi. Cette inconscience, la dépersonnalisation la réalise à l’état pur : elle est l’anémesthèse sans mélange d’anesthèse. Dans l’absence, au contraire, telle du moins qu’elle existe chez le vieillard, le diagnostic de la perte du sentiment du moi est moins aisé à établir, parce que cette perte n’est pas sentie, et elle n’est pas sentie, soit parce que ce sentiment disparaît sans qu’il y ait trace de sa disparition qui a été lente et graduelle, et par conséquent, sans qu’on cherche à en retrouver le souvenir ; soit parce que la perte de ce sentiment et l’inconscience qui en résulte est toujours alors associée à une inconscience ou insensibilité générale qui la recouvre et la dissimule.
La dépersonnalisation et l’absence, qui pour nous sont de même nature et ne diffèrent qu’en degré, ne constituent pas seulement une classe à part parmi les formes d’inconscience, mais elles accusent encore et mettent en relief le rôle important du sentiment du moi dans le phénomène de conscience, puisqu’elles montrent que, si ce sentiment vient à manquer, la conscience est profondément altérée et disparaît et qu’il en résulte des troubles graves de la personnalité (2).
L. DUGAS.
Notes
(1) Journal de Psychologie, 1936, p. 276.
(2) Tout ce qui a été dit, au cours de cette étude, des théories d’Ampère est tiré de La philosophie des deux Ampère, publiée par Barthélémy SAINT-HILAIRE, Paris, Librairie académique Didier, 2e édition, 1890.

LAISSER UN COMMENTAIRE