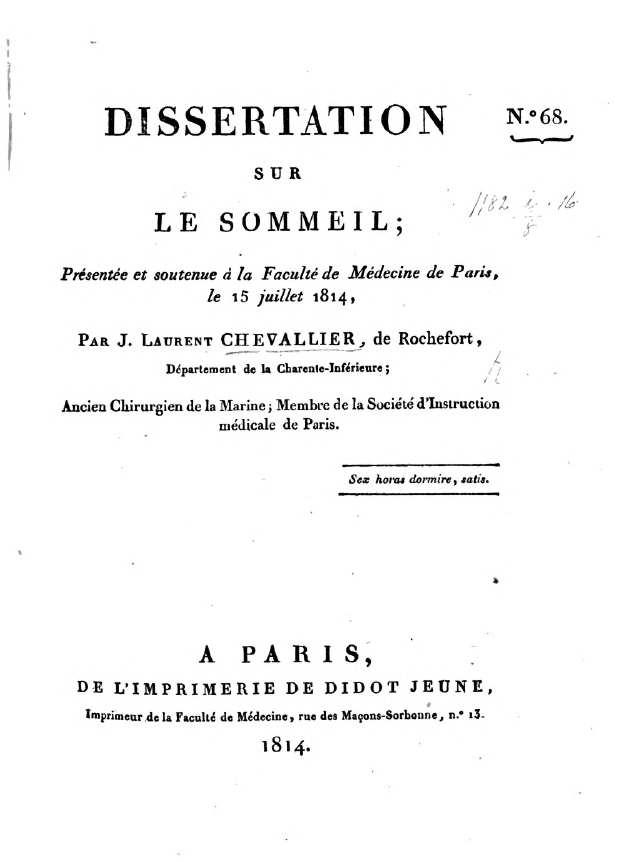 Laurent Chevallier. Dissertation sur le sommeil. Thèse n°68, présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 15 juillet 1814. Paris, de l’imprimerie de Didot jeune, 1814. 1 vol. in-4°, 17 p.
Laurent Chevallier. Dissertation sur le sommeil. Thèse n°68, présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 15 juillet 1814. Paris, de l’imprimerie de Didot jeune, 1814. 1 vol. in-4°, 17 p.
Laurent Chevalier, ancien chirurgien de la marine, membre de la Société d’Instruction Médicale de Paris.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons rectifié quelques fautes d’impression. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 5]
DISSERATION
SUR
LE SOMMEIL.
Dans les êtres organisés, tout dort, tout éprouve des intermittences de veille et d’action. Depuis l’animal jusqu’à la plante inclusivement, il n’est rien qui ne soit soumis à cette règle générale et constante ; les organes mêmes, dont l’activité paraît être permanente, ont aussi leurs instans de repos ; le cœur a ses mouvemens de systole ou de contraction ; mais ceux de diastole ou de relâchement leur succèdent. Les poumons ont aussi deux mouvemens : l’un d’inspiration, l’autre d’expiration ; et ces mouvemens correspondent par leur nature aux mouvemens alternatifs du cœur. Le tissu cellulaire, les système glanduleux et viscéral, et en général tous les organes, présentent également le passage de l’action au repos, soit que ce passage soit brusque et continuellement répété, soit qu’il n’ait lieu qu’à des intervalles périodiques et à des distances plus ou moins éloignées ; tel est, par exemple, le sommeil des parties génitales des animaux. La sensibilité elle-même, cette propriété vitale de laquelle dépendent toutes les fonctions de l’organisme vivant, la sensibilité, dis-je, se repose dans les bras du sommeil, et les grandes douleurs, qui s’apaisent et cessent tout-à-fait sans que les excitans mécaniques qui les causent cessent d’agir, en sont l’irréfragable preuve. Telles sont les douleurs causées par la présence de calculs dans les uretères ou dans la vessie, ou de tout autre corps étranger ; tels sont encore [p. 6] les états momentanés d’insensibilité dans lesquels tombaient autrefois les malheureux condamnés aux tortures iniques de la question. Leur sensibilité, accablée sous le poids des tourmens, s’endormait quelquefois sur le lit de la douleur, et se réveillait ensuite plus propre à la ressentir. Mais les organes des sens externes, c’est-à-dire ceux qui établissent nos rapports avec les corps extérieurs, présentent surtout la preuve manifeste et singulière de cette assertion ; et c’est particulièrement la suspension d’activité de ces organes qu’on a désignée sous le nom de sommeil.
Le sommeil peut donc être défini : le défaut d’activité des organes des sens ; ou plutôt, la suspension périodique et momentanée des fonctions qui établissent nos rapports avec les objets extérieurs.
Gravure vers 1860.
La cause première du sommeil n’est pas connue ; quelques physiologistes ont prétendu qu’il résultait de l’affaissement du cerveau sur lui-même, et ils ont fait observer, comme fondement de leur opinion, que la compression de cet organe suffisait pour le produire.
Les partisans du fluide nerveux ont regardé le sommeil comme le résultat de l’épuisement de ce fluide, et comme une circonstance nécessaire à sa réparation. D’autres ont imaginé le transport sur le cerveau d’humeurs propres à contrarier le jeu de ce viscère, et à déterminer la suspension de ses opérations.
D’autres enfin ont créé d’autres suppositions. Mais, sans aller chercher cette cause première dans une compression purement maladive, ou dans une métastase d’humeurs qui n’est ni véritable ni même rationnelle ; sans aller la chercher surtout dans la consommation du fluide nerveux, consommation d’autant plus hypothétique, que l’existence de ce fluide est peut-être lui-même imaginaire, ne peut-on pas expliquer ce phénomène par analogie, et ne voir dans cette inactivité des sens que le résultat d’une loi physiologique constante, qui soumet à une intermittence d’action tous les organes de l’économie ?
Quoi qu’il en soit, je ne m’appesantirai pas davantage sur l’examen [p. 7] d’une question qui, comme toutes celles qui lui sont analogues, ne peut rien présenter de certain, et par conséquent rien de bien utile et de bien intéressant ; je me bornerai seulement à examiner les circonstances propres à favoriser le sommeil, et l’influence qu’il exerce sur les fonctions vitales ou intérieures.
Circonstances favorables au Sommeil.
Il faut pour l’exercice du sommeil un état moyen entre la fatigue et l’excès d’excitation. Les hommes épuisés par de longs travaux ou par de longs voyages, ou affaiblis par de grandes maladies, ne dorment pas ; ce n’est qu’après avoir recouvré quelques forces qu’ils parviennent à goûter les douceurs du sommeil. On a aussi justement observé que les méditations profondes, imprimant au cerveau de fortes vibrations qui persistent malgré la cessation du travail de l’âme, produisent également l’insomnie.
Une lassitude modérée, un certain degré de faiblesse, sont donc ici des circonstances favorables, et même indispensables. La plénitude de l’estomac, le travail de la digestion, les liqueurs enivrantes, les narcotiques, qui appellent et concentrent la sensibilité vers la région épigastrique, sont aussi capables de disposer à la somnolence, en enlevant aux organes des sens la somme de vie nécessaire à l’entretien de leur activité. Mais parmi toutes les causes propres à déterminer le phénomène vital dont nous nous occupons, le silence et l’obscurité exercent surtout une puissante influence.
En effet, ces deux états, enlevant à l’œil et à l’oreille leurs excitans naturels, et les privant ainsi des impressions continuelles qui entretiennent leur activité, bientôt ces organes cessent d’agir, s’endorment, et font ensuite partager sympathiquement leur état à ceux du goût, de l’odorat et du toucher. C’est ainsi qu’en émoussant l’excitabilité des sens, et les mettant dans l’impossibilité de réagir sur les corps extérieurs et de les apprécier, l’ennui prive le cerveau des sensations qu’il pourrait en recevoir, et par cela même [p. 8] produit le sommeil. C’est encore ainsi qu’un bruit monotone, tel que le murmure d’un ruisseau, la chute continuelle de l’eau d’une gouttière, finissent par endormir l’oreille elle-même, qui s’habitue, aux impressions qu’elle reçoit de ces objets, et n’en est plus par conséquent suffisamment excitée.
L’air frais, le froid, les saignées, et tous les autres moyens propres à faire converger la circulation, c’est-à-dire à la rendre plus active de la circonférence au centre, appellent et favorisent le sommeil.
Il est également déterminé par la chaleur, les bains tièdes, les hypnotiques, et toutes les causes propres à diminuer la susceptibilité nerveuse en général, et l’impressionnabilité des sens en particulier. Enfin il est encore produit par l’ivresse, les purgatifs, la copulation, et tout ce qui peut, en concentrant la vie sur un point quelconque, diminuer le degré d’énergie du cerveau.
Ici je ne peux manquer de faire observer que le café et les liqueurs spiritueuses produisent un effet tout contraire lorsqu’on en use avec sobriété; parce qu’alors ces moyens n’ont point assez de force pour concentrer la vie dans un seul foyer ; mais que, par une excitation modérée, ils élèvent le ton de toutes les fibres, et excitent principalement les vibrations de l’organe cérébral. De là cette liberté d’esprit, cette gaieté folle et ces saillies brillantes qui suivent ordinairement le dessert, et contre-balancent avec avantage la somnolence que la plénitude de l’estomac devrait naturellement produire.
Je suis loin de ranger ici parmi les causes du sommeil la compression du cerveau; cette compression, comme l’a judicieusement observé M. le professeur Richerand, ne produit point le sommeil, mais bien un état maladif qu’il faut se garder de confondre avec ce dernier.
Ce n’est pas même en déterminant le reflux du sang vers la tête que la plénitude de l’estomac dispose à la somnolence ; on peut présumer au contraire que la circulation est activée dans l’estomac, [p. 9] et par le développement de ses parois, et par la concentration de vie qui s’y fait aux dépens de tous les autres organes. Cette supposition même cesse d’en être une, si l’on observe le frisson et le serrement du pouls qui précèdent et accompagnent ordinairement la digestion ; cela est prouvé par les indigestions dont meurent quelquefois les convalescens : chez eux, l’estomac a tellement d’activité, que la première digestion s’y opère, et qu’à l’ouverture des cadavres on trouve cet organe entièrement vide, tandis que les intestins grêles sont remplis de matières chymeuses.
De ce que j’ai dit des circonstances propres à favoriser le sommeil, il paraîtrait résulter (et même on l’a pensé) que, si l’on excitait continuellement les organes des sens, on les entretiendrait dans une veille constante, et que l’éloignement matériel de nos sensations tend seul à nous plonger dans les bras du sommeil. Mais cette proposition n’est vraie que jusqu’à un certain point ; car il arrive un moment où nos sens peuvent être tous à la fois excités, sans que nous puissions nous soustraire à l’empire du sommeil : c’est ce qu’on observe dans les assemblées les plus brillantes, même pendant les concerts les plus harmonieux, auprès des tables les mieux fournies, dans les lieux où sont répandus les parfums les plus suaves. On s’endort même au bruit du canon et au son de la musique guerrière.
Convenons qu’excepté les besoins essentiels et indispensables, tout dans l’économie est soumis aux influences puissantes de l’habitude ; et de même que l’estomac, à certaines heures fixes et habituelles, fait éprouver la sensation de la faim, de même le cerveau et les organes des sens ressentent, à des intervalles égaux et accoutumés, les besoins du sommeil. « Plus il est régulièrement périodique, a dit Cabanis, plus l’assoupissement est facile ; et se coucher et s’endormir tous les jours aux mêmes heures, est une circonstance qui favorise singulièrement son retour. »
La durée du sommeil est, comme l’ont observé plusieurs auteurs, du quart, et même du tiers de la journée ; et l’École de Salerne assigne à peu près cet espace à six heures. [p. 10]
On a remarqué cependant que le besoin et la durée de cette fonction varient suivant l’âge, le sexe, et les habitudes des individus. Chez les enfans, par exemple, la durée du sommeil semble se prolonger en raison directe de la proximité de leur naissance, tandis que le repos des vieillards est d’autant plus court et plus interrompu, qu’ils sont plus près du terme de leur existence ; « comme si les enfans, a dit le célèbre Grimaud, pressentaient que dans la longue carrière qu’ils doivent parcourir ils ont assez de temps pour déployer les actes de la vie ; et que les vieillards, près de leur fin, sentissent la nécessité de précipiter la jouissance d’un bien qui leur échappe. Mais cette opinion, qui n’est, comme l’observe M. le professeur Richerand, que le développement d’une idée de Staahl, et la conséquence de sa séduisante théorie, paraît beaucoup plus ingénieuse que vraie ; et le physiologiste moderne que je viens de citer cherche à nous donner une explication plus satisfaisante de ce phénomène. « Si le sommeil de l’enfant, écrit-il dans sa Physiologie, est si long, si profond et si tranquille, cela doit être attribué à la prodigieuse activité des fonctions assimilatrices, et peut-être à l’habitude qu’il a du sommeil, puisque cet état est celui dans lequel il a passé les neuf premiers mois de sa vie, ou tout le temps qui a précédé sa naissance. Dans un âge avancé, les fonctions intérieures languissent ; leurs organes n’appellent point l’attention du principe de la vie ; le cerveau est d’ailleurs tellement surchargé d’idées acquises, qu’il est presque toujours éveillé par elles. »
Quelque ingénieuse que soit encore cette explication, elle prouve l’esprit fécond de son auteur, sans cependant satisfaire la raison sur la véritable cause dont il s’agit. En effet, l’état dans lequel se trouvent les organes des sens chez le fœtus ne peut point être comparé au sommeil ; ces organes ne se reposent pas, puisqu’ils n’ont jamais agi. Mais, quelque temps après la naissance, les enfans sont d’autant plus étonnés, que tout est nouveau pour eux ; la plus petite cause, la plus légère impression les excite vivement, parce que toutes ces [p. 11] impressions sont nouvelles, et que par conséquent l’habitude n’a pu encore en émousser aucune. Aussi les organes sont-ils continuellement en action ; l’enfant agite sans cesse ses petites mains ; ses yeux s’occupent tour à tour de tous les objets qui les frappent ; ses oreilles s’érigent, pour ainsi dire, pour recevoir plus de rayons sonores ; il porte continuellement à sa bouche les corps que ses mains ont saisis ; enfin tous les objets qu’il rencontre sont successivement soumis au jugement de chacun de ses sens ; et dès-lors ceux-ci, devant être d’autant plutôt fatigués qu’ils ont moins acquis l’habitude du travail auquel on les soumet, éprouvent un besoin de sommeil dont la durée se proportionne à celle de leur existence.
Chez les vieillards, au contraire, les sens ne sont plus ébranlés que par de fortes impressions, et ils veillent plus long-temps, par cela même que la veille n’est plus pour eux un travail.
La femme, qui, sous le rapport de sa constitution physique et de son inconstance morale, se rapproche beaucoup de l’état de l’enfant, présente la même différence que lui ; et j’oserais avancer que cette analogie, qui contredit au moins les opinions précédentes, semble donner à cette dernière un certain degré de solidité.
Ce serait ici le cas de s’occuper de la durée du sommeil chez les divers peuples, et même chez les diverses espèces d’animaux, en parcourant toute la chaîne des êtres vivans. Mais, outre qu’une telle recherche serait trop au-dessus de mes forces, je pense que le résultat de ce travail serait beaucoup plus curieux qu’utile. Je me bornerai donc à faire remarquer qu’abstraction faite d’une disposition propre et originelle, deux circonstances particulières semblent produire le sommeil long, profond, et même léthargique, qui caractérise certains peuples et certaines classes d’animaux : ces deux circonstances sont le froid et l’habitude. Qui peut, en effet, plus qu’un froid rigoureux engourdir, paralyser les extrémités sentantes des nerfs, et enlever ainsi aux organes des sens leur vigueur et leur susceptibilité ? N’est-ce pas dans le nord et dans les climats glacés qu’on rencontre toutes les familles d’animaux dormeurs, et ces peuplades entières qui ne veillent [p. 12] que le temps nécessaire pour s’occuper de leur subsistance ? Qui peut encore plus que l’habitude du sommeil en augmenter le besoin ? Son excès produit la stagnation des fluides et leur épaississement ; il produit aussi les engorgemens lymphatiques, les maladies des glandes, l’asthénie musculaire, les affections scorbutiques, la diminution d’activité du cerveau ; il altère et paralyse par conséquent les facultés intellectuelles, amène l’idiotisme. Et qui pourrait maintenant refuser d’admettre, avec tous ces inconvéniens, l’apathie toujours croissante des organes sensoriaux ?
Quand on a exercé quelque temps dans les grands hôpitaux, et qu’on a vu les malades et les maladies d’un œil observateur, on ne peut s’empêcher de croire que les affections scorbutiques si communes dans ces lieux de tristesse et de douleurs, sont en partie dues à l’abus que font du sommeil les malheureux que la misère, la débauche et la fainéantise forcent de recourir à cette triste ressource. Plusieurs individus, n’ayant d’autre maladie que la paresse, apportent avec eux un appétit que l’ordinaire des malades est loin de satisfaire ; ils s’endorment dans l’espoir de tromper leur estomac : bientôt ces deux causes coïncident pour produire un épuisement que la débauche ou la misère a commencé ; et c’est ainsi que, dans l’établissement où les vrais malades vont chercher des remèdes et la guérison, ces malheureux ne trouvent qu’une source nouvelle de calamités.
M. le professeur Richerand parle, dans sa Physiologie, d’un homme atteint d’une sorte d’imbécillité, et qui entra à l’hôpital du Nord pour la curation de quelques glandes scrofuleuses. Pendant l’espace de dix-huit mois qui s’écoula depuis son entrée à l’hôpital jusqu’à l’instant où M. le professeur Richerand publia son observation, ce malade est resté constamment au lit, dormant les cinq sixièmes de la journée, tourmenté par une faim dévorante, et passant à manger ses courts instans de veille. Ses digestions étaient toujours promptes et faciles ; il conservait de l’embonpoint, quoique l’action musculaire fût extrêmement languissante ; le pouls fut toujours [p. 13] très-lent et très faible, et les affections morales du sujet étaient bornées au désir des alimens et du sommeil.
Un homme de soixante-quatorze ans fut traité, il y a plusieurs années, dans un des hôpitaux de Paris, d’une fracture à la rotule, qu’une chute de sa hauteur avait déterminée. La vieillesse de cet homme et son indocilité empêchèrent la réduction de la fracture, et à plus forte raison les moyens propres à la maintenir réduite. Il fut donc entièrement abandonné à la nature. Dès-lors la jambe du côté de la fracture, obéissant à la rétraction musculaire, se fléchit sur la cuisse, celle-ci sur le ventre, et cette attitude fut bientôt sympathiquement partagée par la jambe et la cuisse du côté opposé. Dans cet état, le lit étant sa seule ressource, il s’est insensiblement accoutumé au sommeil, au point que, trois mois après son entrée à l’hôpital, il ne s’éveillait que pour manger, et ne cessait de manger que pour s’endormir de nouveau.
Mais je me suis assez étendu sur les dangers de l’abus du sommeil, et sur l’influence que l’habitude peut exercer sur sa durée ; il faut maintenant convenir que l’abus de la veille est également accompagné de graves inconvéniens ; car quoiqu’on ne puisse, comme je l’ai observé, triompher absolument du sommeil, cependant on peut le combattre plus ou moins long temps, et à l’aide de moyens excitans et d’efforts soutenus affaiblir son empire sur les sens, diminuer la longueur de ses périodes et en éloigner le retour ; mais alors ce combat continuel qu’on livre imprudemment à la nature donne lieu à des névroses, aux troubles des facultés intellectuelles, aux maladies aiguës, tantôt inflammatoires, tantôt adynamiques, et enfin à toutes les anomalies de la sensibilité : de là cette foule d’affections de tous les genres, surtout nerveuses, qui affligent ordinairement les gens de lettres, et qui, suivant le témoignage de Tissot, sont le résultat de leurs veilles et de leurs travaux.
J’ai défini le sommeil le défaut d’activité des organes des sens, ou plutôt la suspension périodique et momentanée de l’ensemble des fonctions qui établissent nos rapports avec les objets extérieurs. Cette [p. 14] définition me paraît exacte, et caractériser fidèlement le sommeil, puisqu’elle convient également à son état naturel et le plus ordinaire, et aux anomalies qu’il présente chez les somnambules.
Influence du Sommeil sur les fonctions intérieures.
Le repos plus ou moins complet des sens n’est pas la seule chose remarquable que le sommeil présente à l’observation du physiologiste. L’examen le plus superficiel suffit pour démontrer encore les puissantes modifications qu’il fait éprouver à toutes les fonctions intérieures.
Le père de la médecine, dépourvu des lumières que la science de l’anatomie a dû nécessairement répandre sur celle de la physiologie, n’ignorait point cette influence du sommeil sur l’action des organes internes, puisqu’il a dit : Somnus labor visceribus ; et qu’ailleurs il dit encore : Motus in somno intro vergunt. En effet, dans le sommeil, les forces se dirigent de la circonférence au centre, les fonctions assimilatrices sont en général plus actives, la respiration moins fréquente, mais plus profonde et plus égale. Les organes des sens et de la locomotion ne consomment plus ; la somme de vie est dirigée toute entière au bénéfice des fonctions intérieures ou assimilatrices ; d’un autre côté, l’état de repos des organes de la vie animale, étant peu propre à favoriser la circulation dans leur tissu, contribue beaucoup à la rendre plus active dans ceux de la vie organique : de là le mouvement circulatoire, plus énergique dans les viscères que dans le système musculaire ; et de là également la faiblesse et la lenteur du pouls, qui, dans ce cas, ne caractérise pas l’affaiblissement de la circulation générale, mais seulement celui de la circulation partielle de la circonférence et des extrémités ; et si on objecte ici que la circulation dépend uniquement de l’impulsion du cœur, est par conséquent égale partout, certes j’aurai une arme victorieuse à employer en citant les fièvres locales, les phlegmasies [p. 15] circonscrites qui développent l’énergie de la circulation dans les parties qu’elles occupent, au point de rendre les mouvemens de systole et de diastole sensibles dans les rameaux capillaires.
Le sommeil active aussi la digestion ; il ne diminue pas, ou au moins il diminue fort peu la sécrétion des urines, mais il en retarde l’excrétion ; enfin il augmente la force absorbante des pores inhalans, et l’absorption des miasmes contagieux devient plus à craindre ; soit qu’en effet cette fonction soit plus active, soit que l’état d’engourdissement de la peau et des extrémités sentantes des nerfs s’oppose moins à l’action délétère des miasmes. Les effets débilitans de la peau, et des passions tristes semblent même donner un certain poids à cette dernière supposition.
Le sommeil diminue-t-il la chaleur ? Cette question a été affirmativement décidée par quelques physiologistes ; et Tissot observe à cet égard qu’un homme qui s’endort en plein air quand le thermomètre est à 8 ou 9 degrés au-dessous de zéro, y meurt ordinairement, tandis que l’homme en action peut soutenir un froid de 50 degrés et au-delà. Malgré cette observation dont on ne peut contester la justesse, il est cependant raisonnable de croire que la chaleur n’est pas diminuée d’une manière absolue, mais seulement d’une manière relative, c’est-à-dire que la même somme de chaleur existe, mais qu’elle n’est pas uniformément répartie, et que, concentrée à l’intérieur et dans le système des viscères, elle abandonne presque entièrement la périphérie du corps, et le laisse ainsi soumis à l’influence, devenue plus funeste, des corps extérieurs, et surtout du froid. A moins d’expliquer ainsi ce phénomène, il serait difficile de le concevoir, si l’on observe que les connaissances chimiques modernes présentent la respiration comme la source directe de la chaleur, qui devient d’autant plus élevée, que les fonctions des poumons sont plus actives, et qu’enfin l’analogie vient à l’appui de ce principe, puisque dans les animaux, et surtout dans les oiseaux, l’augmentation de la chaleur est toujours en raison directe du volume des organes de la respiration. [p. 16]
Quelques auteurs ont avancé que le sommeil était l’image de la mort ; mais il s’en faut que cette image soit fidèle, et même que la vie soit purement végétative ; car, pendant le sommeil, non-seulement les fonctions des organes assimilateurs continuent de s’opérer, mais l’âme veille encore ; et si les sens externes ne lui transmettent plus de nouvelles impressions, l’imagination et la mémoire y suppléent. A l’aide de ces deux facultés, elle donne naissance à la troupe légère des songes, tantôt en combinant et associant par le moyen de la première les idées bizarres et les plus disparates ; tantôt en se reposant sur la seconde pour rappeler les idées les plus voluptueuses ou les plus pénibles ; et quelque chimériques que soient les causes des songes, ceux-ci n’en produisent pas moins des sensations réelles dont l’effet peut être plus ou moins prolongé ; tels sont, la fatigue qui succède au sommeil que des rêves effrayans ont agité, et l’état délicieux que nous ressentons au contraire lorsque des songes voluptueux nous ont fait passer par tous les degrés du plaisir.
Ovide, dans ses Métamorphoses, fait couler le fleuve d’Oubli autour du palais du sommeil. Cette idée est ingénieuse sans doute, puisqu’elle peint le repos des sens, non-seulement comme le réparateur de nos forces physiques, mais encore comme le consolateur de nos afflictions en en effaçant le souvenir. Mais cependant l’idée d’Ovide n’est pas constamment ni rigoureusement vraie ; et si, en cédant au sommeil, on perd jusqu’à l’idée de l’existence, très-souvent aussi les idées les plus fixes et les plus durables viennent dans les songes rappeler pendant le sommeil nos peines et nos plaisirs ; car, pendant le sommeil, l’âme peut, à l’aide de la mémoire, rappeler les impressions antérieures, selon qu’elles nous ont affectés plus ou moins vivement ; tantôt, en y joignant encore le secours de l’imagination, elle combine les impressions diverses et opposées, et forme ainsi l’assemblage le plus bizarre, le plus disparate et le plus ridicule. Ce travail constitue les songes, dont je ne m’occuperai pas, devant terminer au plus vite un opuscule que mon temps et mes connaissances ne me permettent pas de rédiger exactement.


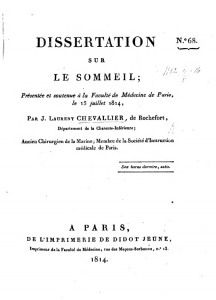
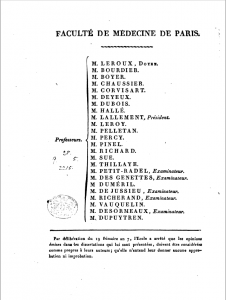
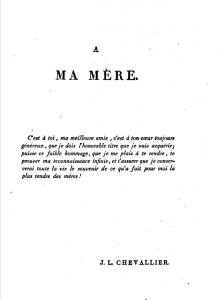

LAISSER UN COMMENTAIRE