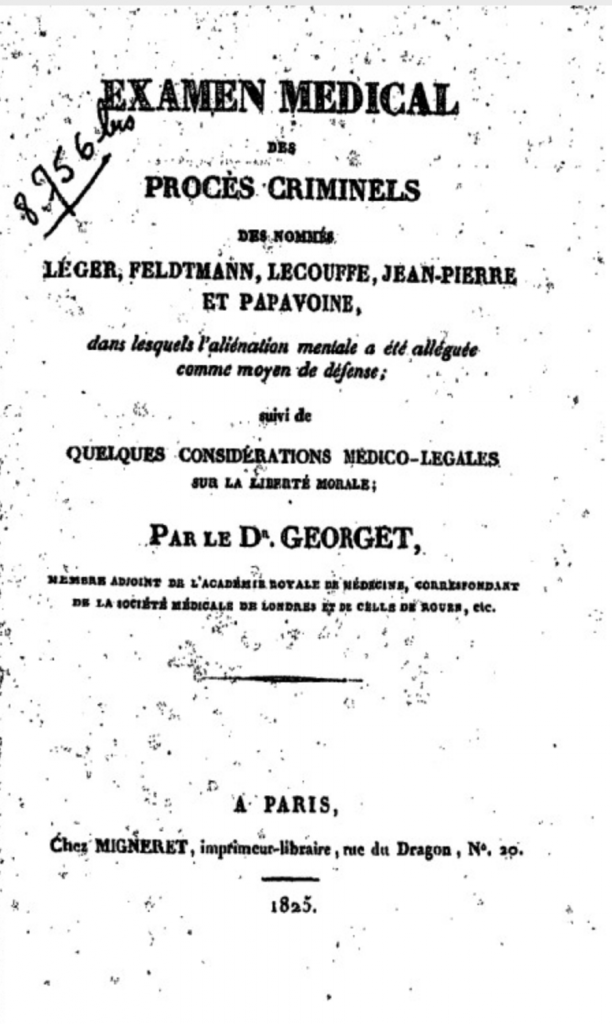 Étienne Georget. Examen médical des procès criminels des nommés LÉGER, FELDTMANN, LECOUFFE, JEAN-PIERRE PAPAVOINE, dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense. Extrait des « Archives générales de médecine », (Paris), 3e année, tome VIII, 1825, pp. 149-214.
Étienne Georget. Examen médical des procès criminels des nommés LÉGER, FELDTMANN, LECOUFFE, JEAN-PIERRE PAPAVOINE, dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense. Extrait des « Archives générales de médecine », (Paris), 3e année, tome VIII, 1825, pp. 149-214.
Un texte princeps puisque ici Georget, par l’analyse de cinq homicides, démontre que les juges doivent absolument prendre l’avis d’un médecin pour différencier les meurtriers des malades atteints de monomanie homicide. Dès l’année suivante, des médecins furent appelés à la barre, dans les cas douteux. Il introduit ainsi la notion psychiatrie médico-légale.
Etienne-Jean Georget (1795-1828). Médecin aliéniste élève de Philipe Pinel et Jean-Étienne-Dominique Esquirol. Il est connu pour ses écrits en psychopathologie, et aussi pour avoir demandé à Théodore Géricault de faire des toiles sur le thème de la folie.
Quelques publications :
— Nouvelle discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, suivie de l’examen de plusieurs procès criminels dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense, par le Dr Georget,… (1828
— De la folie (1820)
— De la Physiologie du système nerveux et spécialement du cerveau, recherches sur les maladies nerveuses en général et en particulier sur le siège, la nature et le traitement de l’hystérie, de l’hypochondrie, de l’épilepsie et de l’asthme convulsif, par M. Georget,… (1821).
— De la folie ou aliénation mentale. « Extrait du Dictionnaire de médecine », (Paris), 1823, et tiré à part : Paris, Rignoux, 1823, 1 vol. 89 p.
— De l’Hypochondrie et de l’hystérie, Paris, J.-B. Baillière, (1825).
— Quelques considérations médico-légales sur la liberté morale. Extrait des « Archives générales de médecine », (Paris), 3e année, tome VIII, 1825, pp. 317-383.
— Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale. Paris, impr. de Migneret , 1826 . 1 vol. 176 p
— Des Névroses ou maladies nerveuses, par le Dr Georget,… (1826).
— Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, par le Dr Georget,… (1826)
— Examen médical des procès criminels des nommés Léger, Feldmann, Lecouffe, Jean-Pierre et Pavoine, dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense ; suivi de quelques considérations médico-légales sur la liberté morale. Paris, Migneret, 1825. 1 vol. in-8°, 4 ffnch., 132 p.
— Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, suivie de l’examen du procès criminel d’Henriette Cornier, et de plusieurs autres procès dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense. Paris, Migneret, 1826. 1 vol. in-8°, 2 ffnch., 176 p.
— EXTASE. Extrait du « Dictionnaire de Médecine – s. l. d. Adelon », (Paris), tome huitième, ENC-FIE, p. 436. [en ligne sur notre site]
Examen médical des procès criminels des nommés LÉGER, FELDTMANN, LECOUFFE, JEAN-PIERRE PAPAVOINE, dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense par M. GEORGET.
Nous publions ce travail dans le but unique d’être utile à la société, en éclairant les hommes qui sont appelés à juger leurs semblables sur une maladie encore peu connue
dans quelques-unes de ses variétés. C’est surtout en présentant des exemples, où des erreurs ont été commises, que l’on peut à la fois signaler les circonstances qui ont pu en imposer, et la route à suivre pour éviter de retomber dans, de pareilles fautes. Au reste , nous avons exposé les faits avec impartialité, nous les avons discutés avec bonne-foi ; chacun pourra faire la même étude que nous, et vérifier, si’ nos conclusions sont justes. [p. 150]
Procès de LÉGER (1).
Antoine Léger, âgé de 29 ans, vigneron, ancien militaire, est traduit devant la Cour d’assises de Versailles, le 23 novembre 1824, accusé : 1° de soustraction frauduleuse de légumes faite la nuit dans un jardin ; 2° d’attentat à la pudeur avec violence, sur la personne de la jeune Debully, âgée de 12 ans et demi ; 3° d’avoir commis volontairement, avec préméditation et de guet-apens, un homicide sur la personne de ladite Debully ; 4° d’avoir caché le cadavre de cette enfant.
Voici un extrait de l’acte d’accusation :
« Léger, dès sa jeunesse, a toujours paru sombre et farouche ; il recherchait habituellement la solitude, et fuyait la société des femmes et des jeunes garçons de son âge. Le 20 juin 1823, il quille la maison paternelle, sous prétexte de chercher une place de domestique, n’emportant avec lui qu’une somme de 50 fr. et les habits qu’il portait sur lui. Au lieu de rentrer chez lui , il gagne un bois, distant de plusieurs lieues, le parcourt pendant huit jours pour y chercher une retraite, et au bout de ce temps découvre une grotte au milieu des rochers, de laquelle il fait sa demeure; un peu de foin compose son lit. Pendant les 15 premiers jours, il dit avoir vécu de racines, de pois, d’épis de blé, de groseilles et d’autres fruits qu’il allait cueillir sur la lisière des bois; une nuit il alla voler des artichauts ; ayant un jour pris un lapin sur une roche, il l’a tué et mangé cru sur-le-champ : mais pressé par la faim, il alla plusieurs fois à un village voisin pour y acheter quelques livres de pain et du fromage de Gruyère. »
« Cependant, au milieu de la solitude, de violentes passions l’agitaient ; il éprouvait en même temps l’horrible [p. 151] besoin de manger de la chair humaine, de s’abreuver de sang (c’est toujours ce monstre qui parle). Le 10 août, il aperçut près de la lisière du bois une petite fille, il court à elle, lui passe un mouchoir autour du corps, la charge sur son dos , et s’enfonce à pas précipités dans le bois ; fatigué de sa course, et s’apercevant que la jeune fille est sans mouvement, il la jette sur l’herbe. L’horrible projet que ce cannibale avait conçu, le forfait qu’il avait médité s’exécutent. La jeune D. est sans vie ; le tigre a eu soif de son sang ; ici notre plume s’arrête, le cœur saigne, l’imagination s’épouvante devant une série de crimes que pour la première fois la barbarie, la férocité, ont enfantés ; le soleil n’avait pas été témoin d’un pareil forfait, c’est le festin d’Atrée (ici l’acte d’accusation retrace les détails relatifs au viol, à la mutilation des organes génitaux et à l’arrachement du cœur, détails que ne rapportent point les journaux). Léger emporte ensuite le corps de sa victime et l’enterre dans sa grotte. »
« Léger fut arrêté trois jours après avoir commis le crime. Aussitôt il déclare son nom, le lieu de son domicile, dit qu’il a quitté par un coup de tête son pays et sa famille, et que depuis un jour et demi il se promenait dans le bois, ne sachant où il portait ses pas, et allant où son désespoir le conduisait. Amené devant l’adjoint delà commune, il se donne pour un forçat évadé, raconte comment il prétend avoir rompu sa chaîne à Brest, et s’être enfui par-dessus les remparts. Ses récits étaient contradictoires et remplis d’invraisemblance ; on le livre à la gendarmerie. Dans la prison, il dit comment il a vécu dans les bois et dans le creux des rochers, ne mangeant que des pois, des artichauts, du blé, etc. ; des indices semblent le désigner comme l’auteur du crime ; il nie d’abord, plusieurs interrogatoires sont sans résultat. Mais au moment où il fut confronté avec le cadavre, un médecin qui était présent, apercevant que Léger était [p. 152] pâle, décoloré, et que sa contenance démentait ses dénégations, lui dit : Malheureux, vous ayez mangé le cœur de cette infortunée, nous en avons la preuve ; avouez la vérité ; Il a répondu alors en tremblant : oui, je l’ai mangé, mais je ne l’ai pas mangé tout-à-fait ; il ajoute que l’enfant était mort tout de suite. Dès-lors il ne. cherche plus à rien taire, il reprend tout son sang-froid et déroule lui-même la série des crimes dont il s’est rendu coupable ; il en révèle jusqu’aux moindres circonstances ; il en produit les preuves, il indique à la justice et le théâtre du forfait et la manière dont il a été consommé ; le juge n’a plus besoin d’interroger ; c’est le criminel qui parle. »
« Depuis le jour où il a tout avoué, Léger a conservé un sang-froid épouvantable ; on lui a rappelé toutes les circonstances du crime, et un oui, prononcé avec indifférence, a été sa seule réponse à toutes les questions qu’on lui a adressées. »
Arrivé à l’audience, on remarque que ses traits présentent. l’apparence du calme, et de la douceur, ses regards sont hébétés, ses yeux fixes, sa contenance immobile ; il conserve la plus profonde impassibilité; seulement un air de gaité et de satisfaction règne constamment sur son visage. Pendant la lecture de l’acte d’accusation ,Léger a conservé un maintien dont il est impossible d’exprimer l’imperturbable tranquillité ; un sourire stupide,, qui n’est qu’un mouvement convulsif, erre sur ses lèvres ; ses yeux, presque continuellement baissés, se portent de temps à autre sur les vêtemens de sa victime, sur le bâton et sur le couteau qui lui ont servi à commettre le crime ; pendant cet épouvantable récit, la figure de Léger, loin de manifester la moindre émotion, semble encore s’épanouir davantage.
Voici un certain nombre des réponses de Léger.
- Pourquoi avez-vous quitté vos parens ?
- Parce que j’étais malade ; j’avais un rhume, et [p. 153] j’étais attaqué de la pierre ; je n’avais plus la tête à moi ; cette maladie mentale provenait d’un rhume qui m’avait donné la pierre.
(Le président fait remarquer que les Docteurs n’ont découvert aucun signe de la pierre).
Il dit que c’est le désespoir qui l’a conduit dans la roche de la Charbonnière ; qu’il avait le cerveau vide ; qu’il éprouvait des désirs sans vouloir les satisfaire.
- Pendant que vous, étiez dans les bois, n’avez-vous pas rencontre une femme de 6o ans environ.
- Je ne me le rappelle pas.
- Cependant une femme âgée, que vous avez effrayée par vos questions et votre air agité, a feint d’appeler un homme endormi près de là, et vous vous êtes retiré aussitôt ; une autre fois vous avez rencontré une jeune femme de 20 ans, et vous l’avez, insultée par vos gestes et vos paroles ?
- Je ne m’en souviens pas du tout.
- N’avez-vous pas eu plusieurs fois l’idée d’entraîner quelque femme dans la roche de la Charbonnière, qui est une caverne énorme, surmontée d’un bois ?
- J’en ai eu l’idée,, mais je ne l’ai pas fait.
- Vous avez dit dans l’instruction que vous craigniez la résistance d’une femme adulte ; vous craigniez aussi que ses cris appelassent les passans ?
- Oui, Monsieur.
- Le 10 août, vous avez passé par une brèche pour entrer dans le jardin d’Itteville, et y prendre quelques artichauts ?
- J’ai pris aussi des oignons et quelques épis de blé.
- Vous mangiez donc le grain tout cru y après l’avoir dépouillé de son enveloppe ?
- Oui, Monsieur.
- Vous avez bouché une des issues de la caverne ?
- Oui de crainte qu’il ne vînt de l’air. [p. 154]
- Reconnaissez-vous le morceau de grès sur lequel vous avez affilé votre couteau ?
- Oui, mais le morceau était plus gros que ça.
- Répétez de vous-même ce que vous avez fait le 10 août ?
- J’étais allé pour cueillir des pommes : j’ai aperçu au bout du bois, une petite fille assise ; il m’a pris idée de l’enlever ; je lui ai passé mon mouchoir autour du cou, et l’ai chargée sur mon dos, elle n’a jeté qu’un petit cri. J’ai marché à travers du bois, et me suis trouvé mal de faim, de soif et de chaleur. Je suis resté peut-être une demi-heure sans connaissance , la soif et la faim m’ayant pris trop fort, je me suis mis à la dévorer…
- Dans quel état était alors la petite fille ?
- Sans mouvement : elle était morte ; je n’ai essayé que d’en manger, et voilà tout.
L’accusé se renferme dans une dénégation formelle, sur tout ce qui est relatif au viol. L’accusé était convenu qu’ayant ouvert le corps de l’infortunée créature, et voyant sortir le sang en abondance, il y désaltéra sa soif exécrable ; et, poussé , dit-il, par le malin esprit, qui me dominait, j’allai jusqu’à lui sucer le cœur.
L’accusé : Je n’ai rien dit de tout cela à MM. les juges, qui ont écrit tout ce qu’ils ont voulu.
A d’autres questions, Léger répond avec un inconcevable sang froid : je n’y ai pas fait attention,… d’ailleurs, je suis tombé en faiblesse, et me suis trouvé mal.
Je n’ai fait tout cela, dit-il plus loin, que pour avoir du sang…. je voulais boire du sang… j’étais tourmenté de la soif ; je n’étais plus maître de moi.
- N’avez-vous pas détaché avec votre couteau le cœur de votre victime ?
- Je l’ai tâté un peu avec mon couteau, et je l’ai percé.
Il dit qu’après avoir enterré les restes du cadavre [p. 155] près de la grotte, il quitta ce lieu, parce qu’il y avait près de lui des pies qui croassaient, et qu’il croyait être là pour le faire prendre; il n’avait plus la tête à lui ; il est allé passer la nuit dans une grotte plus bas, sans pouvoir dormir. Le lendemain, il s’en alla à travers champs, par-dessus les montagnes; quand je voyais quelqu’un d’un côté, dit-il, je m’en allais de l’autre ; je me suis lavé la figure sur les rochers ; j’ai lavé aussi ma chemise, j’en ai coupé le col et les manches qui étaient ensanglantées.
- Lorsque vous avez été arrêté , vous avez dit que vous aviez été condamné à 20 ans de fers, et que vous vous étiez évadé ?
- C’est possible.
L’accusé reconnaît et désigne le mouchoir avec lequel il a entraîné la jeune fille après l’avoir tordu, et en le tenant par les extrémités.
- Que vouliez-vous faire de cette enfant ?
- Je n’avais pas de connaissance ; j’étais poussé par le malin esprit.
La chemise saisie sur l’accusé, toute sale, encore ensanglantée et couverte de déchirures, lui est présentée. Cet aspect ne le fait pas un seul instant sourciller.
Après la déposition du père de la jeune fille, à cette question du Président : vous avez privé ce malheureux père d’une fille chérie, d’une fille sur laquelle vous avez exercé tous les genres de crimes ! Qu’avez-vous à dire ?
L’accusé répond : que voulez-vous que j’y fasse.
Plusieurs personnes qui ont rencontré Léger, dans la campagne voisine des rochers qu’il habitait, disent qu’il avait un air effrayant.
Après la déposition de la mère , le président demande à l’accusé ce qu’il a à dire ? Il commence à pleurer, et répond : je suis fâché de l’avoir privée de sa fille ; je lui en demande bien pardon. Après ce peu de mots, la figure de Léger reprend l’expression quelle avait une minute auparavant. [p. 156]
Après la déposition d’un épicier qui avait vendu du fromage à-Léger, celui-ci dit : il y a encore une chose que le témoin ne rappelle pas ; je lui ai acheté des dragées. L’épicier en convient. Ce témoin là est le plus franc de tous, répond Léger.
- N’achetiez-vous pas des dragées, afin de les offrir aux jeunes femmes que vous vouliez attirer dans votre retraite.
- Non, Monsieur ; c’était pour moi.
- Il est assez extraordinaire que vous ayez eu envie de manger des dragées, vous qui ne vous nourrissiez que de racines et de fromage.
- C’est une idée qui m’est venue comme çà.
Léger a constamment répondu avec le sourire sur les lèvres et l’apparence de la gaîté.
- le Procureur du Roi soutient que Léger avait la conscience de son crime ; il le prouve par les précautions qu’il a prisés pour en cacher les traces, par l’horreur que lui inspirait la caverne, par l’insomnie et les remords qui le tourmentaient, selon ses propres aveux. Un insensé, dit-il, aurait dormi auprès de sa victime ; mais Léger a été forcé de s’enfuir ; il lui semblait que les oiseaux funèbres lui reprochaient sa cruauté. »
Le défenseur de l’accusé, nommé d’office, après avoir fait observer que la raison se refuse de croire à l’énormité d’un semblable attentat, dans un homme qui jouirait de toutes ses facultés intellectuelles, a soutenu que Léger était privé de sa raison, que les habitudes vicieuses qu’’il avait contractées, que la fuite de chez ses parens, que le genre de vie qu’il menait, prouvaient évidemment celle absence de raison.
Sur la demande expresse du défenseur, le président a posé la question de démence.
Après une demi-heure de délibération, le jury a résolu affirmativement les questions de vol, d’attentat à la [p.157] pudeur et d’homicide, avec préméditation et guet-apens, et négativement celle relative à la démence.
Léger a entendu son arrêt de mort avec le calme et l’impassibilité qui ne l’ont pas quitté pendant les débats. L’accusé ne s’est point pourvu en cassation, et, a été exécuté peu de jours après sa condamnation.
Sa tête a été examinée par MM. Esquirol et Gall, en présence de plusieurs autres médecins. M. Esquirol nous a dit avoir remarqué plusieurs adhérences morbides entre la pie-mère et le cerveau (2). [p. 158]
Voyons maintenant si la conduite dé Léger chez ses parens, son genre de vie depuis sa fuite, la manière dont il a exécuté le crime, ses réponses aux interrogations, sa contenance aux débats, le soin qu’il a pris de sa défense, l’amour qu’il a montré pour la vie, si l’examen de sa tête, voyons si toutes ces circonstances n’ont rien présenté qui décèle chez Léger l’existence d’un désordre mental très profond.
Léger a toujours montré des dispositions morales singulières ; il était habituellement sombre et mélancolique, fuyait la société des femmes, et ne se livrait point aux jeux qui récréaient ses camarades. La plupart des aliénés ont présenté ces bizarreries de caractère avant leur maladie, souvent même depuis leur enfance. Léger s’est néanmoins toujours conduit avec honnêteté ; il a servi comme soldat dans divers régimens sans qu’on ait entendu dire qu’il s’y soit mal comporté.
Un jour, sans motif, sans avoir eu à se plaindre de [p. 159] ses parens, il prend une légère somme d’argent et s’échappe de la maison paternelle, pour aller habiter dans les bois, se loger dans les rochers, y vivre, à la manière d’un sauvage, de racines, d’herbes crues, de fruits, d’animaux qui ont à peine cessé de vivre. Ces actions ne peuvent appartenir qu’à un insensé. Il n’y a qu’un fou qui puisse être assez imprévoyant pour quitter sa maison avec si peu de ressources, pour mener un pareil genre de vie. Il n’est donc pas étonnant que Léger ait paru avoir un air effrayant dans cette position malheureuse.
Mais que penser de l’idée et de l’exécution d’un forfait qui n’a pas son pareil dans les annales du crime ? Les motifs ordinaires des actions criminelles sont la cupidité, la vengeance, l’ambition , etc. ; l’anthropophagie est étrangère aux peuples civilisés ; et chez les sauvages qui ont ce goût horrible, il est développé par l’exemple et l’habitude, il est le fruit de l’éducation. Chez nous, un anthropophage serait un malade qu’il faudrait renfermer dans une maison de fous. Léger n’a donc point été poussé au crime par les passions qui en sont les mobiles ordinaires ; son action n’a pas de motifs intéressés que puisse avouer la raison. Il voulait boire du sang ! manger de la chair humaine ! Ces désirs tout-à-fait étrangers à la nature de l’homme civilisé j entièrement opposés au caractère dé Léger, développés depuis peu chez lui, prouvent, à mon avis, l’existence d’une effroyable perversion morale accidentelle, d’une aliénation mentale manifeste.
Cette agitation , cette insomnie, ces craintes superstitieuses, qui tourmentaient Léger aussitôt après l’exécution du crime, sont, dit le ministère public, l’effet du remords , et prouvent l’existence de la raison ; un aliéné, ajoute-t-il, aurait dormi auprès de sa victime. Si nous n’avions pas d’autres preuves de la folie de Léger, nous ne penserions pas non plus que ces désordres [p. 160] de l’esprit fussent des signes caractéristiques de cette maladie. Mais réunis aux autres preuves, ils les fortifient. L’action de Léger pouvait être le résultat d’un paroxysme dans lequel l’agitation était augmentée, et a continué quelque temps après. D’ailleurs il ne faut pas croire que les aliénés ressemblent tous à des bêtes brutes, qui n’ont ni souvenir, ni aucune espèce de sentiment, et soient incapables de reconnaître une mauvaise action et d’en éprouver des remords. Beaucoup de ces malades, au contraire, se repentent très-sincèrement du mal qu’ils ont fait aussitôt que le moment de colère où de fureur, est passé, demandent pardon à ceux qu’ils ont offensés, et s’informent avec intérêt de la santé de ceux qu’ils ont pu blesser; M. Pinel parle d’un aliéné qui, dans ses accès de fureur homicide, sentait tout ce que sa position avait d’affreux, et priait instamment qu’on l’enfermât ,et qu’on s’éloignât de lui durant sa fureur. Croyez- vous que cet infortuné eût dormi près de, la victime qu’il eût immolée ? Nous devons dire cependant que l’assertion du ministère public est vraie dans un grand nombre de cas.
Aussitôt après son arrestation, Léger se dit échappé des galères de Brest. En le supposant doué de raison, quelle intention y avait-il dans une pareille réponse ? Espérait-il qu’en le conduisant aussitôt à Brest, on l’éloignerait du théâtre du crime ? Mais comment n’eût-il pas pensé qu’avant d’avoir acquis la certitude de son état antérieur, on devait le garder dans la prison la plus voisine ? On lui eût demandé par quel tribunal il avait été condamné y on eût examiné ses épaules, et la fausseté de son assertion n’eût pas tardé à être reconnue. Je crois donc qu’il faut attribuer à la folie cette idée déraisonnable. De même qu’il est des aliénés qui se croient princes, rois, papes, empereurs, dieux, dignes des honneurs les plus élevés ; de même aussi il en est d’autres [p. 161] qui s’imaginent être criminels, assassins, odieux à tout le monde, dignes des pins grands supplices.
Léger n’a pas avoué de lui-même son crime ; il est resté plusieurs jours en prison sans en parler à personne ; et pourtant il racontait à tout le monde son genre de vie dans les bois. Un aliéné, dit-on, ne cache point ainsi ses actions. Cela est encore vrai pour un grand nombre, de ces malades, mais non pour tous. Les personnes qui ont l’habitude de voir des. fous, savent très-bien que les aliénés qui ont le penchant à dérober ne manquent point à cacher soigneusement leurs larcins ; que des malades nient avec force, avec assurance, de mauvaises actions qu’on leur reproche, et dont on leur fournit quelquefois des preuves évidentes ; c’est qu’ils n’ignorent pas qu’ils ont mal fait, et ne doutent pas qu’on leur infligera une punition. Si l’on excepte quelques furieux dont les actes sont peu réfléchis, la plupart des. aliénés ont souvent la notion du mal qu’ils font, et s’attendent à subir les conséquences de leurs mauvaises actions : ordinairement celui qui veut tuer, poussé par un motif imaginaire quelconque, croit bien qu’il montera sur l’échafaud ; seulement la tentation de commettre le meurtre l’emporte sur la crainte du châtiment, et aucun motif ne peut l’arrêter. On conçoit donc qu’un aliéné pourrait cacher une action condamnable, excitée par son délire, pour n’en être pas puni.
Mais à peine Léger a-t-il fait l’aveu fatal, que rien ne l’arrête dans ses dépositions contre lui-même ; il met le juge sur la voie, indique toutes les circonstances du forfait, entre dans les plus petits détails à cet égard. Il paraît avoir éprouvé un peu d’émotion lors de l’interrogatoire où il a tout avoué ; mais depuis il a conservé le plus imperturbable sang-froid, soit dans la prison, soit aux débats ; la vue de ses effets encore ensanglantés, la déposition du père et de la mère de la jeune fille, le récit de cette série d’actes horribles qui lui étaient reprochés, le [p. 162] prononcé de sa sentence de mort ne le font pas changer de contenance, il conserve la plus froide immobilité. Il a même paru raconter lui-même, avec un certain plaisir, la manière dont il s’y est pris pour mutiler sa victime et se repaître de sa chair. cette conduite est évidemment celle d’un homme en démence.
Les réponses que nous avons rapportées sont toutes empreintes, d’une naïveté, d’une bêtise qui n’appartiennent qu’à un esprit borné. Quelques-unes sont même des indices de folie. Ainsi, lorsqu’il a quitté ses parens, il n’avait pas la tête à lui, il était affecté de la pierre et d’un rhume qui lui avaient fait perdre l’esprit : c’est le désespoir qui l’a conduit dans la roche de Charbonnière, il avait le cerveau vide : lorsqu’il a enlevé la petite fille, il était poussé par le malin esprit ; lorsqu’il a déposé son fardeau sur l’herbe, il n’était plus maître de lui ; il avait soif de sang….. Après la mutilation du cadavre, il n’avait plus la tête à lui, et s’est mis à errer au milieu, des rochers pour fuir les croassemens funèbres des corbeaux : il ne se souvient plus d’avoir insulté quelques femmes ; circonstance peu importante dans la cause, qu’un individu doué de raison n’aurait point oubliée, et que Léger n’avait aucun intérêt à cacher. Il nie aussi l’attentat relatif au viol. Mais il paraît que les rapports des gens de l’art n’ont laissé aucun doute à cet égard. Aux débats, la figure de Léger semble s’épanouir pendant la lecture de l’acte d’accusation, et il a constamment répondu avec le sourire sur les lèvres et l’apparence de la gaîté.
Le défenseur de Léger était nommé d’office. Ce qui prouve, ou qu’aucun avocat de Versailles n’a voulu se charger de sa cause, ou que lui-même n’a pas songé à se choisir un défenseur. Dans cette dernière supposition, Léger eut commis encore un acte d’imbécillité.
Léger est si étranger aux affaires de ce monde, ou si indifférent pour la vie, qu’il ne se pourvoit ni en [p. 163] cassation, ni en grâce. Je crois que c’est encore là un acte d’imbécillité ; car il n’y a guère que quelques scélérats endurcis dans le: crime, et qui ont dû se familiariser avec l’idée de la mort, que l’on voit renoncer à ce bénéfice de la loi, et refuser de prolonger un moment leur existence.
Si nous conservions des .doutes sur l’existence de l’infirmité mentale de Léger, l’examen de sa tête achèverait notre conviction. Il est vrai que cette nouvelle preuve est un peu tardive, pour lui ; mais si elle ne lui est d’aucune utilité, elle peut servir pour d’autres. En effet, Léger avait une altération manifeste dans le cerveau , une adhérence morbide entre les méninges et cet organe. Cette lésion est surtout remarquable en ce qu’on ne l’observe en général que dans les folies anciennes, dans les folies dégénérées en démence ou affaiblissement de l’intelligence : elle prouve, à notre avis, que la maladie mentale de Léger existait depuis plusieurs années au moins.
Léger n’était donc pas, comme on l’a dit, un grand criminel, un monstre, un cannibale, un anthropophage, qui avait-voulu, renouveler l’exemple du festin d’Atrée . Cet individu était, suivant nous, un malheureux imbécile, un aliéné qui-devait être renfermé à Bicêtre parmi les fous, et qu’on ne devait pas envoyer à l’échafaud. Plus un crime est inouï a dit un juriste (3), moins il faut en chercher la cause dans les mobiles ordinaires des actions humaines.
Devons-nous réfuter ici des opinions dangereuses que nous avons entendu soutenir par des hommes recommandables ? « Tous les criminels seront bientôt des fous ; les Léger sont des êtres dangereux dont il faut débarrasser la société, ils tueraient même dans une maison de fous ; peu [p. 164] importe quelle tels individus périssent…,: etc. » Mais il ne suffit pas de simuler la folie pour faire croire qu’elle est réelle ; il n’est pas vrai que les aliénés affectés de monomanie -homicide puissent commettre des meurtres dans les maisons de fous lorsque la surveillance est active. Si la peine infligée au criminel doit bien moins être une punition pour lui qu’in exemple propre à prévenir le même crime chez d’autres individu , croyez-vous effrayer des aliénés par des exemples semblables, eux qui commettent souvent leurs actions homicides pour mériter le dernier supplice, où malgré la crainte de ce terrible châtiment. Peu importe que de pareils individus périssent ; « Mais , dit M. Gall, il importe à la famille de n’être point flétrie : et par quelle raison infliger des châtimens pour des actions qui ont été commises dans la manie ? Craignez-vous de donner au peuple un exemple dont les conséquences pourraient être funestes ? Éclairez le peuple sur ce genre de maladie. Votre premier devoir est d’être juste, et de ne pas commettre des cruautés sans but » (4). »
Loin de nous la pensée de vouloir blâmer la conduite des magistrats, et des jurés qui prononcent de pareilles sentences. Il n’est pas étonnant qu’ils ignorent des faits que beaucoup de médecins ne connaissent qu’imparfaitement, ou même pas du tout. Quel intérêt ont-ils à envoyer un misérable à l’échafaud ? n’est-ce pas, au contraire, dans l’intérêt de la société qu’ils remplissent un devoir si pénible ? (5) [p. 165]
Procès FELDTMANN (6).
Henri Feldtman, âgé de 56 ans, ouvrier tailleur, est traduit à la Cour d’assises de Paris, le avril 1823, [p. 166] accusé d’avoir tué sa propre fille, pour laquelle il avait conçu depuis six ou sept ans, une violente passion. Feldlmann était un homme d’un caractère naturellement [p. 167] emporté ; son intelligence était assez médiocrement développée, pour qu’un témoin, le pasteur Groeppe, ait déposé que Feldtmann lui avait paru affecté d’une d’idiotisme, que c’était un homme dont les idées tournaient dans un cercle extrêmement restreint, et qui était souvent entêté comme le sont ces sortes de gens. Du reste il était laborieux et probe.
La passion de Feldtmann pour sa fille Victoire paraît remonter à 1815, et n’a fait que s’accroître jusqu’en 1828 , par l’opiniâtre résistance opposée à la séduction. Le pasteur Gœppe, instruit dès le commencement de l’horrible dessein de ce malheureux père, eut plusieurs entretiens à de sujet avec lui. Feldtmann, au lieu de se justifier, s’emporta contre sa fille ; il promit cependant de ne plus l’inquiéter, mais il ne tint pas ses promesses. De 1817 à 1818 les attentats étant devenus plus directs et plus alarmans, les emportemens de cet homme contre sa femme et ses filles plus fréquens et plus violens, celles-ci se déterminèrent à se réfugier chez une parente ; elles finirent cependant par se réunir à Feldtmann, qui, loin de s’être corrigé de son funeste penchant, tint la même conduite envers sa fille. Plusieurs fois il eut recours à la violence pour satisfaire sa passion ; un jour Victoire fut obligée de lui donner deux soufflets pour se dérober à ses importunités ; et, une autre fois, sa seconde fille ne parvint à secourir Victoire qu’en s’emparant du pouce de son père, et en le renversant sur le poignet. La mère et les deux filles quittèrent de nouveau Feldtmann, en lui laissant ignorer le lieu de leur retraite.
La police, prévenue de cette affaire, menaça Feldtmann, qui était étranger, de le renvoyer dans son pays, s’il [p. 168] ne changeait pas de conduite à l’égard de sa fille. Cette menace produisit peu d’effet sur lui; il répondit qu’il aurait toujours le droit d’emmener ses enfans.
Feldlmann, ayant découvert la retraite de sa femme et de ses filles, s’y rendit, frappa deux heures à la porte avant d’y être introduit, et fit ensuite d’inutiles sollicitations auprès de Victoire. Le 23 mars 1823 il pria M. Gœppe de faire revenir sa fille avec lui, disant que sans cela il se porterait à des actes de violence. Le lendemain il achète un long couteau pointu qu’il cache dans sa poche, va trouver sa famille, déjeune avec elle, et renouvelle ses instances auprès de Victoire pour la déterminer à le suivre ; sur son refus, il s’écrie : Eh bien ! tu es cause que je périrai sur l’échafaud. Il lui perce le cœur, et blesse sa femme et son autre fille. Les voisins accourent au bruit ; Feldtmann se laisse arrêter sans résistance, en disant qu’il n’a pas envie de se sauver ; aux reproches qu’on lui adresse, il répond : c’est bien fait : interrogé sur-le-champ par le commissaire de police, sur le motif qui lui avait fait acheter un couteau de cuisine, il avoue que c’était dans l’intention d’en frapper sa fille, si elle ne s’arrangeait pas avec lui.
Aux débats, Feldtman entend la lecture de l’acte d’accusation sans montrer le moindre attendrissement ; sa figure est restée calme et immobile ; il répond assez bien aux questions qu’on lui fait, se jette dans une foule de récriminations contre sa femme et ses filles, prétend avoir acheté le couteau meurtrier en se rendant chez sa fille, pour en faire cadeau à sa femme qui en avait besoin ; nie sa réponse au commissaire de police ; dit qu’il ne savait ce qu’il faisait en commettant le meurtre, qu’il n’avait pas la tête à lui dans ce moment ; répond par des dénégations à différentes assertions des témoins : en un mot, il se défend assez bien, et ne donne pas de signe d’un dérangement d’esprit. [p. 169]
Sa femme (7) dépose néanmoins qu’il avait souvent la tête perdue ; qu’il tenait des propos désordonnés ; qu’il faisait habituellement des folies particulièrement les vendredis et les jours de pleine lune. Feldtmann ajoute que dans sa jeunesse il a eu la tête fendue, ce qui l’a rendu comme fou pendant quelque temps. Le président fait observer que la femme de l’accusé a dit dans l’instruction qu’il n’avait d’égarement qu’au sujet de sa fille Victoire, et que, pour le reste, il était fort raisonnable ; qu’elle n’avait pas parlé non plus alors de l’influence du vendredi, mais seulement de celle des pleines lunes. Nous avons rapporté la déposition du pasteur Gœppe sur l’état mental de l’accusé. Un autre témoin rapporte que le dimanche des Rameaux, 23 mars, Feldtman arriva au Temple protestant, ayant la figure et ses vêtemens tout couverts de boue et d’éclaboussures. Le témoin lui présenta un livre de cantiques qu’il refusa en disant qu’il n’avait pas la tête à lui ; pendant tout l’office et pendant le sermon, qui roula sur les devoirs des pères de famille, Feldtmann ne cessa de pleurer et détenir des propos désordonnés. Aucun autre témoin, même parmi ceux qui connaissent l’accusé depuis long-temps, n’a jamais remarqué en lui des signes d’aliénation mentale.
Le président, sur la demande des conseils de l’accusé, adresse les questions suivantes à des médecins : 1° si un homme possédé d’une passion dominante et exclusive, peut tomber dans une espèce de monomanie au point d’être privé de ses facultés intellectuelles et être hors d’état de réfléchir ; 2° si une passion extraordinaire n’est pas par elle-même un signe de monomanie ; ° si une passion dominante et exclusive peut exciter chez un individu un dérangement d’idées qui aurait tous les caractères de la démence. [p. 170] Ces questions ont évidemment pour but de déterminer, si l’on peut assimiler les effets des passions à ceux de l’aliénation mentale , la fureur d’un homme irrité par la colère, la jalousie ou le désespoir à celle d’un aliéné ; ou bien encore, si durant l’action d’une passion violente, l’homme ne peut pas être considéré comme atteint de folie. La solution de cette question, car elles se réduisent à une seule, est de la plus haute importance ; puisqu’il s’agit de distinguer une action criminelle d’un acte involontaire, de condamner ou d’absoudre.
Il y a deux manières de voir à ce sujet : les uns soutiennent que l’homme dominé par une passion violenté est tout-à-fait aliéné ; les autres établissent une distinction entre l’effet des passions et celui de l’aliénation mentale.
Tous les jours, dans le monde, on entend dire d’un homme violemment agité par une passion, qu’il n’est plus maître de lui, qu’il n’y est plus, que sa raison est égarée, que ses idées sont désordonnées, qu’il est comme un fou ; que le suicide ne petit être que l’action d’un fou. La plupart des avocats qui défendent une cause désespérée manquent rarement de tenir le même langage, et de chercher à prouver qu’il n’y a pas de différence entre l’égarement de la raison chez un pareil individu et chez un aliéné ; que celui qui tue durant un accès de colère, de jalousie ou de désespoir, agit tout aussi involontairement que. Celui qui commet un homicide pendant un accès de manie furieuse. Nous avons précisément sous les yeux un plaidoyer où cette doctrine est soutenue avec beaucoup d’art par un avocat célèbre (8).
L’accusé, âgé de 48 ans, devenu éperdument -amoureux d’une femme de 36 ans, et probablement en possession [p.171] de ses faveurs, conçoit des soupçons sur la fidélité de cette femme, est pris de jalousie, et la tue, un soir qu’il trouve un rival chez elle ; il avoue tout, donne tous les détails qu’on lui demande, se repent de son action, convient qu’il est coupable, et implore la mort comme une faveur. M. Bellart cherché à prouver que ce meurtre a été commis sans véritable volonté. « Il est, dit-il, diverses espèces de fous ou d’insensés : ceux que la nature â condamnés à la perte éternelle de leur raison, et ceux qui ne la perdent qu’instantanément, par l’effet d’une grande douleur, d’une grande surprise , ou de toute autre cause pareille. Au reste il n’est de différence, entre ces deux folies, que celle de la durée ; et celui, dont le désespoir tourne la tête pour quelques jours ou pour quelques heures, est aussi complètement fou, pendant son agitation éphémère, que celui qui délite pendant beaucoup d’années. Cela reconnu, ce serait une suprême injustice de juger et surtout de condamner l’un ou l’autre de ces deux insensés, pour une action qui leur est échappée pendant qu’ils n’avaient pas l’usage de leur raison ; outre que ce serait une injustice, ce serait une injustice, ce serait une injustice inutile pour la société : car, les châtimens n’étant infligés que pour l’exemple, toutes les fois que l’exemple est nul, le châtiment est une barbarie. Or, s’il est un exemple nul, ce serait la vengeance qu’on tirerait du crime commis dans l’excès de la fureur, de l’amour, de l’ivresse ou du désespoir ; car l’exemple, ne pouvant empêcher tontes ces surprises de nos sens, n’empêcherait pas dès lors, que le même nombre de délits pareils ne se commît toujours, non plus que la mort donnée publiquement aux fiévreux n’empêcherait personne d’avoir la fièvre. Vainement dira- t-on que voici cependant un meurtre commis, et qu’il faut que ce meurtre soit puni : encore une fois la mort du meurtrier ne rend pas la vie à celui qui l’a perdue. Lorsqu’un maniaque a causé quelque grand malheur, il est à [p. 172] craindre, sans doute ; il faut le surveiller ; il faut le garotter ; l’enfermer peut-être : c’est justice et précaution, mais il ne faut pas l’envoyer à l’échafaud , ce serait cruauté.
« Que conclure de tout ceci ? Que si, dans l’instant où Gras a tué la veuve Lefèvre., il était tellement dominé par quelque passion absorbante, qu’il lui fut impossible de savoir ce qu’il faisait et de se laisser guider par sa raison, il est impossible aussi de le condamner à mort. »
L’avocat cherche à prouver que les passions qui agitaient violemment Gras un instant avant de commettre le crime, ont excité le désordre dans son âme, causé un brûlant délire, aliéné ses sens et sa raison, au point qu’il ne doit point être coupable de ce qu’il a fait dans un si complet renversement de ses facultés. Gras avait porté vingt-deux coups de couteau à sa victime. M. Bellart s’efforce de combattre l’erreur de ceux qui pensent que la rage n’a pu durer vingt-deux coups de couteau, qu’elle a dû s’éteindre au premier coup ; que le premier seul est pardonnable ; et que tous les autres sont des crimes. Loin que ce nombre terrible lui paraisse prouver contre la démence, il lui semble que la démence seule a pu les multiplier à ce point ; « car, dit-il, si les premiers ont suffi pour donner la mort, les derniers, inutiles à la vengeance, les derniers qui ne tombaient que sur un cadavre, qui n’étaient bons qu’à rassasier rage, annoncent eux- mêmes que la rage durait encore lorsqu’ils furent portés, et qu’au premier comme au dernier, Gras était au plus haut point de frénésie ; la vengeance.de Gras n’était qu’à moitié consommée ; il brûlait de répandre le sang de son rival, et peut-être d’y mêler le sien ; mais ce lâche amant avait fui, et c’était en vain que Gras le poursuivait. L’apparition de Gras, les vingt-deux coups portés, la fuite du rival, la course de Gras qui le poursuivait, si rapidement suivis, tout cela s’est passé dans une minute ; les vingt-[p. 173] deux coups portes., et pressés avec une affreuse vélocité, n’ont pas duré le temps de vingt-deux éclairs ; ainsi la réflexion n’était pas encore arrivée pour désarmer la fureur et la jalousie (9). »
Cette opinion, qui assimile les effets des passions à ceux de l’aliénation mentale, nous paraît erronée et dangereuse ; elle tend à confondre deux états, différens, à placer sur la même ligne l’immoralité et l’innocence, les assassins et les aliénés. Nous sommes persuadés, que l’avocat qui l’a soutenue autrefois par un motif fort louable, la désavouerait aujourd’hui qu’il est plus à même d’en apprécier les graves inconvéniens.
L’aliénation mentale peut se composer de deux éléments : 1° perversion des penchans, des sentimens, des affections et des passions ; 2° désordre grave des idées ordinairement inaperçu du malade. Au premier ordre de phénomènes se rapportent l’indifférence ou la haine de l’aliéné pour des êtres qui lui étaient chers, et qui n’ont rien fait pour perdre son affection, le désir de se venger de prétendus ennemis, une sombre jalousie née sans le moindre motif, l’amour conçu pour des choses inanimées, pour des personnages d’un rang élevé, pour des êtres célestes, etc. ; au second ordre de phénomènes se rattachent toutes les folles idées des aliénés, celles de se croire ce qu’ils ne sont pas, de prendre pour des amis ou pour des ennemis, des individus qu’ils n’ont jamais vus, etc. Ajoutez à cela que presque tous les aliénés ignorent leur état, et se croient doués de la plus saine raison. Observe-t-on rien de semblable durant l’action des passions ? Il y a bien de grands troubles dans l’esprit lorsqu’il est agité par la colère, tourmenté par un amour malheureux, égaré par la jalousie, [p. 174]accablé par le désespoir, anéanti par la frayeur, perverti par le désir impérieux de la vengeance, etc. ; mais tout cela est naturel, et ne présente point les signes de la folie ; durant ces troubles de l’âme, l’homme voit sans doute certaines choses autrement que s’il était de sang-froid, mais il ne se trompe grossièrement, ni sur leur nature, ni sur leurs rapports, ni sur le but et le caractère de ses actions : lorsqu’il est poussé au crime par le désir de se venger, il agit d’après des motifs réels et qui lui paraissent déterminans ; il combine ses moyens, prend ses précautions, connaît parfaitement les suites ; que doit avoir son action pour sa victime et pour lui. Un orgueilleux n’est pas fou parce qu’il se croit ; supérieur à ceux de son rang ou de sa classe ; un ambitieux n’est pas aliéné parce qu’il est dévoré de la soif des honneurs et des richesses ; un amoureux ne l’est pas davantage, parce qu’il est épris d’une personne d’une condition proportionnée à la sienne ; une tendre mère ne l’est pas non plus, parce qu’elle éprouve de l’éloignement pour des enfans qui ne payent ses soins que par de mauvais procédés ; mais il y a folie chez le premier s’il se croit prince, roi, pape, Dieu ; chez le second lorsqu’il prétend être possesseur de milliards, de mines de diamant, etc. ; chez le quatrième, si sa passion a pour objet les anges, les saints, la Vierge, Dieu, le Christ ; chez la quatrième, si elle repousse dés enfans innocens qu’elle adorait, si elle les tue par divers motifs imaginaires. L’homme qui se tue pour échapper à une mort ignominieuse et certaine, pour se soustraire à la douleur, au mépris de ses concitoyens, à la misère, etc. ne saurai être comparé à celui qui veut quitter la vie parce qu’il y est poussé pat des idées extravagantes, par un ordre de Dieu, par la crainte du diable , etc.
Mais si les passions violentes ne sont pas un état d’aliénation mentale, cela n’empêche pas qu’elles n’affaiblissent considérablement la liberté, maîtrisent puissamment la [p. 175] volonté, et produisent quelquefois un état violent qui porte presque irrésistiblement à des actions criminelles. Cela est tellement évident, que nos lois excusent le meurtre commis dans certains cas d’adultère, par l’un des époux sur l’autre et sur son complice, et le crime de castration-, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur (10).
Nous croyons même que des passions qui, comme celle de Feldtman, ont persisté un grand nombre d’années ; qui, loin de laisser des intervalles de repos, n’ont fait que s’accroître par des irritations successives, sont devenues de véritables maladies qui exigent un traitement méthodique, peu différent de celui de l’aliénation mentale. Elles doivent donc singulièrement modifier le caractère des actions criminelles, et conséquemment la décision du juge. Feldtmann n’était pas un fou ; mais c’était, suivant nous, un homme dont la faible raison était dominée par une passion qui était devenue une véritable maladie, et qu’il fallait tout à la fois punir et guérir en le séquestrant pour long-temps de la société (11).
Nous n’avons pas besoin d’insister sur le danger qui existerait pour la sécurité publique, si l’opinion, qui assimile les passions violentes à l’aliénation mentale, devenait un principe de jurisprudence criminelle : il est incontestable. « Confondre l’égarement des passions vicieuses avec l’innocent délire de l’aliénation mentale, a dit M. l’avocat général qui portait la parole dans l’affaire de Feldtmann, ce serait proclamer l’impunité de tous les plus grands forfaits, placer leur justification dans leur immoralité même, et livrer l’ordre social à un bouleversement universel. » [p. 176]
Mais si le législateur ne doit pas établir un pareil principe ,le juge peut et doit reconnaître des cas exceptionnels, et user quelquefois d’indulgence envers des hommes qui ont perdu le fruit d’une conduite irréprochable par un seul instant d’égarement. Il faut, a très-bien dit M. Bellart, « il faut établir une grande distinction entre les crimes ; les uns sont vils, tel que le vol ; les autres sont atroces v tel que l’assassinat prémédité ; mais il en est qui annoncent une âme vive et passionnée: ce sont tous ceux qui sont arrachés par le premier mouvement. Quiconque a reçu dans son enfance une éducation saine, dont il a conservé les principes dans un âge plus avancé, peut se promettre, sans effort, qu’aucun crime pareil aux premiers, ne tachera jamais sa vie ; mais quel homme serait assez téméraire pour oser croire que jamais, et dans l’explosion d’une grande passion, il ne commettra les derniers ? Où trouver celui qui pourrait assurer que jamais, dans l’exaltation de la fureur, de l’amour ou du désespoir, il ne souillera ses mains de sang, et peut-être du sang le plus cher et le plus précieux » (12). « Vous qui jugez les hommes, a dit le célèbre avocat-général Servan, tenez-vous en garde contre ce faux principe, que tes hommes sont tous également capables de tout ; que le cœur humain, né pervers, enfante des monstres sans effort, et qu’il ne faut qu’un moment pour mêler l’innocence et le crime ; ne déshonorez point votre nature par un noir penchant à la soupçonner ; ayez toujours égard à une vie jusqu’alors innocente et pure ; montrez que vous êtes vertueux vous-même par une noble confiance en la vertu. En un mot, je le répète, pour bien juger le présent, consultez attentivement le passe. »
— Au lieu de fonder dans ces cas leur système de défense sur l’allégation de l’aliénation mentale, système qui sera [p. 177] toujours combattu avec succès par le ministère public, au lieu d’avoir recours à ce moyen, les conseils des accusés peuvent soutenir, et les jurés doivent admettre que dans certaines passions subites et violentes, la liberté et la volonté sont maîtrisées, au point de laisser agir presque irrésistiblement la main homicide ; dans ces cas il ne peut y avoir eu meurtre puisqu’il n’y avait pas eu volonté libre, encore moins de préméditation, puisqu’il n’y avait pas assez de liberté. L’on admet surtout trop facilement la préméditation : il suffit en effet que les accusés aient eu quelques instans pour former leur dessein coupable et en préparer les moyens d’exécution, pour que cette circonstance aggravante soit admise ; or, dans certaines passions violentes, l’orage peut durer plusieurs heures et même davantage, de manière que la liberté soit toujours enchaînée, et la volonté maîtrisée.
Procès de LECOUFFE (13).
Louis Lecouffe, âgé de 24 ans, accusé d’assassinat, est traduit devant la Cour d’assises de Paris le 11 décembre 1823 ; Il était épileptique depuis l’enfance ; les personnes qui le fréquentaient habituellement déposent qu’ils le regardaient comme un fou ou un imbécille ; il avait eu une maladie à la tête étant très-jeune. A 15 ans, il avait donné des marques de folie ; il disait alors de temps en temps que-Dieu venait le voir. Un médecin du quartier de l’accusé dit avoir appris que Lecouffe n’avait pas toujours eu la tête à lui. Sa mère, qu’il accuse avec violence et compromet gravement par ses révélations, tout en l’appelant méchant, monstre, scélérat, [p. 178] déclare néanmoins qu’il a toujours été malade , et n’a presque jamais eu sa tête à lui ; que quand ses folies lui prennent, il n’est pas maître de lui, que s’il n’avait pas été fou ou saoul, il n’aurait pas commis le meurtre. Il nie d’abord d’en être l’auteur ; dans un antre interrogatoire il fait ainsi des révélations : la nuit précédente, étant éveillé, il a vu l’ombre de son père, un ange à sa droite, qui lui a commandé de faire l’aveu de son crime ; Dieu a aussitôt mis la main sur son cœur, en lui disant, je te pardonne ! et en lui ordonnant de tout dire sous trois jours ; il est resté éveillé le reste de la nuit, et le matin on le trouve à genoux, en chemise, priant Dieu. Il déclare alors que c’est à l’instigation de sa mère qu’il a commis le meurtre, et volé l’argenterie de la victime. Cet objet est mis en gage pour la somme de 230 fr., sur lesquels la femme Lecouffe donne seulement 40 francs à son fils, pour acquitter les frais de son mariage, qui se célèbre le surlendemain. Il déclare que sa victime l’aimait beaucoup , et qu’il le méritait bien, car il avait pour elle toute la complaisance possible, et lui rendait toute sorte de petits services ; qu’il est resté cinq heures sans connaissance après lui avoir ôté la vie. Confronté avec sa mère, il ne rétracte point ses révélations, seulement il montre de l’hésitation, dit qu’il n’a plus la tête à lui, et éprouve une violente attaque de nerfs. Si vous me mettez en présence de ma mère, dit-il le lendemain, je ne pourrai pas répondre de moi, elle me démentira et je n’aurai pas la force de soutenir la vérité. Cet empire qu’exerçait la mère Lecouffe sur son fils est attesté par les dépositions de plusieurs témoins. Il se privait absolument de tout pour soutenir sa mère, lui donnant tout ce qu’il gagnait, sans oser garder un sou pour lui ; conduite qui serait plus digne d’éloges si elle était inspirée par des sentimens de piété filiale,; et non le résultat de la faiblesse. L’un des gardiens de la conciergerie [p. 178] déclare que Lecouffe tenait des propos décousus dans la prison, même à sa charge ; qu’il changeait plusieurs fois de système dans une demi-heure. L’accusé a paru au témoin idiot et faible d’esprit, mais pas précisément atteint de folie : souvent , ajoute-t-il, il se trouvait mal, surtout quand on lui parlait de sa femme ou de sa mère. Le chef des gardiens dit avoir vu souvent l’accusé les yeux hagards ou remplis de pleurs, se plaindre de maux de tête, mais ne montrant pas un véritable dérangement d’esprit.
Aux débats, Lecouffe est pris à chaque instant de violentes attaques de convulsions ; il en est atteint en entrant à l’audience, en entendant lire l’acte d’accusation, quand il voit paraître une femme qu’il avait voulu épouser, etc. Il dit que quand il éprouve des contrariétés, il lui passe une espèce de flamme devant les yeux.
Un médecin, à qui le président demande s’il pourrait reconnaître dans l’accusé quelque aliénation mentale, fait cette réponse, au moins singulière : il ne voit rien dans la figure de Lecouffe, qui annonce des dispositions à l’épilepsie, et le crâne ne lui présente aucune difformité, n’indique aucune espèce d’aliénation.. Comme si la figure fournissait des signes d’épilepsie, et le crâne des signes de folie !
L’avocat-général soutient l’accusation, et s’élève avec force contre l’allégation de la démence de l’accusé ; système dangereux, dit-il, qu’on reproduit dans toutes les causes désespérées, et par lequel il serait si facile d’assurer l’impunité des plus grands attentats. Il cherche ensuite à prouver, par les témoignages sortis de la vie entière de l’accusé, par la nature même du fait qui lui est imputé, par l’hypocrisie et la malice de sa défense, que cet homme jouissait de toutes ses facultés malgré l’exécrable abus qu’il en a fait. Il s’appuye à ce sujet de la [p. 180] déposition des employés de la Conciergerie (14), qui n’ont jamais remarqué en lui le moindre signé d’aliénation mentale. « Cependant on l’entend quelquefois frémir dans la nuit ; il pousse des cris funèbres, il se dit souvent tourmenté par des apparitions nocturnes, il croit voir son père, sa victime, s’échapper de leur tombeau pour lui reprocher son crime ». Mais nous connaissons la source de ces terreurs, elles l’ont déjà saisi sur le champ du meurtre , lorsqu’il fut conduit à la place où il avait égorgé sa victime. Elles sont l’effet du remords implacable qui le poursuit.. Ses traits effrayans annoncent le désordre et l’orage des passions tumultueuses qui dévorent son cœur.
Le défenseur de l’accusé a en vain allégué l’existence de l’aliénation mentale, ou au moins d’une grande faiblesse d’esprit. Lecouffe a été condamné à mort, et exécuté peu de temps après.
L’altération des facultés mentales de Lecouffe résulte évidemment de l’exposé que nous venons de faire de son état. Remarquons, d’abord, que ce misérable n’a pas eu des apparitions seulement depuis le meurtre qu’il a commis, comme le dit M. l’avocat-général, puisqu’un témoin dépose que dès l’âge de 15 ans Lecouffe disait avoir des conversations avec Dieu ; remarquons aussi que si les gardiens de la Conciergerie n’ont pas pris Lecouffe pour un fou, c’est-à-dire, d’après l’opinion du vulgaire, pour un furieux, l’un de ces gardiens a dit de l’accusé qu’il tenait des propos décousus, et lui paraissait être un idiot ou un imbécille.
L’épilepsie de naissance altère ordinairement les facultés intellectuelles d’une manière qui va toujours croissant, et finit à la démence complète. Ainsi, sur 339 épileptiques qui existaient en 1822 à la Salpêtrière, M. Esquirol a [p. 181] noté 2 monomaniaques, 64 maniaques, dont 34 furieuses, 145 en démence, dont 129 après l’attaque seulement, et les16 autres persistantes, 8 idiotes, 50 habituellement raisonnables, mais avec des absences de mémoire, de l’exaltation dans les idées ; quelquefois un délire fugace, une tendance vers la démence ; 60 né présentent aucune aberration de l’intelligence, mais elles sont d’une grande susceptibilité, irascibles, entêtées, difficiles à vivre, capricieuses, bizarres, toutes ont quelque chose de singulier dans le caractère (15). Il est notoire que Lecouffe, faible d’esprit et craignant sa mère , faisait tout ce que celle-ci lui commandait. Elle refuse son consentement à un premier mariage que voulait contracter son fils ; elle le refuse encore dans une occasion nouvelle ; d’après les révélations de son fils, qui paraissent vraies, elle le tourmente long-temps pour commettre le meurtre et le vol, et l’y décide en lui promettant de ne point s’opposer à son mariage. Que lui revient-il de cet horrible attentat ? Le consentement au mariage était donné puisque l’acte s’est célébré le surlendemain. Il a donc eu 40 francs pour avoir tué une vieille femme pour laquelle il avait eu jusque-là beaucoup d’attentions. Certes, les motifs de l’action ne sont pas plus en rapport avec l’énormité du crime, qu’avec les sentimens de Lecouffe pour sa victime. C’est donc ailleurs qu’il faut en chercher la cause; c’est bien évidemment, suivant nous , dans un désordre mental qu’elle se trouve.
« Nous avons trouvé souvent chez de grands criminels , dit M. Gall, dont les forfaits ne paraissaient pas suffisamment motivés par les circonstances extérieures, le crâne dans le même état que chez les maniaques. Puissent les observateurs et les juges donner quelque attention à cet aperçu ! » [p. 182]
Procès de JEAN-PIERRE (16)
- S. Jean-Pierre, âgé de 43 ans, ancien notaire, est traduit devant la Cour d’assises de Paris le 21 février 1824, accusé de crimes et de délits dans lesquels la ruse et la mauvaise foi ont toujours joué un grand rôle. Il a déjà été condamné pour faux ; il est aujourd’hui accusé de faux, d’escroquerie et d’incendie. Interrogé après son arrestation, il répondit avec précision à toutes les questions qui lui furent faites. Mais environ un mois après il ne voulût plus s’expliquer, tint des propos décousus, et finit plus tard par se livrer à des actes de fureur, cassant, brisant, déchirant tout, jetant les effets de sa chambre par la fenêtre. Sur l’avis de médecins appelés pour l’examiner, Jean-Pierre fut conduit à Bicêtre pour y être mieux observé. Là il fait connaissance avec un antre prétendu fou, accusé aussi de faux et d’escroquerie, et retenu également dans cette maison pour y être observé par les médecins. Un incendié violent se manifeste une nuit à Bicêtre, dans l’un des bâtimens habités par les aliénés, dans trois endroits à la fois, ce qui donne lieu de penser que cet incendie était l’effet de la malveillance. Le lendemain on s’aperçut que les deux soi-disant fous avaient disparu.
Jean-Pierre alla se cacher loin de Paris dans une maison où sa femme était employée, et où il fut de nouveau arrêté. Aussitôt son évasion, il écrit à un de ses amis une lettre fort sensée sur sa sortie de Bicêtre. A peine est-il arrêté, qu’il recommence son rôle de fou. Suivant l’acte d’accusation, l’individu qui est parti avec Jean Pierre, est convenu qu’ils avaient ensemble formé le projet de s’évader ; et qu’ils ont profité du moment de l’incendie. Le même individu dit que Jean-Pierre lui fit prêter [p. 183] serment de ne rien révéler, et il paraît avoir fait confidence à un employé de la Force que l’incendie est l’œuvre de Jean-Pierre. Suivant le même acte d’accusation, la conduite, les écrits, les réponses de Jean-Pierre indiquent un homme violent, exalté, mais dont les idées sont cependant bien combinées et bien suivies, malgré le désordre apparent qu’il veut leur donner.
Toutes les personnes qui ont eu des relations avec l’accusé, avant son arrestation, déposent qu’il leur a toujours paru fort sensé, et même fort intelligent en affaires. Un des prisonniers de la Forcé qui a quelquefois rencontré Jean-Pierre et causé avec lui, dit que sa conversation lui a paru très-incohérente, que suivant les cours et décours de la lune, il avait l’imagination très-exaltée. Mais ces observations ont été faites depuis l’arrestation de l’accusé.
Mais c’est surtout sa conduite aux débats qui prouve mieux que tout le reste, que la folie de Jean-Pierre est simulée ; il n’est peut-être pas une de ses réponses qui eût été faite par un aliéné. Nous en citerons quelques-unes.
- Quel âge avez-vous ?
- Vingt-six ans ; (Il en a quarante-trois).
- Avez-vous eu des relations d’affaires avec MM. Pellène et Desgranges (deux de ses dupes) ?
- Je ne les connais pas.
- Reconnaissez-vous le prétendu acte notarié que vous avez remis au témoin ?
- Je n’entends pas cela.
- Devant le Commissaire de police vous avez reconnu cet acte ?
- C’est possible.
- Pourquoi, le jour de votre arrestation, avez-vous déchiré Un billet de 3800 fr. ?
- Je ne me le rappelle pas. [p. 184]
- Vous ayez dit dans vos précédens interrogatoires que c’était parce que le billet avait été acquitté ?
- C’est possible.
A diverses dépositions l’accusé répond qu’il ne se souvient de rien.
- Reconnaissez-vous le témoin (la portière de la maison qu’il habitait) ?
- Je ne connais pas cette femme-là.
- Pourriez-vous indiquer quelque personne qui ait été détenue en même temps que vous à la Force, et qui puisse rendre compte de votre situation mentale à cette époque ?
- Je ne comprends pas cela.
- Vous vous êtes évadé de Bicêtre ?
- Est-ce que vous y avez été, vous ?
- A quelle heure vous êtes-vous évadé ?
- A minuit, une heure, trois heures.
- Sur quelle route avez-vous été ?
- Sur celle de Meaux en Brie (il avait pris celle de Normandie ).
- Pourriez-vous indiquer quel a été l’auteur de l’incendie de Bicêtre ?
- Je ne sais pas ce que vous voulez me dire.
- Vous avez écrit une lettre au capitaine Trogoff le lendemain de votre sortie de Bicêtre ?
- Je n’ai point écrit de lettre (cette pièce est bien de son écriture).
Dans un moment où on accuse Jean Pierre d’avoir commis l’incendie de Bicêtre, il se livre à d’horribles imprécations. Il interrompt, sans cesse le défenseur et l’avocat-général dans leurs plaidoiries, par des dénégations, par des observations ridicules, des emportemens
et des injures.
Parmi les aliénés qui n’ont pas encore perdu complètement la raison, et Jean-Pierre n’est pas dans ce cas, [p. 185] on n’en verrait probablement pas un qui méconnaîtrait les personnes avec lesquelles il aurait eu des-rapports, qui né comprendrait pas-éé que c’est qu’un acté notarié, qui aurait perdu le souvenir denses actions, qui ne salirait pas ce qu’on voudrait lui’ dire lorsqu’on lui rappelerait un événement mémorable, et qui ferait ces autres réponses bizarres que nous avons rapporlées. Ce sont autant de contradictions, de contre- sens extrêmement choquans pour celui qui observe les aliénés.
- Esquirol, interpellé surl’état moral de Jean-Pierre, répond qu’il croit que l’acctisé simule la folie.
- Pariset, à qui la même question est adressée, fait la réponse suivante : « je l’ai examiné pendant son séjour à Bicêtré ; c’est un homme dominé par une fureur habituelle, et qui est porté aux plus grands excès par une disposition constitutionnelle, comme le disent les médecins. Cependant , je dois dire que la lecture de l’acte d’accusation a un peu modifié l’opinion que j’avais émise dans mon rapport. Il y a, dans les faits qui lui sont imputés, une suite, un enchaînement, une connexion, un calcul tellement positif, que cela exclut toute idée d’aliénation mentale; c’est un homme perpétuellement en fureur, mais qui ne voudrait certainëment pas être l’objet de ses propres actions. S’il les rejette pour lui, il est certain qu’il les rejette pour lés autres. Il a donc la notion du mal qu’il fait, ce qui ne se concilie pas du tout avec l’aiénation absolue. Il y a véritablement de la monstruosité dans la conduite de Jean Pierre. C’est un homme mutilé du côté moral ».
Il est probable que le journaliste a mal rendu la déposition de M. Pariset ; on y trouve en effet quelques assertions évidemment contradictoires. Si Jean-Pierre est dans un état de fureur habituelle qui peut le porter aux plus grands excès, s’il y a de la monstruosité dans sa con¬ duite , s’il est mutilé du côté moral, ce doit être un [p. 186] aliéné. M. Pariset n’ignore pas que beaucoup d’aliénés qui n’ont qu’un délire très-limité, ont une conduite régulière sous presque tous les rapports, calculent très-bien leurs actions ; que très-peu de ces malades, excepté ceux qui ont la tentation de se détruire, poudraient être L’objet de leurs actions de fureur. Qu’est-ce qu’une aliénation absolue ?
Nous ferons d’ailleurs observer que cette fureur n’a été remarquée chez Jean-Pierre, que depuis son arrestation.
- l’avocat-général soutient que l’accusé n’est pas fou ; mais l’un des motifs qui lui font solliciter sa condamnation, c’est que, d’après l’opinion de. M. Pariset, Jean-Pierre est un homme dangereux ; M. l’avocat général aurait moins de craintes si en acquittant l’accusé on prononçait en même temps son interdiction, ce, qui est contraire aux lois. Si Jean-Pierre était acquitté, dit-il , il rentrerait dans le droit commun, il recouvrerait sa liberté, il faudrait qu’il fût soumis à l’examen des juges civils, et l’on sait par expérience que lorsqu’il est libre il ne donne aucun signe de folie ; enfin, quoique interdit, il resterait libre, à moins qu’il ne se livrât à des actes de violence et de fureur (17). [p. 187]
Procès de PAPAVOINE (18).
Louis Auguste Papavoine, âgé de 41 ans, ex-commis de première classe de la marine, a été traduit devant la Cour d’assises de Paris, le 23 février 1825, accusé d’avoir commis volontairement, avec préméditation et de guet-apens, un homicide sur la personne de deux enfans en bas âge.
Fils d’un honnête fabricant, Papavoine a reçu une éducation soignée, jusqu’en 1823, il a rempli avec zèle et probité divers emplois dans la Marine. « Mais en tout, dit l’acte d’accusation, Papavoine s’était fait connaître comme un homme dont les mœurs étaient peu sociables ; il fuyait avec affectation ses camarades, il paraissait sombre et mélancolique, on le voyait souvent se promener seul, et il choisissait de préférence les lieux solitaires ; jamais on ne lui a connu de liaisons intimes, ni même aucune de ces faiblesses qu’explique la fragilité humaine, quoique avec juste raison la religion et la morale les condamnent. Jamais il ne communiquait ses pensées à autrui ; cependant sous les rapports qu’exigeaient ses fonctions, on avait toujours trouve ses idées pleines, de justesse et de convenance. »
En 1828, Papavoine apprend la ruine entière de son père ; son caractère, en devint plus sombre et plus irritable ; il éprouva même un accès d’aliénation mentale qui dura environ dix jours. Voici comment deux témoins déposent de cette circonstance : il était, dit un employé de la marine à Brest, dans un état de fièvre ; il disait qu’un homme lui en voulait, qu’il le voyait, qu’il voudrait [p. 188] avoir un pistolet pour se défendre. Je n’ai jamais fait de
mal à personne, disait Papavoine dans son délire ; cet homme me poursuit dans mon sommeil ; quand je m’éveille je ne vois personne. Le défenseur de l’accusé demande au témoin, s’il n’est pas résulté pour lui la pensée que Papavoine était en démence : je l’ai aussi pensé pendant sa maladie que j’ai regardée comme accidentelle, a répondu le témoin. Un officier de santé, qui a donné- des soins à Papavoine, dit que ce dernier était naturellement sombre, soupçonneux, croyant toujours qu’on s’occupait de lui , fuyant la société des femmes, et souvent celle des hommes. Dans sa maladie, son caractère était exaspéré ; il voyait, disait-il, un ennemi secret qui se montrait dans l’ombre et en voulait à ses jours, il aurait voulu le voir à découvert pour lui en demander raison ; ce fantôme paraissait beaucoup le tourmenter. Le président demandant au témoin si ce n’était pas la lièvre qui faisait ainsi parler Papavoine, le témoin répond négativement, attendu, dit-il, que Papavoine n’avait pas de fièvre. Je le jugeai, ajoute-t-il, plus malade au moral qu’au physique. Pensez-vous, qu’il fut en démence, demande le président ? Je le croyais, dit le témoin, ainsi que tout le monde, mélancolique et hypocondriaque. — Manifestait-il le goût du sang ? — Jamais ; il caressait même de jeunes enfans, les embrassait et leur donnait des sucreries. Le défenseur dit qu’à cette époque l’accusé donna deux fois sa démission de la place de commis de première classe qu’il occupait à Brest, tandis que les désastres de sa famille devaient l’attacher davantage à cette place.
Anales dramáticos del crimen, 1858 – Infanticidio cometido por L.A. Papavoine. La muerte.
Son père mourut quelques mois après. Papavoine ne balança pas à donner de nouveau sa démission, pour aller aider sa mère dans la gestion de ses affaires. En 1824, de nouveaux malheurs viennent détruire toutes ses espérances ; la manufacture de sa mère ne peut plus être soutenue ; il redemande de l’emploi dans l’administration [p. 189] sans pouvoir en obtenir. Ses dispositions mélancoliques augmentent, il perd le sommeil, sa raison s’égare par fois ; un jour il se présente à sa mère d’un air sinistre, un papier à la main, et lui dit : mon frère n’est pas mort ; j’en ai la preuve dans ce papier ; on enterre quelquefois des hommes qui ne sont pas morts. Cette circonstance fut rapportée aussitôt par la mère elle-même au médecin qui donnait des soins à Papavoine. Cependant aucun habitant du pays de l’accusé n’avait entendu dire qu’il fût atteint de folie.
Le 2 octobre, on lui conseille d’aller passer quelques jours chez un de ses amis pour prendre un peu de distraction ; sa mère écrit en même temps pour faire surveiller son fils, et elle désire surtout qu’il ignore celle précaution. « Vous avez vu Auguste, disait-elle, il a été purgé par un vomitif; examinez ses yeux et sa conversation ; surtout qu’il ne sache pas et ne se doute pas que je vous ai écrit. Je vous engagea venir mercredi ; je vous dirai des choses que je ne puis écrire. » L’ami chez qui Papavoine s’était rendu, fait la déposition suivante : « L’accusé lui a paru visiblement changé, au physique et au moral. En se promenant ensemble dans- le jardin, l’accusé s’écrie tout-à-coup, avec l’accent du désespoir : Quoi ! pas un instant de bonheur ! je crois parfois que je suis fou ! un papier lui tombe sous la main ; il y remarque les lettres O. N. ; qu’est-ce que cela veut dire, demande-t-il à son hôte, de l’air le plus inquiet ? Mais vraiment je n’en sais rien, lui répond celui-ci, cela ne signifie rien. Cela veut dire : on noyé ici. Une autre fois il s’adresse encore au témoin : Mon frère et mon oncle sont-ils bien morts ? — Votre frère ? mais vous avez dans vos papiers son extrait mortuaire ! votre oncle ? mais vous savez qu’il est mort à mes côtés, à table, d’un coup d’apoplexie ! vous avez concouru à régler sa succession. — Ah ! c’est qu’il y a tant de genres de mort ! et souvent on enterre des gens [p. 190] qui vivent encore, et on dresse des actes pour constater qu’ils ne vivent plus. On lui propose un perruquier, l’idée des rasoirs le fait frémir. Que veut-on de moi, s’écrie-t-il tout troublé ? Au surplus je ne crains ni le rasoir, ni le pistolet. »
Le 6 octobre il quitte Beauvais pour se rendre à Paris, où des affaires urgentes Rappelaient. « Il était très-agité en parlant » dit le témoin dont nous venons de donner la déposition. Il s’agissait d’accepter des marchés avec le gouvernement, fort désavantageux pour la maison Papavoine. Le 7, il voit un banquier qui doit approuver les marchés ; mais il faut quelques jours pour les examiner. Le 8 et le 9, il fait quelques promenades solitaires ; le 10, il se dirige vers le bois de Vincennes. Là il aperçoit une dame qui promenait deux jeunes enfans ; il retourne au Village et y achète un couteau ; il revient aussitôt près de cette dame ; « il avait la figure pâle, dit l’acte d’accusation ; sa voix était troublée. Votre promenade a été bientôt faite, dit-il à cette dame, et se baissant comme pour embrasser l’un des enfans, il lui plongea son couteau dans le cœur ; pendant que la malheureuse rnère s’occupait de cette première victime, Papavoine plongea son couteau dans le cœur de l’autre enfant, s’enfuit ensuite à pas précipités et s’enfonça dans le taillis. »
Papavoine dit avoir caché aussitôt le couteau meurtrier dans la terre. Il rencontre bientôt un militaire qui, à l’audience, fait la déposition suivante : « Je fus abordé par l’accusé ; il me demanda l’issue de la forêt. Nous marchâmes ensemble ; il portait avec inquiétude ses regards autour de lui, et me demanda s’il n’avait pas de taches sur la figure ; il regardait aussi ses bras et ses mains, demandant s’il n’était pas marqué de quelque chose ; il marchait à grands pas, était pâle et tout essoufflé ; nous nous arrêtâmes sous un arbre à cause de la pluie ; là, un gendarme vint [p. 191] l’arrêter, disant qu’on venait d’assassiner deux enfans ; vous perdez votre temps en m’arrêtant, répondit l’accusé ; vous donnez le temps à celui qui a commis le crime de prendre la fuite. On le conduisit à Vincennes ; en chemin, il dit que c’était une chose abominable d’avoir tué des enfans, que si l’on avait à se plaindre d’une grande personne, on pouvait l’appeler en duel, mais que pour assassiner des enfans il fallait avoir de grands motifs. » Le gendarme qui a arrêté Papavoine confirme le propos tenu par ce dernier au moment de son arrestation ; il ajoute que l’accusé n’avait rien de remarquable dans la figure, qu’il n’avait point l’air agité, que seulement il chancelait un peu en marchant.
Conduit devant l’autorité de Vincennes, confronté avec la mère des enfans, avec la marchande qui avait vendu le couteau, reconnu par elles et par un autre témoin, Papavoine nie avec beaucoup de sang-froid d’être l’auteur du crime. Confronté avec ses deux victimes, il montre la même impassibilité.
Depuis le 10 octobre jusqu’au 15 novembre il s’est renfermé dans un système complet de dénégation. Il paraît même que dans ses interrogatoires il s’est défendu avec une habileté peu commune, combattant et s’efforçant d’expliquer toutes les circonstances qui lui étaient rappelées, citant des exemples de causes célèbres où des individus avaient été pris pour d’autres. Mais enfin, « accablé par l’évidence des preuves, dit l’acte d’accusation, et sentant qu’il s’était, par ses dénégations absolues, frayé la plus dangereuse de toutes les routes, il prit le parti de développer avec beaucoup d’adresse un nouveau système. II se reconnut coupable de l’assassinat des deux enfans ; mais il annonça qu’il s’était trompé en donnant la mort aux deux enfans de la demoiselle Hérein, et que son intention avait été, en égorgeant deux enfans bien autrement [p. 192] précieux (19), de plonger la France entière dans le désespoir et la douleur. Cette horrible explication, démentie par la vraisemblance, par les faits, et même par les opinions politiques de Papavoine, n’a trompé personne : on n’a vu en elle que la base d’un nouveau système de défense adopté par l’accusé et développé ensuite par lui avec une barbare habileté pour donner à croire sans doute qu’il est atteint d’une démence furieuse. En effet, à la même époque, il demandait à des prisonniers de lui procurer un couteau bien pointu : il se levait pendant la nuit et feignait d’en chercher un ; un autre jour il tentait de mettre le feu à son lit. Enfin, le 17 novembre, étant dans la prison, il se saisit avec violence d’un couteau qui était entre les mains d’un prisonnier, et il frappa avec cette arme un jeune bomme qui ne lui avait donné aucun sujet de plainte. »
L’acte d’accusation s’exprime ainsi sur le caractère des actes meurtriers de Papavoine :
« La cause commune des crimes est l’intérêt. Quel intérêt a-t-on pu avoir d’égorger deux pauvres enfans naturels ? Si Papavoine n’est qu’un instrument, qui l’a mis en œuvre ? Est-ce la famille Gerbod (puisqu’il ne faut reculer devant aucune; supposition) qui a ordonné leur mort pour empêcher un mariage qu’elle ne voulait pas ? (20) Tous les renseignemens produits dans l’instruction contrarient cette hypothèse. » (21).
« Si Papavoine n’a pas de complice, quel a pu être à lui-même son propre mobile ? Il a osé s’en donner un qui fait frémir. Vaincu par les preuves, et ne pouvant [p. 193] échapper à une funeste évidence, il a voulu décor er son. forfait, en le retirant de l’ignobilité des simples, assassinats, pour le relever jusqu’à la dignité de forfait politique. Tout a démenti cette infâme explication. »
Pourrait-on supposer que son action est le résultat d’une affreuse démence ? C’est sûrement ce qu’a voulu et ce que veut prouver Papavoine ; c’est pour faire croire à sa démence qu’il se proclame plus scélérat encore qu’il ne l’est ; c’est pour faire croire à sa démence qu’il a tenté de commettre un second meurtre sans cause et sans intérêt. Mais ses efforts à cet égard sont vains, et l’on n’a pu retrouver dans l’instruction aucun fait qui donne lieu de penser que sa raison ne soit en général dans la mesure de celle des autres hommes. Loin de cela, ses interrogatoires sont de vrais chefs d’œuvre de dialectique, de lucidité d’idées et de suite dans les raisonnemens. Il suffit de les lire, il suffit aussi de le voir et de l’entendre pour rester convaincu que Papavoine n’est pas un être désorganisé ; qu’il est un homme qui pense, parle et agit comme un autre, qui a des lumières comme un autre, qui a suffisamment de raison, quand il veut la consulter, pour en être éclairé comme un autre. »
« Il se peut bien, sarts doute, que cette raison ne soit pas toujours la plus forte, comme il arrive chez les autres hommes, contre les passions ; il se peut bien qu’il y ait dans le secret de son organisation, triste, sombre, atrabilaire, quelques vices horribles, quelques instincts de férocité, native, quelques goûts de cruauté bizarre, quelques affreux caprices de misanthropie, poussés jusques à une sorte de rage contre les individus plus heureux que lui, et que, semblable à bien d’autres penchans vicieux propres à l’espèce humaine, et dont elle ne triomphe qu’avec des combats et de la force de volonté, cette disposition diabolique comme naguère on l’a vu d’un autre misérable du même caractère (Léger), l’ait [p. 194] entraîné à une barbare soif du sang d’autrui, et à assouvir une jalousie forcenée du bonheur de ses semblables. Et peut-être serait-ce là qu’il faudrait aller chercher l’explication de son crime. »
« Peut-être l’action de Papavoine est-elle le résultat de quelque épouvantable mystère que n’a pu découvrir, malgré les efforts soutenu de leur zèle, la sagacité des Magistrats. Mais tout cela deviendrait trop conjectural, et la justice n’a pas besoin de plonger dans les abîmes du cœur humain : tout ce qu’elle a besoin de connaître est prouvé ; le crime est constant ; les cadavres de deux malheureux enfans sont-là. Le coupable est convaincu, les preuves l’accablent, ses aveux confirment les preuves. La loi est-là qui prononce sur le sort de ceux qui, par cupidité, où par jalousie, ou par vengeance, ou par instinct de férocité, se baîgnent volontairement dans le sang des hommes. Il est permis d’être incertain sur la vraie cause du crime : on ne saurait l’être sur le crime même ; le reste est entre Dieu et la conscience du coupable ; la’ justice humaine en sait assez pour défendre la société. »
Suivons maintenant Papavoine aux débats. Voici une partie de ses réponses :
- Pourquoi, en vous rendant de Beauvais à Paris, avez-vous emporté dans votre valise deux couteaux de table ?
- J’ai eu l’honneur de vous dire que j’étais extrêmement malade ; je me levais au milieu de la nuit. Je m’étais forgé mille chimères ; j’avais coutume de placer la nuit près de moi une épée et des pistolets chargés. N’ayant pas apporté d’armés dans mon voyage, j’ai pris deux couteaux que je mettais, l’un dans le traversin, l’autre sur ma table de nuit.
- Dans quel but êtes-vous aller le dimanche 10 octobre à Vincennes ?
- Je n’avais aucun but, et la fermentation que [p. 195] j’avais dans la tête s’augmentait à mesure que je marchais.
- N’avez-vous pas rencontré sur le chemin de Vincennes une jeune dame que vous avez suivie jusqu’à l’entrée du parc ? Lorsqu’elle a rencontré les petits Gerbod et les a embrassés, ne lui avez-vous pas demandé si elle connaissait ces enfans ?
- Je ne me le rappelle pas. J’étais continuellement tourmenté ; je ne sais ce que j’ai fait, je ne me souviens d’aucune circonstance (22).
- Comment; se fait-il que vous ayez rappelé ces circonstances avec fidélité dans l’instruction, et que vous les ayez oubliées maintenant ?
Après voire court entretien avec cette jeune dame, et avoir vu les enfans, vous êtes rentré dans Vincennes, et vous avez acheté un couteau ? - C’est possible ; je ne m’en souviens pas.
- Le 29 novembre vous vous en êtes parfaitement souvenu à l’instruction.
Pourquoi avoir acheté un couteau, si ce n’était pour égorger ces malheureux enfans ? - En examinant le château de Vincennes, mes yeux se sont portés sur le donjon. Persuadé, dans ma folie, que des prisonniers y étaient encore renfermés, j’ai acheté le couteau pour délivrer ces malheureux prisonniers. Pouvez-vous me supposer un autre motif, pouvez-vous croire que j’aurais acheté un couteau pour aller, à deux cents pas de-là, tuer en plein jour ces malheureux enfans ?
- Cependant c’est quelques minutes auparavant que vous aviez demandé à qui appartenaient les enfan ; vous pensiez donc à ces enfans, et non aux prisonniers de Vincennes. Mais si vous songiez à délivrer ces derniers, [p. 196] pourquoi ne pas vous diriger vers le donjon, au lieu d’aller vers les enfans ?
- « Je suis allé au hazard dans le bois ; je ne sais quelle fatalité me porta vers ces malheureux enfans ; je les frappai ; je, voudrais au prix de tout mon sang pouvoir les rappeler à la vie..:… je ne puis penser le motif…. j’avais la tête tellement embarrassée, le sang me portait tellement au cerveau…. jetais tellement agité que je ne puis me rendre compte de ce qui s’est passé.
- Il y avait préméditation dans votre fait ; car avant de frapper les enfans, vous vous êtes penché vers l’un d’eux ; quelle était votre pensée, votre motif en les frappant ?
- Je n’en avais aucun ; j’ignore quel put être mon motif.
- Lorsqu’un gendarme est venu vous arrêter, vous lui avez dit : vous perdez votre temps ; pendant que vous me retenez, le coupable aura fui.
- Il est possible que j’aie dit cela ; je me suis défendu de cette action, cherchant à me persuader à moi-même que je ne l’avais pas commise, tant j’en étais étonné.
- Persistez-vous à dire que vous aviez voulu frapper d’augustes victimes.
- Non…. j’étais tellement fatigué de la position pénible où je me trouvais, que ne pouvant me détruire, j’aurais voulu hâter par tous les moyens possibles la fin de mes tourmens ; je me serais accusé, je crois, d’avoir voulu assassiner le Père éternel si la chose m’était venue dans l’idée.
- Vous dites donc que vous aviez une espèce de fièvre chatide ; cependant à Reauvais, où vous avez passé six jours, votre tante ne s’est point aperçue de cet état de démence : on n’a rien vu de pareil non plus ni à l’hôtel de la Providence, à Paris, ni dans votre correspondance.
- Cependant M., je me rappelle qu’en me promenant [p.197] dans le jardin du Luxembourg, je me dis avec un accent déchirant : pas un moment de bonheur ! je suis donc atteint de folie !
- Cependant votre mère n’a pas remarqué votre démence (23), pas plus qu’un témoin avec qui vous avez passé une soirée entière la veille de l’événement. Votre conduite ce jour-là même annonce un homme sain d’esprit. Vous demandez à la fille Malservet si elle connaissait les deux enfans, vous achetez un couteau, vous les frappez, vous prenez la fuite, vous enterrez le couteau, vous montrez de la sécurité au canonnier que vous rencontrez ; voilà qui décèle une raison complète.
- Il n’y a pas d’effet sans cause ; or, quel aurait été l’intérêt de commettre un tel crime ?
- C’est ce que l’instruction n’a pu découvrir ; mais ce qu’elle a découvert, c’est que le crime a été commis avec toutes les circonstances qui dénotent de votre part un profond calcul.
- Si j’avais voulu les frapper, j’aurais apporté un couteau de Paris ; j’en avais deux parmi mes effets.
- Confronté avec la mère des enfans vous dites ne la pas connaître ; on vous présente les corps des deux enfans, vous niez votre crime. Encore un coup ce n’est pas là la conduite d’un homme atteint de folie ; il faudrait que vous eussiez été en démence à la vue seulement des deux enfans, ne l’ayant été ni avant ni après. Ce n’est pas tout : vous êtes interrogé le même jour par le maire et le juge de paix dé Vincennes, vous niez tout ; vous expliquez votre voyage, votre arrivée à Vincennes.
- J’étais tellement épouvanté par la pensée de ce crime, que je cherchais en vain à me persuader que je [p. 198] l’avais commis ; je ne pouvais y parvenir ; je craignais aussi pour ma famille.
- Pendant six semaines vous avez toujours nié ; toutes vos réponses étaient pleines de sens ; elles annonçaient même un esprit supérieur ; vous donniez des raisons très-plausibles, vous citiez des exemples des causes célèbres ; et ce n’est que pressé par les déclarations positivés des témoins que vous faites un aveu. Ainsi, pendant les six semaines vous avez encore joui de la plénitude de votre raison. Vous avez ensuite changé de système ; vous avez prétendu que vous aviez été à l’Opéra pour assassiner les princes ; effectivement, vous aviez été à l’Opéra : vous avez dépeint la voiture des princes ; effectivement cette circonstance était exacte. Vous voyez bien que vous n’étiez pas en démence. Votre folie, dites-vous, consistait en terreurs paniques et soudaines ; cependant, en voulant délivrer les prisonniers, votre folie alors aurait changé de caractère.
- La folie n’est pas uniforme.
- Mais cette folie ne serait donc qu’une monomanie qui laisserait des intervalles lucides ; car aujourd’hui vous n’êtes pas en démence ; ce serait donc une soif de sang, et ce ne serait pas, comme vous le dites, une terreur qui vous dominait. Mais pourquoi acheter ce couteau à Vinciennes ?
- C’était une grande imprudence de ma part ; je devais être fou pour le faire.
- Ceci prouve au moins que vous avez aujourd’hui votre raison.
- N’avez vous pas frappé, le 17 novembre dernier, le nommé Labiét.
- Il y avait beaucoup de prisonniers autour de moi, j’étais accablé par l’instruction ; je l’ai frappé dans un accès de frénésie ; je suis bien content de ne l’avoir pas tué.
- L’accusation en tire cette conséquence, que vous [p. 199] l’avez frappé pour rendre plus vraisemblable votre système de démence.
Plusieurs habitans de Vincennes. qui ont vu Papavoine peu d’instans avant qu’il commît le crime, disent qu’il avait l’air fort tranquille, qu’il n’avait rien d’extraordinaire dans la physionomie, ni dans son maintien, qu’il s’est présenté dans une boutique très-doucement et très-poliment.
Un prisonnier de la Force raconte qu’une nuit, vers onze heures, Papavoine voulut mettre le feu à sa paillasse.
- (A l’accusé) : quelle était votre dessein en agissant ainsi ?
- Je n’en avais aucun.
- A l’instruction, vous avez dit que c’était une plaisanterie de votre part ?
- En effet, c’était une plaisanterie,…. une mauvaise plaisanterie même.
- Vous n’étiez donc pas alors en état de démence,
Un autre prisonnier déclare que Papavoine l’avait prié de demander à sa femme un couteau.
- (A l’accusé) : que vouliez-vous faire de ce couteau ?
- Je voulais me détruire (24).
- Vous n’avez pas donné cette explication à l’instruction. Mais alors pourquoi, au lieu de vous frapper, avez-vous frappé Labiet ?
- C’était un mouvement spontané que je ne puis expliquer.
- L’accusation en tire la conséquence que vous vouliez donner le change, en faisant croire à votre démence.
- MM. les jurés interpréteront le fait comme ils le voudront : les menottes, la camisole, les mauvais traitement [p. 200] m’avaient réduit au désespoir ; quand j’ai frappé Labiet, je n’étais pas maître de mes sens.
Le concierge de la Force fait la déposition suivante : je fus appelé après le dernier crime, j’interrogeai l’accusé ; il me répondit qu’il n’avait aucun motif de haine contre Labiet. Mais ensuite l’ayant conduit dans un chemin de ronde, il me dit qu’il avait frappé ce jeune homme parce qu’il était de la faction d’Orléans.
- (Au témoin ) : dans quel état mental se trouvait l’accusé avant cet événement ?
R.. Cet homme était quelquefois dans un état épouvantable ; il avait des momens de fureur ; il ne disait pas grand-chose, mais ses cheveux se hérissaient ; et c’est la seule fois que j’aie vu des cheveux se hérisser ainsi. Sa figure alors devenait d’un rouge très-vif ; il épouvantait jusqu’aux soldats qui l’environriaient.
- (Au témoin) : quelle est votre opinion sur le crime commis contre Labiet ?
- J’ai d’abord cru que c’était un calcul de la part de l’accusé ; cependant en y réfléchissant, cette idée a changé.
- (Au témoin) : Papavoine a maintenant les cheveux hérissés ; les avait-il ainsi lors de ces momens dont vous parlez.
- Papavoine est calme maintenant ; si vous pouviez, le voir dans ses accès, ce serait bien différemment.
Un médecin du pays de Papavoine, interpellé sur l’état mental du père de ce dernier, répond qu’il avait parfois des accès de fureur ; alors il brisait tout : c’était un homme morose, maniaque, mélancolique ; il avait quelquefois des accès d’aberration mentale.
Le président a lu diverses lettres de l’accusé, écrites depuis son arrestation, et qui ne présentent aucun indice d’aliénation mentale. Pour donner au jury une idée de la présence d’esprit déployée dans l’instruction par [p. 201] l’accusé, le président lit un de ses interrogatoires ; cet interrogatoire et les réponses de l’accusé sont un vrai chef-d’œuvre de dialectique.
L’avocat-général dit que si la haine, la vengeance, l’ambition et la cupidité sont en général les seules passions qui portent les âmes perverses aux crimes dont la société souffre et s’afflige, on a malheureusement vu des hommes se rendre coupables par une tendance désordonnée pour le vice, et dans l’unique but de satisfaire une férocité dont la nature humaine est ordinairement exempte. Il cite, à l’appui de cette opinion, Don Carlos d’Espagne, qui n’avait pas de plaisir plus vif que celui de voir palpiter des animaux qu’il faisait égorger. Il pense que la soif du sang est le seul motif qui ait porté l’accusé au crime, et établit une analogie sensible entre Papavoine et Antoine Léger, ce monstre, cet anthropophage, qui dernièrement a été condamné par la Cour d’assises de Versailles. L’avocat-général fait d’ailleurs observer au jury qu’il suffit à la justice d’avoir constaté le crime et trouvé le coupable, pour que la société soit vengée ; qu’il resterait à connaître le mobile qui l’a fait agir, mais que cette recherche est superflue, puisque le crime est manifeste.
Le défenseur de Papavoine rassemble avec beaucoup d’art les faits qui lui paraissent démontrer l’aliénation mentale de Papavoine. Ce plaidoyer a dû produire beaucoup d’effet sur les auditeurs ; j’ai vu peu de personnes qui, après l’avoir lu, n’aient été de l’avis de M. Paillet. S’il n’a pas opéré la conviction du jury, je crois que c’est uniquement parce que, dans le monde, on se figure que tous les fous doivent être continuellement dans un état complet de déraison et de fureur ; tandis que Papavoine n’a pas cessé de montrer beaucoup de raison dans ses interrogatoires et aux débats. Ce n’est pas que nous partagions entièrement l’opinion de l’avocat, ni que nous [p. 202] pensions qu’elle soit adoptée par tous les médecins qui ont l’habitude de voir des fous ; nous verrons même tout à l’heure qu’il est difficile de découvrir la vérité sur l’état mental de Papavoine. Mais des hommes du monde, qui ne peuvent aussi bien apprécier certains caractères des actions des insensés, devaient être entraînés par les argumens du défenseur. M. Paillet a même fait des citations fort heureuses des ouvrages de MM. Pinel, Esquirol et Fodéré, pour montrer que la perversion morale peut exister sans aberration des idées, que la fureur peut être périodique, et laisser des intervalles parfaitement lucides ; pour prouver que la folie est souvent héréditaire, précédée par le tempérament mélancolique, causée par de violens chagrins, que cette maladie présente fréquemment les symptômes observés chez Papavoine, etc. Mais, je le répète, on fera difficilement comprendre au public qu’il est des fous qui ne déraisonnent et n’extravaguent pas continuellement.
Quel est le caractère moral des actions de Papavoine ? A-t-il été poussé au meurtre par la démence ou par des motifs inconnus ? En un mot, était-il aliéné, était-il raisonnable lorsqu’il a tué les enfans Gerbod et blessé le jeune Labiet ?
Qu’il nous soit d’abord permis de dire deux mots de quelques assertions de l’acte d’accusation et du plaidoyer de l’avocat-général.
Suivant l’acte d’accusation, la justice n’a pas besoin de découvrir le mystère qui couvre l’action de Papavoine ; le crime est constant, car les deux cadavres des enfans sont-là, et le coupable est convaincu. Il est permis d’être incertain sur la vraie cause du crime, mais non sur le crime même ; la justice humaine en sait assez pour défendre la société. Suivant l’avocat-général, il est superflu de rechercher le mobile qui a fait agir Papavoine, puisque le crime est manifeste. [p. 203]
Mais « ce n’est pas le crime matériel que les lois punissent : c’est l’intention de commettre le crime ; ce n’est pas l’acte de la main, c’est celui de la volonté (25). » Or, pour arriver à cette distinction, suffit-il de constater les résultats du délit ? Ne faut-il pas remonter à ses causes ? Si le mobile des actes meurtriers de Papavoine était la folie, le crime serait-il manifeste ? Lorsqu’il serait d’une si haute importance, pour décider si cet individu était aliéné ou non, de savoir s’il a été guidé par des motifs puisses de cupidité ou de vengeance, peut-on dire que la justice n’a pas besoin de découvrir le mystère qui couvre le meurtre de Vincennes ? Les deux cadavres montrent qu’on a donné la mort à deux enfans, mais ne prouvent pas qu’un crime ait été commis ; car il n’y a ni crime ni délit lorsque le coupable est en démence au moment de l’action (26) ; et Papavoine pouvait être dans ce cas. Sans doute les actions criminelles dont on ne découvre pas les motifs, ce qui est fort rare, ne doivent pas rester impunies. Mais en pareille circonstance, surtout lorsqu’il existe des indices nombreux de folie chez l’auteur du crime, comme chez Papavoine, par exemple, il nous semble qu’il n’est pas si indifférent de rester dans l’ignorance du mobile qui l’a fait agir.
Suivant l’acte d’accusation, la loi prononce sur le sort de ceux qui, par cupidité, ou par jalousie, ou par vengeance, ou par instinct de férocité, se baignent volontairement dans le sang des hommes.
La loi punit les crimes commis volontairement. Mais il s’agit de savoir si un homme dominé, accidentellement, par un instinct de férocité, jouit de sa raison, et peut commettre, suivant la loi, volontairement des crimes. Or, je ne doute point que de pareils êtres ne soient [p. 204] de véritables aliénés. Il y a chez eux une épouvantable perversion morale. Ces infortunés sont affectés de la manie sans délire, de M. Pinel, et dont cet auteur rapporte plusieurs exemples remarquables. Supposons qu’un homme se dise dévoré de la soif du sang humain, et poussé à commettre des meurtres : cela ne suffira-t-il pas pour le faire enfermer dans une maison de fous, et interdire de la gestion de ses biens et de sa personne ? Et si ce même individu a pu commettre une action abominable, ne sera-t-il plus un aliéné ? Ainsi, sans s’en douter, l’auteur de l’acte d’accusation et l’avocat-général préparaient la justification de Papavoine, en attribuant son crime à la soif du sang, ou à un instinct de cruauté dégagé de toute espèce d’intérêt.
Voici les faits qui paraissaient prouver que les actes meurtriers de Papavoine ont été le résultat de l’aliénation mentale:
1° Le meurtre des deux enfans n’a pu être commis, par un homme raisonnable et d’une condition honnête, que pour des motifs puisssans, pour de grands intérêts ; et à moins qu’il n’ait été inspiré par le fanatisme politique, il est évident qu’il a fallu le concours de plusieurs volontés ; des propositions ont dû être faites, une récompense convenue, des garanties données de part et d’autre, des desseins arrêtés pour l’exécution du crime, etc., etc. ; en un mot, Papavoine devait avoir des complices ; il a fallu du temps et de nombreuses démarches pour concevoir, proposer, et arrêter le projet d’assassinat, pour se décider à l’exécuter. Il est également évident que si l’idée de tuer les deux enfans n’est venue à Papavoine qu’au moment où il les a vus, le meurtre qu’il a commis doit être considéré comme un acte de folie : car il ne pouvait y avoir ni préméditation, ni volonté. Jamais, en effet, on n’a vu un être doué de raison, concevoir un pareil dessein si instantanément et sans le moindre motif d’intérêt. [p. 205]
Or, il paraît prouvé que Papavoine ne voulait point assassiner les enfans de madame la duchesse de Berry ; un homme comme lui ne pouvait d’ailleurs ignorer que ces enfans ne vont pas se promener sans être accompagnés de plusieurs personnes. La police, malgré sa vigilance, les magistrats, malgré leur zèle, n’ont pu découvrir le moindre indice qui pût faire soupçonner que Papavoine ait eu des complices. Il ne connaissait aucun des membres de la famille Gerbod, et n’était connu d’aucun d’eux ; peu d’instans avant de monter à l’échafaud, il a encore déclaré que cette famille était parfaitement innocente. Aurait-il commis quelque méprise grave, aurait-il eu en vue d’autres victimes ? cela est possible, mais rien ne le donne à penser.
Mais en admettant que Papavoine ait conçu et prémédité son projet long-temps d’avance, l’exécution ne pouvant être qu’éventuelle, on ne conçoit pas comment il ne s’est pas muni d’un couteau avant d’aller à Vincennes ; il devait bien penser que l’achat de l’instrument meurtrier, fait si près du théâtre du crime, ne pouvait manquer de le compromettre gravement; était-il même bien assuré d’en trouver de convenable dans un village ? Dans l’instruction, on a cherché à établir que Papavoine n’avait acheté le couteau qu’après avoir vu les enfans. Le défenseur, au contraire, a voulu prouver qu’il était impossible que Papavoine ait eu le temps, entre la vue des enfans et l’acte meurtrier, d’aller faire cet achat. Je ne sais laquelle de ces deux versions est plus favorable à l’accusé ; la première semblerait annoncer que la vue seule des enfans a donné l’idée de les tuer, que la préméditation a à peine existé, qu’aucun motif intéressé n’a guidé Papavoine, et que le meurtre a été un acte de folie. La seconde, au contraire, ne semblerait-elle pas indiquer que Papavoine ayant oublié l’instrument du crime, et espérant trouver l’occasion de le commettre, [p. 206] a cru devoir réparer promptement son omission ? Car autrement, en le supposant doué de raison, on ne voit pas quel motif l’aurait porté à acheter un couteau lorsqu’il en avait deux chez lui. Cependant, la version du défenseur rend moins invraisemblable l’explication donnée par Papavoine du projet insensé qu’il avait, dit-il, en achetant le couteau, d’aller délivrer des prisonniers renfermés dans le donjon de Vincennes. En effet, si l’achat du couteau a été provoqué par la vue des enfans, le meurtre a suivi de trop près, pour qu’on ne voie pas dans ces divers actes l’exécution d’une même pensée.
2° Le père de Papavoine a été sujet à des aberrations mentales, à des accès de fureur. Plus de la moitié des folies sont héréditaires. Cette circonstance seule n’est sans doute pas d’un grand poids pour prouver l’état d’aliénation mentale de Papavoine : mais réunie aux autres preuves elle ne laisse pas d’avoir beaucoup de valeur.
3° Papavoine avait une constitution éminemment mélancolique et un commencement d’état hypocondriaque, caractérisé par son amour pour la solitude, sa misanthropie, etc. On peut presque assurer qu’un tel homme, déjà sous l’influence d’une cause héréditaire, tombera dans l’hypocondrie ou l’aliénation mentale, s’il éprouve des revers de fortune, si, surtout, il a à se plaindre de ses semblables. Or, Papavoine a vu sa famille ruinée par l’abus de confiance d’un oncle, il s’est trouvé sans place et peu après sans ressource pour lui et sa mère ; il ne serait pas étonnant qu’il eût perdu la raison, il serait peut-être plus extraordinaire qu’il l’eût conservée.
4° Il est positif qu’il a eu un court accès de folie à Brest en 1823, environ une année avant le meurtre des deux enfans. Il paraît certain aussi que peu de temps et même quelques jours avant ce funeste événement , il avait semblé ne pas jouir entièrement de l’exercice de ses facultés. Le défenseur dit que la lettre dans laquelle la [p. 207] mère de Papavoine manifestait ses inquiétudes à ce sujet, a été acceptée sans réserve par l’accusation. Remarquez qu’elle a été écrite le deux octobre, et que le meurtre a été commis le dix du même mois.
5° La tentative de meurtre faite sur le jeune Labiet ne prouverait point en faveur de l’opinion que nous défendons maintenant, sans le concours des circonstances qui viennent à l’appui de cette opinion. Les deux attentats de Papavoine doivent reconnaître la même cause ; s’il était fou lorsqu’il a tué les deux enfans, il l’était également lorsqu’il a voulu tuer Labiet.
6° Une déposition extrêmement importante est celle du concierge de la prison. Il a, dit-il, douté d’abord ; mais bientôt il a été convaincu que Papavoine était sujet à de véritables accès de manie furieuse, dont il a été témoin plusieurs fois. Durant ces accès, ajoute-t-il, il s’opérait des changemens physiques remarquables : la figure devenait d’un rouge vif, les cheveux se hérissaient ; dans cet état il épouvantait jusqu’aux soldats qui l’environnaient.
7° Les explications que donne un accusé qui se défend sont sans doute fort suspectes, surtout lorsqu’elles sont favorables à sa cause. Mais ici, je le répète, il faut avoir égard aux autres circonstances du crime. Il y a des indices puissans d’aliénation mentale chez Papavoine, on ne découvre aucun motif d’intérêt ou de vengeance qui ait pu le pousser au crime : l’accusé ajoute que ses actes criminels ont été indépendans de sa volonté, qu’il avait sa raison complètement égarée lorsqu’il s’en est rendu coupable ; cette explication, qui peut être fausse, n’est pourtant pas invraisemblable. Papavoine a encore dit, peu d’instans avant d’aller à l’échafaud, qu’il n’avait pas de complice, et que les attentats qu’il payait de sa tête étaient incompréhensibles pour lui, qu’ils étaient bien réellement l’effet d’un dérangement de ses facultés. [p. 208]
8° La raison parfaite que Papavoine a montrée dans ses interrogatoires et aux débats ne prouve point du tout l’absence de la manie furieuse. Celle-ci est souvent périodique, et elle existe quelquefois sans aberration des idées. Lorsqu’elle est périodique, les malades jouissent de leur pleine raison dans les intervalles lucides. Lorsqu’elle existe sans délire, les actes de violence, de fureur, de cruauté, n’empêchent pas les malades de ne présenter aucune incohérence dans les idées. Chez Papavoine la fureur était périodique, qu’elle fût simulée ou réelle.
9° Si Papavoine a été dominé par un instinct meurtrier, comme l’auteur de l’acte d’accusation et l’avocat-général sont portés à le penser, c’est une preuve, suivant nous, qu’il était aliéné. Mais si cet instinct eût existé, l’accusé n’avait aucun intérêt à le cacher ; à moins qu’il ne pensât comme les deux personnes que nous venons de citer, qu’une perversion morale aussi profonde n’est pas le résultat de la folie, lors même qu’elle se manifesté accidentellement chez un homme naturellement doux et honnête, et qu’elle ne serait point employée pour servir de vils intérêts de cupidité ou d’atroces projets de vengeance.
Ainsi, on n’a pu découvrir de motif intéressé qui ait pu porter Papavoine au crime, motif qui devait être d’autant plus puissant que le crime était atroce ; Papavoine était fortement disposé à l’aliénation mentale par une disposition de famille et par sa constitution mélancolique ; à Brest il a été en proie à des souffrances morales qui l’ont jeté dans le délire ; peu de temps avant de commettre le meurtre de Vincennes, il a encore présenté des signes d’une aberration mentale ; le concierge de la prison a cru remarquer en lui des accès véritables de manie furieuse ; il a voulu commettre un meurtre depuis son arrestation ; il attribue ses actes criminels à un [p. 209] égarement de la raison : tous ces faits paraissent prouver que Papavoine était réellement dans un accès de manie furieuse lorsqu’il a commis l’attentat de Vincennes, aussi bien que lorsqu’il s’est jeté sur le jeune Labiet et l’a frappé de coups de couteau.
Mais il est aussi des faits qui semblent contrarier cette manière de voir ; les voici :
1° Papavoine ne pouvait faire de révélations, sans se rendre mille fois plus odieux, sans montrer qu’un vil intérêt l’avait conduit à commettre un crime atroce, un forfait inouï. Il eût découvert vingt complices qu’il n’eût pas moins paru le plus coupable de tous, et fût monté comme eux sur l’échafaud. Tandis qu’en cherchant à se faire passer pour fou, il pouvait tromper quelques personnes, jeter du doute dans l’esprit de beaucoup d’autres, intéresser en sa faveur, et suspendre en quelque sorte l’action de la justice. Il est certain que Papavoine, a en partie réussi à obtenir ce résultat : les uns l’ont cru véritablement aliéné, d’autres ont douté, beaucoup ne l’eussent pas condamné. Ainsi ce dernier rôle était bien préférable au premier. Il est vrai que Papavoine a persisté dans le même système jusqu’au pied de l’échafaud ; mais l’espérance n’abandonne jamais l’homme ; peut-être Papavoine s’imaginait-il que l’appareil de la mort n’était dressé que pour l’effrayer et obtenir de lui des révélations importantes : cela s’est vu. En persistant dans son système, il pouvait obtenir quelque amendement à son sort en avouant qu’il avait été un monstre, sa peine eût été augmentée de tout le poids de l’exécration publique. Sa famille est beaucoup moins à plaindre ; sa mère peut encore croire qu’elle n’a pas donné le jour à un scélérat. Un homme comme Papavoine pouvait comprendre parfaitement tout cela.
2° L’exécution du meurtre des deux enfans présente plusieurs circonstances qui ne s’accordent guère avec [p. 210] l’existence d’un état de manie furieuse chez Papavoine.
Il voit ces enfans, il va acheter un couteau, et dans cet instant il paraît tranquille, doux, poli ; quelques minutes après, les enfans ont perdu la vie ; aussitôt Papavoine s’enfonce dans le bois, cache son couteau dans la terre, regarde avec inquiétude s’il ne porte aucune marque qui puisse déceler son crime, demande s’il n’a pas de tache sur la figure, paraît néanmoins calme et tranquille, et s’informe des issues de la foret ; il répond avec une présence d’esprit admirable lorsqu’on vient pour l’arrêter, de manière à détourner les soupçons dont il pourrait être l’objet et à faire éloigner le gendarme qui l’avait abordé.
Conduit devant l’autorité du lieu, reconnu par des témoins, il nie tout avec fermeté, ne montre point d’agitation. Voilà un accès terrible dans ses résultats, qui a néanmoins été bien court, bien calme, et qui n’a causé que fort peu d’agitation, que fort peu de trouble dans les idées : tout cela est fort extraordinaire. Si Papavoine eût assommé ces enfans en les foulant aux pieds, ou en leur brisant la tête contre les arbres, on pourrait concevoir que cette action aurait été le résultat de quelque mouvement violent de fureur ; et encore est-il difficile d’admettre qu’un calme si parfait, qu’une si grande présence d’esprit , que l’idée de tout nier, que des précautions si ingénieuses, eussent été si promptement observées chez ce même furieux, après une action aussi horrible. La fureur est ordinairement suivie d’un collapsus remarquable, avec affaissement des traits, pâleur de la face, faiblesse générale, etc.
3° L’explication que donne Papavoine de son état mental au moment où il a commis le meurtre, n’est guère conforme à l’observation journalière. Il a, dit-il, acheté un couteau pour aller délivrer les prisonniers du donjon de Vincennes.il est difficile de croire qu’il n’ait point été frappé de l’idée que ses moyens d’exécution n’étaient [p. 211] point en rapport avec le nombre et la grandeur des obstacles à surmonter pour arriver à ce but. Mais par un hasard assez singulier, à peine a-t-il acheté le couteau qu’il oublie son projet, si bien qu’il gagne le bois au lieu de se diriger vers le château ; bientôt il rencontre les deux enfans, perd la tête, et ôte la vie aux deux victimes, sans savoir ce qu’il fait ; la connaissance lui revient à l’instant même, car il cherche dans une fuite prompte, et dans divers moyens, à échapper aux poursuites dont il est immédiatement l’objet. Une pareille conduite est inexplicable d’après les faits connus en médecine mentale. Une circonstance qui a surtout frappé M. Esquirol, et qui est très-importante, c’est que Papavoine prétend qu’il ignore absolument le motif déraisonnable qui l’a poussé au meurtre, et ne se rappelle point du tout ce qui s’est passé en lui pendant qu’il a commis l’attentat. Or, les fous ne perdent point ainsi la tête, ils savent ce qu’ils font et conservent parfaitement bien le souvenir de leurs actions remarquables et de leurs pensées, tant qu’ils ne sont point tombés dans une démence profonde ; après leur guérison ils rendent un compte exact de tout ce qu’ils ont éprouvé durant leur maladie; on est même étonné de toutes les remarques qu’ils ont faites, alors qu’on les voyait concentrés en eux-mêmes, ou agités, furieux, incapables d’observer et de réfléchir. Papavoine paraît avoir si peu perdu la tête, si bien su exécuter son dessein , qu’il n’a pas manqué de chercher à percer le. Cœur ; il n’a été à la secondes victime que lorsque la première a été frappée du coup mortel. L’acte meurtrier a donc été commis par un être qui conservait la connaissance, et qui aurait dû donner les raisons par lesquelles il était poussé , dans son délire, à commettre un pareil forfait. Cette opinion ne sera bien comprise que des personnes qui ont l’habitude de voir des aliénés.
4° Le système de dénégation adopté pendant six [p. 212] semaines par Papavoine, n’est pas ordinaire chez les fous ; presque tons les aliénés meurtriers ne cachent ni leurs projets, ni leurs actions ; soit qu’ils s’imaginent commettre des actes méritoires, soit qu’ils espèrent trouver la mort après l’avoir donnée à d’autres ; soit, enfin, qu’ils n’aient pas balancé entre des motifs imaginaires de vengeance ou de jalousie et l’échafaud, ils restent sur le théâtre de leurs, crimes et ne cèlent aucune, des circonstances de l’exécution ; ils se laissent enfermer ; satisfaits de la réussite de leurs projets, ils s’abandonnent à la justice humaine, qu’ils savent inexorable pour les criminels, et se reposent avec confiance sur la justice divine. Léger a d’abord nié aussi, mais remarquez qu’il a fallu bien peu d’efforts pour obtenir de lui l’a vende sa conduite. Ensuite, nous ne donnons pas comme une preuve déraison les dénégations opiniâtres de Papavoine ; autrement nous serions en contradiction avec ce que nous avons dit précédemment à propos des dénégations de Léger. Nous rapprochons seulement ce fait comme une simple présomption, des autres circonstances qui nous font douter.de l’existence de la folie chez cet individu.
Que conclure de tout ce qui précède ? Papavoine était-il fou, ne l’était-il pas ? Comme médecin nous ne pouvons que rester dans le doute sur cette question grave : c’est dire que comme juré nous eussions voté pour l’acquittement. Papavoine eût été enfermé dans une maison d’aliénés pendant un certain nombre d’années. En pareil cas, au moins devrait-on écarter la question de préméditation, pour ne pas courir le risque d’envoyer un aliéné à la mort.
Lorsque des médecins habitués à voir des fous ne croyent pas pouvoir prononcer avec certitude dans des cas de ce genre, n’est-on pas un peu surpris de, voir des magistrats, des gens du monde, se prononcer avec confiance pour une opinion plutôt que pour l’autre, trancher [p. 213] avec assurance sur la valeur de tel fait ou de tel autre en faveur de l’existence de la raison ? Il nous semble que dans des cas aussi difficiles, et même dans tous ceux où l’aliénation mentale est invoquée comme moyen de défense, il serait convenable de faire appeler des médecins expérimentés, tant pour éclairer la conscience des juges, que pour fixer l’opinion publique ; nous disons qu’il faut fixer l’opinion publique, parce que le peuple étant peu instruit sur les différentes espèces de folie, pourrait être étonné qu’on acquittât pour cette cause des êtres qui ne lui paraîtraient pas privés de la raison; tandis qu’il pourrait se reposer avec confiance sur la décision des gens de L’art.
*
Les cinq condamnés dont nous venons d’examiner les procès, ont été pris par la justice dans l’espace de deux années environ ; quatre ont été jugés à Paris, et le cinquième à Versailles, à peu de distance de la capitale. Dans ce même espace de temps, l’aliénation mentale a également été alléguée comme moyen de défense dans plusieurs autres causes jugées à Paris.
Il paraît que ce moyen de défense est invoqué très-souvent aussi dans les départemens, beaucoup plus souvent, dit-on, qu’il y a vingt ans. Les magistrats s’en effrayent, et craignent que des coupables n’échappent à la vindicte publique en simulant quelques symptômes de folie.
Aussi les avocats-généraux, les procureurs du Roi, les auteurs des actes d’accusation s’élèvent-ils avec force contre ce système de défense.
Cependant, sur les cinq individus dont nous nous sommes occupés , nous en trouvons trois, Lecouffe, Léger et Papavoine, en faveur desquels l’aliénation mentale pouvait être alléguée, et devait même être prise en considération par le jury, quoique chez Papavoine l’existence de cette maladie fut au moins douteuse. [p. 214]
Si la succession rapide de ces trois procès sur un point très-circonscrit de la France n’est pas due à une sorte de hasard ; si, dans d’autres temps et dans d’autres lieux, des causes du même genre se présentent aussi fréquemment, n’est-il pas à craindre qu’il ne se commette quelquefois de graves méprises ?
Dans ces sortes de causes, les magistrats doivent donc procéder avec la plus grande circonspection, s’éclairer constamment des conseils des gens de l’art, et user d’indulgence, s’ils conservent le moindre doute sur le caractère moral de l’action imputée aux accusés. Il vaut mieux, a-t-on dit justement, acquitter cent coupables que de punir un innocent, un aliéné, surtout lorsqu’il s’agit d’appliquer la peine capitale ; car alors l’erreur est irréparable.
On enverrait à l’échafaud des centaines d’individus comme Léger, qu’on ne préviendrait pas les actions semblables à celle qu’il a commise. La crainte des supplices n’arrête point les aliénés : on a brûlé des milliers de sorciers et de possédés, et plus on en envoyait à la mort, plus il s’en présentait à juger. Les châtimens sont donc, en pareil cas, des cruautés inutiles.
D’ailleurs, n’est-il pas consolant pour l’humanité, de pouvoir rattacher à une infirmité mentale, quelques- uns des forfaits qui la déshonorent ? Et n’est-ce point ravaler la dignité de l’homme, que d’admettre si facilement l’existence de monstres raisonnables qui commettraient des crimes inouïs, sans intérêt, et par le seul besoin de se baigner dans le sang de leurs semblables ?
Notes
(1) Constitutionnel et Journal des Débats, du novembre 1824.
(2) N’est-on pas frappé de la ressemblance qui existe entre ce fait et celui qui a été dernièrement consigné dans les Archives, par le docteur Berthollet, relatif à une dépravation extraordinaire du goût, jointe à une sorte d’imbécillité et à un penchant très-prononçé pour l’acte vénérien ?
« L’on a arrêté, dit ce médecin, et conduit dans les prisons de St-Amand (Cher), un homme qui faisait sa nourriture favorite et recherchée de substances animales les plus dégoûtantes et même de portions de cadavre. Il s’est plus d’une fois introduit dans des cimetières, où, à l’aide d’instrumens nécessaires , il a cherché à extraire des fosses les corps déposés le plus récemment, pour en dévorer avec avidité les intestins qui sont pour lui l’objet qui flatte le plus son goût. Trouvant dans l’abdomen de quoi satisfaire à son appétit, il ne touche point aux autres parties du corps. Cet homme est âgé de près de 30 ans, il est d’une stature élevée ; sa figure n’annonce rien qui soit en rapport avec cette passion dominante. La dépravation du goût est portée à l’excès : on l’a vu suivre les artistes-vétérinaires dans les pansemens de chevaux pour en manger les portions de chair détachées, les plus livides et les plus altérées par la maladie. On l’a trouvé également d’ans les rues, fouillant les immondices pour y chercher les substances animales jetées hors des cuisines. Ce qu’il y a de plus étonnant, c’est qu’il n’est point maîtrisé par un faim dévorante ; il ne mange point d’une manière extraordinaire, car lorsqu’il lui arrive de rencontrer de quoi fournir plus qu’à son repas, il en remplit ses poches et attend patiemment avec ce surcroît d’alimens, que ion appétit soit de nouveau réveillé. Interrogé sur ce goût dépravé, sur ce qui l’aurait fait naître, ses réponses sont de nature à le faire remonter à sa plus tendre enfance ; Il place cette nourriture au rang des alimens les plus savoureux, et il ne peut concevoir comment on peut blâmer un goût qui lui paraît si bon et si naturel. Cet homme éprouve une gène dans les mouvemens du côté gauche ; il dit qu’elle est de naissance. Lorsqu’on lui fait subir une espèce d’interrogatoire un peu [p. 158] prolongé, on s’aperçoit d’une certaine incohérence dans les idées, d’une tendance à l’imbécillité. Cependant il répond à tout ce qu’on lui demande avec assez de précision, et il conserverait assez de facultés morales pour rester libre, si la société n’en réclamait impérieusement la réclusion. Cet homme, dont le goût fait horreur, pourrait tôt ou tard se porter à des excès dangereux ; il avoue lui-même que, quoiqu’il, n’ait encore attaqué aucun être, vivant, il pourrait bien, pressé par la faim, attaquer un enfant qu’il trouverait endormi, dans ses courses dans les campagnes. Il paraît manquer de courage et être très-pusillanime ; c’est-peut-être à cela que l’on doit s’il n’a commis aucun crime pour satisfaire son goût dominant. Par une bizarrerie inexplicable, cet homme, lorsqu’il se repaît de substances animales et surtout des intestins de cadavres humains, dit éprouver une douleur très-vive aux angles de la mâchoire et dans toute la gorge. »
« Il est à remarquer que cet homme est très-porté aux actes vénériens.
« Il a été arrêté en octobre- dernier, dévorant un cadavre inhumé le matin.
« N. B. Le Tribunal a prononcé son interdiction, et il sera envoyé dans une prison telle que Bicêtre, pour y être détenu. »
(Archives générales de Médecine, tome 7, p. 472).
(3) Je ne sais lequel ; peut-être même la citation n’est-elle pas exacte ; mais la pendse est fort juste.
(4) Sur les fonctions du cerveau ; édit. in-8°, tom. 4, p. 145..
(5) Les journaux disent que sur la demande expresse du défenseur de Léger, la Cour a posé une question relative à la démence. Nous n’osons le croire ; car la jurisprudence de la Cour de cassation est contraire à cette manière de procéder, depuis que le Code pénal a déclaré la démence exclusive de la volonté, et, par conséquent, du crime. Dans le Code des délits et des peines, qui a précédé le Code pénal actuel, la démence était [p. 166] considérée simplement comme excuse ; toutes les fois qu’un motif d’excuse reconnu par la loi est allégué par l’accusé ou son défenseur , une question y relative peut être posée par la Cour. Par un arrêt rendu le 21 frimaire an II, la Cour de cassation annule un jugement prononcé par une Cour d’assises, parce que le président s’était refusé à poser la question de démence réclamée par le conseil de l’accusé ; la question de volonté avait néanmoins été résolue affirmativement (*). Depuis l’abrogation du Code des délits et des peines, la Cour de cassation a adopté une autre jurisprudence. Suivant cette nouvelle manière de voir, la démence n’étant point un fait d’excuse, mais une circonstance morale qui détruit absolument la culpabilité de l’accusé (**) , elle ne peut pas être la matière d’une question particulière devant un jury ; et si les jurés sont convaincus , d’après les débats, que, lors du fait par lui commis , l’accusé était réellement dans un état d’aliénation d’esprit, ils doivent déclarer qu’il n’est pas coupable, car il n’y a pas de culpabilité sans volonté criminelle. Par conséquent, si l’accusé est déclaré coupable cette déclaration, qui embrasse le fait matériel et son caractère moral, sera nécessairement une décision négative de l’allégation de la démence (***). La démence d’un accusé lors du délit, dit la même Cour, présente une question de volonté, non une question d’excuse. Quand donc le jury a déclaré l’accusé coupable, il a déclaré virtuellement n’y avoir pas eu démence. Toute e***e est alors improposable (****).
Malgré cette nouvelle jurisprudence, un président de Cour d’assises crut devoir poser séparément une question de volonté et une question de démence. Le jury les a résolues toutes deux affirmativement ; il a déclaré que l’accusé avait agi volontairement, et qu’il était en démence au moment de l’action. Cette déclaration contradictoire n’est point annulée par la Cour suprême ; elle doit être entendue en ce sens, que l’accusé est matériellement auteur du fait, mais qu’il n’y a apporté qu’une volonté [p. 166] d’homme en démence, une volonté quasi-animale, et qui est exclusive de toute culpabilité légale (*****). Nous n’avons pas eu l’intention, en rapportant cette jurisprudence relative à la démence, de blâmer la manière de voir du président de la Cour d’assises île Versailles, de montrer qu’il n’a pas suivi la doctrine établie par la Cour de cassation. Nous avons voulu faire quelques réflexion à ce sujet.
Il est sans doute plus philosophique de considérer l’aliénation mentale comme exclusive du crime, que comme un motif d’excuse qui présuppose toujours l’existence du délit commis volontairement. Mais nous ne pensons pas que cette doctrine de notre Code pénal actuel , toute naturelle qu’elle est, soit aussi favorable à l’accusé que celle du Code des délits et des peines. La plupart des jurés ne sont guères métaphysiciens ; ils s’élèveront, difficilement jusqu’à la distinction de la volonté libre et de la volonté quasi-animale, et pourront résoudre affirmativement toutes les questions de volonté, pourvu que les accusés aient commis matériellement le crime. Le dernier arrêt cité plus haut vient à l’appui, de ce que nous .disons. Voici les questions résolues par le jury : oui , l’accusé est coupable d’avoir commis un homicide ; oui, cet homicide a été commis volontairement et avec préméditation ; oui, l’accusé était en démence au moment où il a commis l’homicide. Ainsi, sans la position de cette dernière question, qui est illégale d’après la nouvelle jurisprudence, l’accusé, quoique en démence, était condamné à mort, et pouvait porter sa tête sur l’échafaud. Les jurés n’ont pas compris que la démence est considérée comme étant exclusive de la volonté ; et nous approuvons leur manière de voir. Les aliénés ont une volonté comme tout le monde ; mais une volonté maîtrisée par des penchans désordonnés, faussée par des idées déraisonnables.
Que si l’on trouve contradictoire de considérer la démence comme exclusive du crime, et de poser une question relative à cette maladie, il nous semble qu’on préviendrait l’erreur funeste que nous venons de signaler, en rédigeant ainsi la question de volonté : L’accusé a-t-il commis le fait volontairement et jouissant du libre exercice de ses facultés mentales ou de sa raison.
Nous supposons bien que les présidens des Cours d’assises, dans leurs résumés, ont soin d’expliquer aux jurés la doctrine du Code pénal, relative à la démence ; de leur faire entendre que s’ils croient l’accusé en [p. 167] démence, ils doivent l’acquitter. Mais ces précautions ne paraissent pas suffisantes ; nous venons de rapporter un exemple
remarquable qui prouve assez le contraire.
(6) Journal des Débats du 25 avril 1823.
(*) Sirey, tome 7 , pag. 1153.
(**) Code pénal, art. 64 .
(***) Arrêt rendu le 11 mars 1813. Sirey, Tab. Vicen., pag. 253.
(****) Arrêt rendu le 4 janvier 1817. Sirey, Tab. vicen., pag. 499.
(*****) Arrêt rendu le 4 janvier 1817. Sirey, Tab. vicen., pag. 499.
(7) Cette femme vivait en concubinage avec l’accusé. Nous notons cette circonstance pour expliquer comment elle a pu appelée comme témoin,
(8) Plaidoyer pour Joseph Gras. Choix de Plaidoyers, Discours et Mémoires de M. Bellart , procureur-général près la Cour royale de Paris ; tome premier, page 18.
(9) Gras , qui avait été condamné à mort par un premier jugement, ne fut condamné par le second qu’à la réclusion pour le reste de ses jours.
(10) Code pénal, art. 324 et 325.
(11) M. Breschet, qui a examiné la tête de Feldtmann, nous a dit que le cerveau ne lui avait pas paru parfaitement sain.
(12) Plaidoyer cité.
(13) Journal des Débats , des 11, 12, 13 et 14 décembre 1823.
(14) Il faut au moins excepter le gardien dont nous venons de relater la déposition.
(15) Dictionnaire de Médecine, art. Épilepsie.
(16 Journal des Débats, des 20, 21, 22 et 23 février 1824.
(17) Le journaliste a sans doute mal compris M. l’avocat du Roi, qui n’a pu soutenir une pareille doctrine. Quoi ! Jean-Pierre n’est pas fou, cependant c’est un homme dangereux, et il faut le condamner pour le séquestrer de la société ! Où M. l’avocat-général aurait-il appris qu’on dût flétrir un homme parce qu’on n’aurait aucun moyen de prévenir les effets de ses emportemens ? Mais la loi n’a pas été aussi imprévoyante. Presque tous les aliénés sont enfermés sans être interdits, en vertu de la loi du 24 août 1790., Il est toujours possible de motiver la séquestration, sans même qu’il y ait des actes de violence ou de fureur ; .car il n’est peut-être pas d’aliéné qui ne puisse devenir dangereux pour la sûreté publique . Un individu qui serait acquitté pour cause d’aliénation mentale, ne serait pas même mis en liberté ; l’autorité judiciaire n’aurait qu’à prévenir l’autorité municipale, qui ne manquerait pas d’en ordonner la détention dans une maison de force.
(18) Constitutionnel et Journal des Débats, des 24 ,25, 26 et 27 février 1825 ; Drapeau blanc du lendemain du jour de l’exécution du condamner ; Plaidoyer pour Lous-Auguste Papavoine, par M. Paillet, avocat à la Cour royale.
(19) Les enfans de madame la Duchesse de Berry.
(20) Le fils Gerbod était père des deux jeunes victimes. Il avait voulu épouser leur mère ; mais sa famille s’y était opposée.
(21) Papavoine a constamment dit que la famille Gerbod était innocente ; il l’a répété peu d’instans avant de monter sur l’échafaud.
(22) Le jeune dame a déclaré ce fait, la mère des enfants et une autre femme ont vu Papavoine lui adresser la parole.
(23) Ceci paraît en contradiction avec la lettre de madame Papavoine, que nous avons rapportée plus haut.
(24) Un témoin du pays de Papavoine a déclaré que celui-ci lui avait dit plusieurs jours avant de partir pour Paris, qu’il s’ennuyait beaucoup, et avait eu l’idée de d’ôter la vie.
(25) Bellart, Plaidoyer cité.
(26) Code pénal, art. 64.


LAISSER UN COMMENTAIRE