Aline Rousselle. Du Sanctuaire au Thaumaturge. La Guérison en Gaule au IVe Siècle. Extrait des « Annales. Histoire, Sciences sociales », (Paris), Nov.-Déc. 1976, pp. 1085-1107.
Aline Rousselle (née en 1939). Historienne. – Spécialiste des aspects culturels de la conversion des Romains à la chrétienté. – Professeur d’histoire ancienne à l’Université de Perpignan (1993-2000) puis à l’Université de Toulouse-Le Mirail (depuis 2001). Quelques publications retenues :
— Porneia : de la maîtrise du corps à la privation sensorielle : IIIe et IVe siècles de l’ère chrétienne. Paris : Presses universitaires de France, 1983.
— Croire et guérir. La foi en Gaule dans l’Antiquité tardive. Paris, Fayard, 1990.
— La contamination spirituelle : science, droit et religion dans l’Antiquité. Paris, les Belles lettres, 1998
— La société et le sacré dans l’Antiquité tardive. Paris, Éd. du Seuil, 2002.
Histoire de la différence sexuelle : essai.Nouvelles presses du Languedoc. 2007.
[p. 1085]
ANTHROPOLOGIE ET RELIGION
DU SANCTUAIRE AU THAUMATURGE :
LA GUÉRISON EN GAULE AU IVe SIÈCLE
Lorsque Adrien Blanchet mit en relation les trésors monétaires et les invasions germaniques, c’est-à-dire les dates des monnaies les plus récentes des trésors et les dates d’invasions connues par les textes, il décida d’exclure de son répertoire les trésors et dépôts sacrés des sanctuaires de sources. Ceux-ci, pensait-il, avaient été détruits par les chrétiens. Une étude de l’ensemble des trésors et dépôts sacrés trouvés dans les sanctuaires gaulois montre que leur répartition et leurs dates d’enfouissement conduisent à mettre en relation la désaffection de ces centres religieux avec la paupérisation des villes qui les finançaient et avec les invasions. Pourtant, si la plupart d’entre eux paraissent morts dès la seconde moitié du IVe siècle, certains continuèrent d’attirer les fidèles au-delà même du Ve siècle. Le concile d’Auxerre, en 585, interdit encore de faire des offrandes votives aux fontaines de sculpter dans Je bois des pieds ou des figures humaines. Saint Gall, après 511, vit dans un temple peuplé de statues, des malades qui gravaient sur le bois le membre qui les faisait souffrir. Ces païens, rapporte Grégoire de Tours, mangeaient et buvaient jusqu’à en vomir : beuverie rituelle, ou médication classique ? Parmi les sanctuaires de sources dont la fréquentation tardive est attestée par les dépôts monétaires, les sanctuaires de cure médicale sont nombreux en effet.
Cet aspect de la foi gauloise peut éclairer les conditions de la conversion au christianisme, conversion qui s’est faite en grande partie par le biais de guérisons miraculeuses opérées par des saints thaumaturges dont le plus efficace, et le mieux connu, est saint Martin de Tours.
La maladie et la foi
Sur 89 sanctuaires et thermes datés. 20 sont des sanctuaires où la présence de malades est attestée ; 4 sont des thermes urbains : Lutèce, Rennes. Lillebonne, Bavai. La pratique médicale est révélée par les cachets d’oculistes et les instruments de chirurgie : 8 sanctuaires et thermes ont fourni des cachets d’oculistes, sans autre témoin de la venue de malades ou d’interventions à caractère médical ; 3 n’ont fourni que des instruments de chirurgie ; dans 7 cas, seuls des ex-voto ont été trouvés : ils font connaître la présence de malades mais non l’exercice de la médecine. Faut-il pourtant croire sans autre preuve que là où sont les malades ; là sont les médecins ? Sur l’ensemble des 24 sanctuaires et [p. 1086] thermes dans lesquels on note ainsi la présence de malades ou de médecins, il se trouve seulement trois sources thermales. Partout ailleurs les propriétés curatives des eaux paraissent relever uniquement de la foi des malades, des médecins, des prêtres qui s’y trouvaient rassemblés. De là, pour nous, la tentation de voir dans les maladies qui y guérissaient des maladies psychosomatiques. Un autre risque consiste à projeter sur ces sanctuaires ce que l’on sait par le dossier d’Asclépios (1) Ce dossier contient essentiellement des inscriptions relatant des guérisons. Il ne donne donc que l’image de ce qui a pu être guéri. Il se trouve que l’on a pu donner pour la plupart de ces cas une explication psychologique (2). Mais il ne s’agit pas, dans les sanctuaires gaulois, de guérisons. Grégoire de Tours rapporte, on l’a vu, que les malades gravaient eux-mêmes sur le bois le membre qui les faisait souffrir. Plus généralement, ils devaient s’adresser à des boutiques où se fabriquaient et vendaient ces objets en bois, en bronze ou en pierre, à des prix divers. C’est dans l’espoir de la guérison que la représentation du membre ou de l’organe atteint était offerte. Toute cette documentation concerne donc la maladie et la foi, non les soins, non la guérison. Cependant la permanence de ces sanctuaires laisse supposer que certains malades rentraient chez eux guéris.
Ce qui apparaît comme élément premier, dans le mouvement qui mène le malade au sanctuaire, c’est la foi. Ensuite seulement, la possibilité de soins médicaux sur le lieu du culte et de l’espoir. Et c’est pourquoi il paraît utile d’examiner quelles sont les maladies pour lesquelles le recours à la foi s’impose, quelle est leur symptomatologie.
La documentation n’est malheureusement pas datable. Ce sont les ex-voto dont la facture, le plus souvent grossière, interdit une datation précise. Je ne fais ici que reprendre les propositions d’identification des maladies représentées sur les ex-voto des sources de la Seine, faites par le Dr Bernard et le Dr Vassal (3). D’abord des maladies d’yeux, connues par les plaquettes de bronze à représentation en pointillé ou en évidement. Puis des maladies ostéoarticulaires : mains, bras et jambes, déformés ou ulcéreux. Il est difficile de donner un diagnostic vraiment précis car les sculptures sont frustes et la main du sculpteur est peut-être seule cause de certaines déformations. Mais on a trouvé dans d’autres sanctuaires des représentations abondantes de doigts, mains, bras, jambes, pieds, si bien que l’on imagine un rassemblement d’aveugles, ou du moins d’hommes et de femmes privés des moyens de se diriger seuls, de boiteux, d’invalides de toutes sortes, de goitreux. Des bandages herniaires apparaissent nettement sur des représentations du tronc. Hommes et femmes viennent soigner des maladies des organes génitaux, et on reconnaît un cancer du sein. Les maladies internes sont évoquées par des représentations d’organes, en bois, dont l’identification n’est peut-être pas certaine : poumons, cages thoraciques fermées ou ouvertes avec représentation du cœur, des poumons, des reins (4).
Cette liste ne donne en aucune façon une idée de la morbidité en Gaule à l’époque romaine. Elle présente seulement un tableau des maladies qu’on venait soigner dans ces centres religieux entre le 1 et le Ve siècle. Il faut éliminer d’abord les maladies aiguës qui entraînent une mort rapide, infection, parasitose, phtisie, tétanos fatal, morsure de vipère (mortelle dans 9 cas sur 10). Les grandes épidémies, le fléau qui frappe une fois par génération ou par siècle, ne grossissent la clientèle des sanctuaires que par les séquelles graves chez les survivants. Il faut ensuite se représenter qu’on ne soigne pas tout. Le paysan d’année en année se courbe davantage. Les rhumatismes déforment et font souffrir épisodiquement. Tout cela est connu, attendu, subi comme la vie. Ensuite la patience. La résistance à la douleur apprise dès l’enfance. Le sentiment d’impuissance devant une fièvre que l’on sait pouvoir disparaître le lendemain. Puis le recours aux remèdes familiaux : menu spécial, vin, tisanes, compresses. Alors seulement, et pour un mal douloureux et durable, on va consulter ou quérir le spécialiste du village ou du quartier, sorcier, guérisseur, connaisseur de plantes et de charmes. Dans la plupart des cas, seuls [p. 1087] sont abordés ces trois niveaux. Il faut en effet envisager le déplacement vers un sanctuaire (5). Pour la zone de Lyonnaise orientale où ils sont très nombreux, la distance est courte : 30 à 40 km entre deux sanctuaires. Mais il faut y ajouter l’éventualité d’un séjour prolongé. La question se pose alors de l’accompagnement du malade ou de l’invalide, de la perte des journées de travail si Je malade et son accompagnateur sont encore aptes à rendre quelques services. Cela dans une société qui astreint au plein emploi et fait dépendre du maître ou du patron tous les déplacements de main-d’œuvre. Ce n’est donc qu’à partir d’une incapacité de travail assez considérable, due à un handicap moteur, à la faiblesse de la vision, à la douleur chronique, que le séjour au sanctuaire devait se décider. La quantité de sculptures malhabiles sur bois, à côté de quelques belles représentations en pierre, montre que la masse des malades était d’origine populaire, paysans sûrement, artisans peut-être.
C’est dans la liste des maladies professionnelles actuelles, dans l’agriculture 6 et l’artisanat, qu’on doit trouver le meilleur tableau de la morbidité populaire de l’époque pré-pastorienne. Et c’est au sein de ces maladies que doit s’opérer le tri entre les maux ordinaires, méconnus pour certains en tant que maladies, et les maux exceptionnels, mais non aigus. qui justifient Je voyage et le séjour au sanctuaire. É. Patlagean a mis en relation les maladies qui apparaissent dans les récits hagiographiques byzantins avec la malnutrition, pour tenter de retrouver les pauvres dans la clientèle des moines guérisseurs (7)
Je prendrai d’abord pour exemple la cécité. On s’étonne en général du nombre de guérisons d’aveugles, et du nombre d’aveugles même dans les sociétés antiques et médiévales (8), avant la grande progression du trachome. Il y avait tout d’abord jusqu’en 1864 les nombreuses cécités infantiles dues à l’infection gonococcique néonatale. É. Patlagean rappelle encore J’influence de la carence en vitamine A sur la vision (9). Il faut certainement y ajouter la liste des ophtalmies spécifiques des milieux ruraux. D’une part les lésions produites par la chaleur et la lumière, les affections dues à des agents végétaux, et d’autre part les accidents provoqués par les chocs et par la pénétration de débris végétaux et minéraux dans l’œil. Cependant il s’agit là de causes que le paysan connaît : il a ressenti l’éblouissement, il sent Je corps étranger qui blesse la cornée. En revanche une ophtalmie comme la kératite des moissonneurs (10), qui menace aussi dockers et transporteurs de grains, ne produit ses effets que bien après la moisson. Alors, après une petite infection indolore de la conjonctive, la vue baisse. La cause reste mystérieuse, le mal plus ou moins sévère, mais définitif. Ces cas de lésion oculaire, dont on ne peut déterminer la cause, devaient particulièrement bien s’adapter à la cure de sanctuaire où l’on demandait au dieu de rendre ce qu’il avait pris, ce à quoi on ne pouvait donner de cause immédiate et évidente au sens d’agent pathogène extérieur.
Après les ophtalmies, ce sont les paralysies que suggèrent la plupart des ex-voto, comme d’ailleurs la documentation hagiographique d’époque chrétienne. Ce qui est alors reconnu, c’est le symptôme. La seule forme de paralysie dont l’immédiate origine était apparente est l’hémiplégie consécutive à l’apoplexie. Mais la paralysie est diverse en réalité. P. A. Sigal, en recherchant les paralysies dues à des accidents nerveux a rappelé le syndrome de Guillain-Barré dont l’évolution est spontanément favorable après un délai de deux à trois ans, et la sclérose en plaques qui peut évoluer de même, plus rapidement (11). Ces succès expliqueraient au moins une part des miracles. Si l’on considère l’étiologie et non la symptomatologie, on trouve parmi les maladies professionnelles de l’agriculture et de l’artisanat, l’origine de nombreuses paralysies, le plus souvent localisées et parfois d’évolution favorable.
Paralysie localisée due au plomb (saturnisme), à l’arsenic, au mercure, accompagnée de tremblements. Toxi-infection, comme la diphtérie, qui provoque aussi une paralysie localisée. Maladies à symptômes ou séquelles ostéoarticulaires graves : brucellose ou [p. 1088] fièvre de Malte, qui laisse dans la colonne vertébrale de fortes douleurs ; tétanos chronique, à distinguer des tétanos d’évolution fatale. Ce tétanos chronique (12), étudié par Gui de Chauliac en 1363, évolue favorablement. Il existe sous forme de contracture localisée au niveau du membre blessé (monoplégique), ou étendue à l’autre membre (paraplégique). L’incubation peut durer jusqu’à plusieurs années. La cause immédiate reste ainsi cachée, oubliée. La contracture permanente s’atténue, les séquelles sont davantage la conséquence de l’immobilisation que du tétanos lui-même. A retenir encore l’actinomycose, venue des marais, des rivières, du travail du chanvre, et qui peut prendre des formes variées, dont une forme ostéoarticulaire. Enfin, on peut rapprocher de la paralysie la tuberculose osseuse qui guérit au terme de trois ans mais laisse de graves séquelles aux sujets qui n’ont pas été immobilisés : déformations du corps, incurables. Incurables encore les paralysies localisées, avec atrophie, de la poliomyélite.
On voit que les formes et causes sont nombreuses et que nombre d’entre elles sont susceptibles de guérison ou amélioration. Dans leur traitement comme dans tout traitement, le psychisme du malade accélère ou retarde le résultat. Or la paralysie, si l’on en reste à la symptomatologie, est spectaculaire ; on sait qu’elle peut être incurable, on sait qu’elle peut se résorber lentement ou brusquement. En l’absence d’une étiologie précise et parfois rassurante, elle justifie pleinement toutes les inquiétudes et tous les espoirs du malade et de ses proches.
C’est encore dans l’agriculture que l’on trouve les plus nombreuses arthrites déformantes avec parfois une invalidité permanente, ainsi que le plus fort pourcentage de rhumatismes articulaires chroniques, ajoutés aux déformations du corps consécutives à l’emploi de tous les instruments agricoles anciens : bêche, faux, pioche, au point que la cyphose est nommée « dos du paysan ».
Dans les sanctuaires des eaux, on accueillait donc des invalides dont le mal avait des causes parfois inconnues, une évolution problématique, et que l’on soignait à l’aide de remèdes mis au point au cours des siècles. Quelques médecins gardaient le secret de la composition de leurs remèdes, baumes et collyres, comme en témoignent les cachets d’oculistes. L’état des malades était désespéré mais généralement non mortel. Certaines maladies avaient des symptômes proches des affections connues et y étaient assimilées ; elles évoluaient différemment sous les mêmes traitements, on y voyait l’action de la divinité. Il y avait pour ces centres religieux une clientèle potentielle inépuisable, celle des campagnes gauloises qui y apportait avec la maladie, la foi qui pouvait contribuer au traitement et à la guérison. Le traitement lui-même comportait un double aspect de remèdes et de prières, mais nous ne pouvons l’inférer jusqu’ici que de la conjonction du lieu de culte, des instruments de chirurgie et des cachets d’oculistes qui attestent une pratique médicale.
Les médecins et la médecine
La documentation sur la médecine et les médecins en Gaule peut être répartie sous trois rubriques : noms de médecins et d’écoles de médecine ; outillage médical fourni par l’archéologie ; ouvrages de médecins gaulois ou de médecins qui ont séjourné en Gaule. Dans ces trois ensembles domine l’élément grec. Nous connaissons par les inscriptions une quarantaine de médecins gaulois dont la plupart ont des noms ou des surnoms grecs. C’est une médecine grecque qui était enseignée à !’École de Médecine de Rome, créée en 14 et qui fonctionna jusqu’à Théodoric. De même aussi probablement dans les écoles de Marseille, Bordeaux et Saragosse, dans celle qui exista sans doute à Metz. Quelle que soit l’origine du médecin, son langage médical était le grec. Ainsi d’Ausone (+394), père du poète, médecin des villes de Bazas et de Bordeaux, Gaulois pour qui la langue grecque était plus familière que le latin (Epicedion in patrem, 9-10). Nous ne [p. 1089] savons rien de ces médecins, sinon qu’ils parlaient grec, avaient nom ou surnom grec, exerçaient en Gaule. Mais quelle médecine ? En ce qui concerne les oculistes, les documents sont un peu plus précis. Les cachets qui servaient à marquer leurs collyres portent le nom de l’oculiste, le mal auquel est destiné le collyre, et la qualification du collyre était désignée soit par un adjectif publicitaire : « inimitable », soit par le produit de base : collyre nardinum, collyre diagessamias (de terre de Samos) (13). En regroupant ainsi les inscriptions des cachets, les trouvailles d’instruments de chirurgie oculaire, les formules de collyres données par les auteurs, on distingue assez bien la pratique médicale en ophtalmologie : chirurgie sans doute assez simple, avec un réel succès dans l’abaissement du cristallin pour les cas de cataracte, et pour le reste, une quantité de collyres dont chaque officine liée au praticien gardait le secret.
Quant à la littérature médicale, elle se réduit à l’œuvre de deux auteurs incompatibles, Oribase et Marcellus. Oribase est né vers 325 à Pergame. Il était païen avec conviction. Julien le rencontra en 355 à Athènes, se l’attacha et l’entraîna en Gaule. Il fut l’un des rares à connaître les projets de sédition de Julien en 360. C’est en Gaule qu’il rédigea, à la demande de Julien, sa Collection médicalede 70 livres, à la fois compilation et œuvre personnelle. Il résuma cet ouvrage pour son fils (Synopse à Eustathe) et rédigea un petit guide de médecine pratique à l’intention d’Eunape. Ces ouvrages en grec, direc¬tement lisibles par les médecins de Gaule, eurent un succès si vif et si durable qu’au vue siècle, dans une Gaule où se perdait le grec, on les traduisit en latin.
Le travail d’Oribase est destiné à faciliter et à assurer le diagnostic. C’est même ainsi qu’il faut qualifier cette médecine : médecine du diagnostic. L’opération essentielle est une opération intellectuelle : la compréhension de la maladie. Pour cela il faut des connaissances en anatomie, physiologie ; être capable d’observation, poser les justes questions au malade ou à ses proches ; s’expliquer le mécanisme de la maladie en partie par les connaissances physiologiques, en partie par une étiologie générale qui replace le corps humain dans l’ensemble des éléments. Ce sont ces qualifications qui font le médecin. Ensuite vient Je traitement, sous trois rubriques. La première rubrique, mécanique, regroupe les évacuations : saignées, purgation, par le haut (émétiques), et par Je bas. La deuxième est la prescription de remèdes pharmaceutiques, en applications externes ou par voie orale. La troisième est l’établissement de régimes alimentaires et de règles de vie adaptés à la prévention et au traitement. C’est cette même médecine qui apparaît dans une lettre de Vindicianus, médecin de Valentinien ler, transmise en tête de l’ouvrage de Marcellus : diagnostic, traitement, dans la relation d’un cas, et dans son insertion dans une théorie. Or chaque fois que l’on étudie les progrès, Je niveau de la médecine, c’est à la première opération que l’on se réfère : connaissances, diagnostic. Le traitement lui-même est généralement considéré comme accessoire dans l’art médical, ce qui permet d’écarter la pharmacopée des études historiques sur la médecine (14).
C’est une tout autre médecine que l’on trouve chez Marcellus. Chrétien, homme de la classe sénatoriale, devenu Maître des Offices de Théodose Ier en 395, il écrit pour ses fils un recueil de prescriptions médicales comportant pour chaque maladie, nommée d’après ses symptômes ou la partie du corps affectée, les formules des remèdes et les conditions dans lesquelles ces remèdes doivent être préparés et administrés. Aucune description anatomique ou explication pathologique. Marcellus veut fournir à ses fils des recettes efficaces qui leur évitent de recourir à des charlatans (15). Il a eu des contacts avec des médecins, en particulier avec Vindicianus, archiâtre de Valentinien Ier. Il pille largement l’œuvre de Scribonius Largus, un élève de Celse au 1er siècle après notre ère. Celse avait donné le premier traité de pharmacopée qui nous soit parvenu. Son élève publia 271 remèdes dans un ouvrage plus général, les Compositiones. Marcellus ajoute aux recettes de Scribonius Largus des remèdes de la Medicina Plinii, qui contient, regroupées au début du IVe siècle, les indications éparses dans l’Histoire naturelle de (p. 1090] Pline l’Ancien. On pourrait donc considérer l’œuvre de Marcellus comme un ouvrage de pharmacopée d’École de Médecine, faisant partie de la communauté culturelle de l’Empire au moins dans sa partie latine, tout comme Oribase est un médecin grec, de formation médicale classique. Mais Marcellus, qui est gaulois, prétend donner des recettes qui ont fait leurs preuves dans les campagnes, des remèdes populaires (16). Cependant, puisqu’il craint pour ses fils le recours aux charlatans, c’est qu’il considère son livre comme un recueil de médecine à la fois efficace et savante.
Celse, comme Scribonius Largus, médecin officiel de Claude et de Messaline, était un savant et non un charlatan. La Médecine de Plinene donne que les composés des remèdes, mais Marcellus, comme Scribonius, donne les poids des divers composés : c’est une pharmacie expérimentale et quantitative, pour la majeure partie du recueil.
Ce qui apparaît comme spécifiquement gaulois dans le livre de Marcellus, c’est d’abord le vocabulaire de la flore et de la faune, dans les composés de ses remèdes, et ensuite les mots celtiques, écrits en caractères grecs, des formules magiques qui contribuent à l’efficacité des remèdes. Il n’est pas dit d’ailleurs, bien au contraire, que les formules écrites en grec ne soient pas elles aussi de tradition gauloise, et de même pour les formules en langue latine. Or Marcellus prétend, dans la préface, devoir beaucoup à un médecin nommé Ausonius, moins éloigné dans Je temps que Celse et Scribonius Largus, et qui pourrait être le père du poète Ausone.
Dans son chapitre sur la sciatique et l’arthrite, Marcellus vante un traitement qui réussit à ce même Ausone. C’est là notre seul document sur la médecine pratiquée par Ausone. Ce remède permet à des patients tenus couchés et immobilisés par la douleur, de se tenir debout Je cinquième jour, de marcher le septième. En voici la formule :
Recueillir du crottin de bouquetin à la dix-septième lune, quoiqu’un crottin ramassé lors d’une autre lune décroissante soit aussi efficace, à condition de faire le mélange à la dix-septième lune. Il faut alors mettre dans le mortier autant de crottes que la paume d’une seule main peut en contenir, à condition qu’elles soient en nombre impair : y ajouter vingt-cinq graines de poivre bien pilées, puis une hémine de miel supérieur et un setier de très bon vin vieux. Mêler le tout à la poignée de crottin broyée puis laisser reposer dans un vase de verre, afin, en cas de besoin, de disposer du médicament tout prêt. Mais afin que l’efficacité du remède soit supérieure, il faudra faire tout ceci à la dix-septième lune, et lorsqu’on administrera le remède, commencer le jeudi jour de Jupiter, et poursuivre pendant sept jours consécutifs, en faisant boire le malade debout sur un escabeau, face à l’orient. Si cette potion a été administrée comme prescrit et en observant ces conditions, à supposer même que le patient gise infirme et contracté de toutes les articulations et de la hanche. immobile et désespéré. en toute certitude. il marchera le septième jour (XXV, 21).
La citation intégrale est nécessaire pour mieux comprendre la pratique médicale qui fut celle du médecin Ausone. Les ingrédients, surprenants pour nous, ne diffèrent guère de ceux des autres formules : ce n’est pas là l’essentiel. Mais cette formule, quoi qu’elle vaille, avec ses quantités précises, est composée et administrée dans des conditions qui relèvent de l’action magique.
Médecins et religion autour d’Ausone
Le droit fiscal, depuis le me siècle, distinguait entre les médecins et les guérisseurs, ou exorcistes. LeDigeste(1, 3) reprend en effet un passage d’Ulpien sur leur situation au regard du fisc. Il exempte d’abord les rhéteurs, grammairiens et géomètres. « Les médecins sont dans le même cas que les professeurs, et leur cause est plus juste encore, puisqu’ils veillent à la santé des hommes tandis que les autres veillent à leurs études. C’est pourquoi il faut leur reconnaître un droit d’exemption. Qu’on entende favorablement [p. 1091] aussi les sages-femmes qui paraissent exercer de même la médecine. Mais à la rigueur on acceptera comme médecins ceux qui promettent la guérison de quelque partie du corps ou d’un mal particulier, comme par exemple maux d’oreilles, fistule, maux de dents. En revanche on écartera celui qui a fait des incantations, des imprécations, et, pour employer le vocabulaire courant de ces imposteurs, qui a exorcisé. Cela n’entre pas dans la définition de la médecine, même s’il se trouve des gens pour affirmer publiquement qu’ils s’en sont bien trouvés. »
Le père d’Ausone se prévalait de la qualité de médecin et son fils s’en fit l’écho. Il était membre de la curie de Bazas, sa ville natale (Epic. in patrem, 4-5) à raison de ses biens-fonds sur le territoire de la cité. Membre aussi de la curie de la cité de Bordeaux où il devait encore avoir des terres. Exempté de charges, membre honoraire de ces curies, à quel titre ? Membre de la classe sénatoriale depuis son anoblissement et surtout sa préfecture d’Illyrie en 375, il conservait l’honneur du sénat local dont il n’avait plus les charges. Cette exemption de charges ne permet donc pas de dire que le père d’Ausone était considéré comme un véritable médecin selon la définition fiscale. Pourtant il devait l’être. On voit difficilement comment même Je succès de son fils aurait pu faire anoblir un exorciste païen, en ces temps de chasse aux magiciens, et le conduire à la préfecture. Il faut alors considérer que ce médecin Ausone avait une pratique médicale mixte faite de pharmacopée et de magie. Il faut penser que la plupart des traitements ainsi composés de remèdes pharmaceutiques et de remèdes magiques indissolublement unis par les rites : fabrication du remède, mode rituel d’administration, étaient prescrits par des médecins dont le droit reconnaissait la qualité. Seuls sont exclus de la définition médicale les exorcistes qui n’assortissent leurs paroles d’aucun remède.
On a voulu que Je grand-père maternel du poète et consul Ausone. Emilius Magnus Arborius, ait été druide ou tout au moins lié au milieu druidique (17). Ce noble Éduen, savant astrologue, dissimulait ses dons et son savoir (Parentalia, IV, 17-18) interdits par la loi. Il possédait l’art des horoscopes, qui est effectivement une spécialité druidique. S’agit-il pour autant de « résistance religieuse gauloise (18) » ? Cet homme, nous dit son petit-fils, avait été exilé pour avoir, dans Autun révoltée, résisté à Victorinus en 269 (Parentalia. IV, 9-12). Il faut alors préciser qu’Autun, capitale des Éduens, s’était révoltée
[p. 1092]
contre l’usurpation, dont le but était pourtant de pallier la carence romaine dans la défense du Rhin. Le grand-père d’ Ausone avait donc pris activement parti pour Rome contre la Gaule, ce dont se vanta son petit-fils longtemps après la réunification, sous gouvernement romain. Arborius, noble druide, astrologue, est un fervent partisan de Rome et non un résistant. Il se replie alors dans le sud de la Gaule resté romain, à Dax, ville de thermes (19). Il s’y marie. Une de ses filles épousera le père d’Ausone, le médecin. L’autre, Hilaria, restée célibataire, pratique toute sa vie la médecine (Parentalia, v1). De qui tenait-elle cette science ? de son père ? Le métier s’enseignait de père en fils. L’exilé gagnait durement sa vie (Parentalia, 1v, 13-16), mais Ausone ne dit pas comment. Il fit de son fils Arborius un rhéteur (Parentolia, 111).
On connaît encore dans l’entourage d’Ausone, un druide de la Gaule du Nord replié à Bordeaux, un homme sensiblement de la même génération que le grand-père éduen d’Ausone. C’est le druide Phoebicius (Com. Prof Burd., X, 22-30), desservant d’un temple de Belenus à Bayeux. Son fils Attius Patera (ibid.. IV), professeur de rhétorique à Bordeaux, lui fit obtenir un poste de grammairien dans cette ville. Des familles plus ou moins brillantes de l’aristocratie religieuse gauloise paraissent donc particulièrement fidèles au gouvernement central romain (20), particulièrement intégrées à la culture latine, si l’on considère qu’elles s’orientent volontiers vers l’enseignement de la langue latine et de l’art du discours latin. Si l’on examine la famille d’Ausone on les voit partager leurs choix professionnels entre la rhétorique, de caractère latin, et une médecine dont le caractère gaulois, rituel et traditionnel reste fortement accentué.
Bains et thérapeutique
J’expliquerais volontiers par la détention aristocratique d’un secret médical en Gaule, et par l’intégration de cette aristocratie dans le système socio-culturel romain, l’introduction au sein des pratiques médicales gauloises d’éléments empruntés à l’art médical grec. L’exemple le plus net est l’usage de l’eau en thérapeutique.
On trouve quelques exemples chez Marcellus de l’emploi rituel, traditionnel, de l’eau dans la prévention des maladies, et de l’efficacité magique des plantes de fontaines et de rivières. « Quand tu verras la première hirondelle, tais-toi immédiatement, cours à la fontaine ou au puits, et là, baigne tes yeux et demande à Dieu que les hirondelles cette année n’apportent à tes yeux aucun larmoiement, aucune douleu » (VIII, 30). « Ne pas oublier chaque fois qu’on se sera lavé, de jeter de l’eau à ses pieds avec les deux mains, de porter aussitôt les deux mains aux yeux, et avec chaque main de se frotter le coin des yeux, et cela trois fois » (VIII, 31). Et pour soigner une ophtalmie, « cueillir du peristereon, qui pousse à la fontaine, le faire cuire jusqu’à ce qu’il soit ramolli ; guérison le troisième jour» (VIII, 29). Ce sont là des indications qui ne viennent ni de Pline ni de Scribonius Largus et qui ont de bonnes chances d’être des recettes traditionnelles gauloises. Le lien entre l’eau et la vision a été étudié par É. Thévenot après la découverte de deux cachets d’oculistes aux Bolards, où l’on avait aussi mis au jour des ex-voto d’yeux. Pour la première fois les deux documents étaient réunis sur un même site. C’est à Mithra « interprétation nouvelle des Apollons indigènes », qu’É. Thévenot donne le mérite de guérir dans les sanctuaires de sources les affections de la vue (21). Les indications de Marcellus montrent que, dans le culte des eaux, hygiène et magie préventive étaient associées à la magie curative, dans une tradition gauloise libre de toute interprétation romaine.
Si l’on rapporte ces données à l’étude des sanctuaires de sources, on voit que la tradi¬tion thérapeutique gauloise trouvait au IVe siècle dans la théorie médicale classique de quoi renforcer son succès, attirer davantage de médecins et de malades. [p.1093]
Les amulettes
Marcellus recommande d’utiliser pour presque toutes les maladies qu’il traite, des amulettes, c’est-à-dire des objets ou des animaux, tel le lézard, ou des formules inscrites sur un support variable, et que l’on suspend au cou, à la taille, au doigt du malade. C’est le médecin lui-même qui procède à la fabrication de l’amulette, et ce, en état de pureté (22).
Voici la liste des supports d’amulettes d’après Marcellus : pour les ophtalmies, les flux de sang, les maux de gorge, le support n’est pas précisé : in charta virgine. Ce peut être du papyrus, mais aussi tout autre support. Il faut l’envelopper dans une toile de lin, parfois rouge (VIII, 56 ; X, 34 ; X.,71; XIV, 65-68 ; XV, 89) ; pour le cœur et le foie, des lamelles de plomb (XXI, 2 et 8 ; XXII, 10) ; pour les reins, une feuille vierge, qu’on placera dans un étui d’or ou de cuivre (XXVI, 43-44) ; pour les yeux, la pierre trouvée dans le ventre d’une hirondelle, placée dans un coffret d’or, ou des yeux de lézard mâle, placés dans une bulle d’or (VIII, 45-50) ; pour les intestins, une lame d’or ou un anneau d’or (XXIX, 26). Les maux d’intestin paraissent mériter une cure plus coûteuse que les autres, mais un remède à bon marché était tout aussi efficace : transpercer les yeux d’un lézard mâle par un fil et l’attacher autour des reins du patient en récitant une formule (XXIX, 45). L’une de ces formules est précédée d’un chrisme (VIII, 58).
Ce sont sans doute des amulettes de ce genre qui nous sont rendues par les sources sacrées, comme les huit lamelles d’Amélie-les-Bains (23).
Les formules de Marcellus à inscrire sur ces lamelles ou chartes sont le plus souvent en caractères grecs ou latins, mais en langue celtique (24). C’est le caractère même que P.-M. Duval reconnaît aux lamelles de plomb d’Amélie-les-Bains. Vers 1847, on voulut accroître le débit de la source la plus chaude d’Amélie-les-Bains, et l’on fit sauter une partie du rocher qui livrait passage à l’eau par une fente étroite. La source coula plus abondamment, et apporta aussitôt des monnaies trop corrodées pour pouvoir être identifiées, et quelques objets : un bouton, un objet rond : capse en plomb très mince, dans laquelle est enchâssée une boule de plomb massif, et qui portait une anse de fer. Enfin on recueillit huit lamelles de plomb, roulées et aplaties, qui portaient des inscriptions en caractères latins (25). P.-M. Du val compte ces inscriptions au nombre des textes en langue gauloise. Nous pouvons préciser sans doute que ce sont des formules destinées à accompagner, ou remplacer selon le cas, des cures médicales, faites aux thermes d’Amélie, et que les malades, une fois guéris, offraient probablement à la divinité des eaux, cela d’autant plus qu’il faut toujours un rite de sortie pour les pratiques magiques (26). On a retrouvé une lamelle de plomb de même genre, écrite en minuscules latines, placée sur la poitrine d’un mort, dans un cimetière gallo-romain post-constantinien de Paris 27. Bohn qui a édité les inscriptions sur lamelles de plomb dans le Corpus Inscriptionum Latinarum, renvoie d’ailleurs à Marcellus pour l’explication possible de ces formules. On a trouvé encore des tablettes de plomb dans des tombeaux du IIe siècle, à Chagnon, en Saintonge (28).
Nous avons vu la place privilégiée des sources dans la médecine de la fin du IVe siècle. A la limite, l’amulette suffit, car la divinité est toute-puissante ; divinité officiellement chrétienne pour Marcellus, haut fonctionnaire de Théodose, mais combien païenne, à voir l’héritage gaulois de Marcellus. L’une de ses formules nous transmet une adresse aux Matrae gauloises : « Le sot allait à la montagne, le sot resta sot. Je t’adjure, par les Mères, de ne pas le prendre avec colère » (X, 35).
C’est aussi en relation avec les centres médicaux des sources que nous placerions l’épitaphe d’une jeune Lyonnaise de dix-huit ans : « Toi qui lis (cette épitaphe), va te laver aux bains d’Apollon ; ce que je fis avec ma femme, et voudrais pouvoir faire encore (29). » Dans les sanctuaires de sources, fréquentés en Gaule au IVe siècle, on a certainement pratiqué une médecine de ce style : herboristerie et amulettes, remèdes populaires de [p. 1094] lézards écrasés et de sang de colombes, ablutions, pour guérir enfin à J’aide de remèdes que l’ethnologie plus que l’histoire de la médecine devrait nous aider à comprendre.
Foi et guérison. Essai d’interprétation
Les malades se rendent au sanctuaire pour guérir une maladie dont les symptômes graves, sont somatiques. La frénésie et la mélancolie, diagnostiquées par leurs symptômes corporels, sont traitées comme les autres maladies, par les mêmes médications. Dans les recueils, Médecine de Pline, Médicaments, de Marcellus, et même la Collection Médicale d’Oribase, elles ne sont jamais traitées à part (30), ni sous forme de maladie mentale, ni sous forme de maladie nerveuse. Ce qui d’ailleurs est considéré comme maladie des nerfs, ou maladie due aux nerfs, ce sont les paralysies et les tremblements. Le nerf est considéré en lui-même, comme quelque chose de mécanique, qu’il faut par onctions, frictions, remettre en marche. Somme toute, ce qui est considéré comme maladie nerveuse, ce sont les troubles moteurs. Dans la partie de l’œuvre d’Oribase qui nous est parvenue, les troubles mentaux ne sont évoqués qu’à propos des traitements classiques, saignée et purgation : « J’ai arrêté de la même manière chez plusieurs individus, l’épilepsie, l’apoplexie, la mélancolie et d’autres maladies chroniques semblables. » « Je connais un homme qui est pris chaque année de mélancolie, à moins qu’on ne le purge non seulement au printemps, mais aussi en automne » (VII, 23). « Les signes suivants indiquent la nécessité d’une purgation : vertiges, pesanteurs et douleurs subites de la tête, tintements d’oreille continuels, obscurcissement de la vue, dureté de rouie, engourdissement des autres sens, tendance au sommeil, défaut d’appétit, goût amer ou autre goût quelconque désagréable après avoir bu quelque chose de bon, ennui sans aucune raison, affaiblissement de la mémoire quand on l’avait bonne jusque-là, palpitations se manifestant çà et là dans le corps, rêves fréquents qui effraient et qui troublent, un certain sentiment de frisson à la peau, pesanteur aux lombes… »
On sait bien, en outre, que les maladies psychosomatiques les plus nettes, expression d’une névrose ou maladie à composante névrotique, peuvent s’exprimer par la plupart des symptômes des autres maladies dites organiques : troubles sensoriels, moteurs, dermatologiques, internes (muscles lisses par prédilection, cœur, estomac, intestin, appareil urinaire) (31). Mais encore l’installation (concept de terrain favorable), la durée, de toute atteinte organique, sont liées aussi à l’état psychique du malade, en sorte qu’il n’y a aucune affection organique dont l’évolution ne soit fonction à la fois de l’organique et du psychique. Le critère de l’origine inconnue du mal, de sa durée avec état stationnaire ou récurrences, de l’intensité de la douleur, critères que j’ai retenus pour les déplacements vers les sanctuaires, apparaissent aussi comme les syndromes des maladies psycho¬somatiques. L’aspect religieux de la cure, qu’il nous faut examiner encore, pouvait contribuer à la guérison de ces maladies comme aucun médecin appelé au chevet d’un malade ne pouvait le faire. La confusion des symptômes pouvait alors contribuer à faire la réputation de tel ou tel sanctuaire.
Il n’y a jamais d’ambiguïté dans le choix d’un médecin, sauf peut-être dans les cas d’épilepsie. Tout vient devant le médecin, un et indivisible. Mais si l’on examine l’étiologie médicale, on lui trouve deux niveaux. Le premier niveau est celui de la mécanique corporelle, sur laquelle le traitement (évacuations, régime, pharmacopée) a prise. A ce niveau veut se limiter la médecine grecque d’Oribase, dans la Collection Médicale. Le deuxième niveau est celui de l’influence divine ou démoniaque dans le déclenchement de la maladie et par conséquent dans son évolution. De ce niveau, la médecine de Marcellus tient compte. Cela n’est jamais dit dans son livre. Nous ne pouvons déduire son étiologie que de sa thérapeutique. Les prières et les incantations disent à la fois qui guérit, qui [p.1095] prévient, qui envoie le mal. Ce mal est entré dans le corps, par une volonté extérieure à l’homme ; il en sortira, par des soins, certes, mais dont l’efficacité dépend du vouloir divin. Cependant, la puissance divine ou démoniaque ne se trouve pas installée dans le malade, elle lui reste extérieure. Le malade peut s’adresser lui-même à la divinité pour demander le départ du mal, par des prières ou actions magiques.
Allons davantage vers la réalité médicale du point de vue du patient. Ce dernier souffre. Il obtient une explication : par le biais de telle maladie, que la médecine connaît, le mal s’est introduit en lui. Le médecin lui fait absorber des remèdes : il est alors passif. Le médecin lui fait prier les dieux ou le fait agir sur les dieux : il devient actif, sujet de sa guérison. Le malade sait que de sa concentration volontaire dépend l’efficacité des formules et amulettes. Il bénéficie donc, au niveau de la pratique, d’une thérapie globale. L’homme est engagé, corps et esprit, dans sa propre guérison. L’explication du mal est donnée : ce mal est extérieur à l’homme, venu de puissances mauvaises. Cette explication est en accord avec tout le système culturel ambiant, elle trouve là sa rationalité. C’est pourquoi il va de soi que l’on se rende au lieu du culte pour guérir des plus graves maladies.
Du point de vue des maladies somatiques, s’il en est, l’existence d’une explication ajoutée à l’aspect actif de la cure augmente l’efficacité du traitement, peut hâter la guérison. Du point de vue psychosomatique, pour les cas qui en relèvent le plus directement, cette explication joue comme une explication plaquée, explication constituée en dehors du malade, mais dont l’acceptation contribue à la guérison, à la suppression des symptômes sinon de la cause profonde (32). Cette explication laisse indemne la responsabilité du malade. Un sort lui a été jeté , il est le jouet de puissances inconnues qu’il peut se concilier. On sait que l’explication plaquée psychanalytique, pratiquée de nos jours, obtient parfois l’assentiment du malade avec des résultats favorables, mais que parfois aussi elle devient elle-même pathogène en mettant le malade face à des causes internes à sa propre vie. L’explication du mal, de la maladie, dans l’antiquité non juive et non chrétienne, ne met le malade en cause qu’en lui suggérant qu’il a failli à quelque rite, ce qui peut être racheté par de nouveaux rites.
Le médecin ou prêtre intervient dans la procédure de rachat comme savant des formules et remèdes. Il n’est pas lui-même l’homme médecine. Le contact du patient et du divin se fait en partie directement. D’abord par le lieu sacré où l’homme se rend intentionnellement, ensuite, dans ce lieu sacré, par l’eau sacrée, elle-même divine (déesse Sequana), guérisseuse, efficace.
C’est dans ce contexte, à la fois religieux et médical, qu’il faut situer le succès des soins donnés aux malades par saint Martin de Tours, ainsi que le concours efficace apporté par les guérisons dans l’entreprise de conversion des Gaulois. Il faut ici sentir l’ambiguïté du mot conversion, à la fois volonté de convertir des hommes à une nouvelle religion et acte par lequel un homme se convertit à une nouvelle foi. L’ambiguïté se poursuit avec le terme de guérison qui lui est ici étroitement associé : Martin guérit le Gaulois qui alors se convertit, réversible en : Martin convertit le Gaulois qui alors guérit.
Martin médecin ?
Un passage bien connu, la guérison des yeux de Paulin de Nole à Vienne, par saint Martin, a intrigué les exégètes de la Vita Martini : « Paulin, cet homme qui devait ensuite donner un si grand exemple, avait commencé à souffrir gravement d’un œil, et déjà un voile fort épais avait recouvert sa pupille, jusqu’à l’obturer entièrement, quand Martin lui toucha l’œil avec un pinceau et lui rendit la santé antérieure en supprimant toute espèce de douleur (33). » Que Paulin ait ou non souffert d’une cataracte, il semble bien, et J. Fontaine le met en valeur (34), que Martin l’ait soigné selon les méthodes de la médecine [p. 1096] antique d’après ce texte. Cependant, doutant, comme la plupart des critiques de ce texte, de la réalité des capacités de Martin en ophtalmologie, il lui refuse une guérison qui paraîtrait crédible, racontée en termes de miracle, et il l’interprète allégoriquement, comme on a pu le faire ailleurs pour les reliefs des piliers des Nautes et de Mavilly, et du sarcophage de Ravenne (35). En effet, la représentation d’une séance de soins des yeux est liée à l’idée d’une illumination intérieure mystique, par la présence sur les reliefs de dieux spécialisés dans l’éblouissement spirituel. Cela paraît d’ailleurs d’autant plus plausible que Paulin de Nole parle lui-même d’illumination à propos de sa conversion à la vie ascétique (36).
Martin, nous dit Sulpice Sévère, servit dans les Scholares Alae, d’abord sous Constance, puis sous Julien (Vita Mart., 11, 2). Il fit partie sans doute de l’escorte, la garde donnée par Constance à Julien à son départ de Milan pour les Gaules. Dans cette garde de trois cent soixante soldats (Julien, 277 D), les moins vaillants au dire de Libanius, « ne savaient que marmonner des prières », selon un mot de Julien (Zosime. III. 3, 2). Sulpice nous dit les qualités de soldat chrétien de Martin : texte d’inspiration évangélique s’il en fut, et qui justifie l’étude littéraire qu’en fait J. Fontaine. Retenons simplement que Martin « assistait les malades, portait secours aux malheureux » (Vita Mart., 11, 8). Que le texte soit littéraire n’empêche pas le fondement réel de son inspiration : ainsi nous savons que chaque soldat transportait sa trousse d’urgence, et que les soldats se pansaient entre eux. Des médecins hiérarchisés étaient attachés aux corps de troupes, et des capsaires gardaient les boîtes de remèdes. L’armée est donc en quelque sorte la meilleure école de secourisme. Ceci n’implique d’ailleurs aucunement que Martin ait acquis autre chose que la science des bandages, et la recette de quelques onguents.
Désirant se consacrer au service de Dieu, Martin obtient de Julien son congé, en 356. Notons que les soldats rendus à la vie civile, avec les affranchis et les membres de la classe sénatoriale, étaient presque les seuls à pouvoir échapper aux obligations professionnelles, et ainsi à pouvoir embrasser la carrière ecclésiastique. Dès que Martin est libre, il va rejoindre à Poitiers saint Hilaire, alors en lutte contre les évêques arianisants de Gaule, et contre la politique de Constance II. Si nous laissons pour une autre partie de notre étude les critères qui ont fait choisir Martin comme exorciste plutôt que comme diacre, ce que Sulpice relate en l’expliquant par la modestie de Martin (Vita Mart., v, 2), nous remarquons simplement que Martin exerce dans l’église de Poitiers, une fonction ecclésiastique encore mal définie, et qui n’existe pas dans toutes les églises (37). Jérôme nous apprend (De Vir. inl., c) qu’Hilaire a composé un Libelle au préfet Salluste contre le médecin Dioscore, livre qui ne nous est pas parvenu et dont nous ne connaissons ni la date ni le contenu. Mais nous connaissons le préfet Salluste (38). Gaulois, il fut nommé questeur auprès de Julien quand celui-ci fut envoyé en Gaule en 356. Rhéteur païen, il gagna l’amitié et la confiance du César (39), qui le regretta quand Constance II le rappela en 359 (Julien, Orat., VIII). En 361, quand Julien prit le pouvoir et que le préfet du prétoire Nébridius, fidèle à Constance II refusa de lui prêter serment, il confia la préfecture du prétoire des Gaules à Salluste (40). Quand et où Hilaire a-t-il pu rédiger son libelle à Salluste ? Hilaire quitte la Gaule pour l’exil en 356, ou, en admettant un délai pour l’arrivée de l’ordre de Constance II, au plus tard au début de 357. Il reste ensuite en Asie jusqu’en 359, passe à Constantinople, et rentre en Gaule, avec l’accord de Constance II, en 360. C’est à cette date sans doute que Martin le rejoint à Poitiers, et s’installe dans un ermitage à Ligugé (Vita Mart., VII, l). C’est donc dans les quelques mois de la préfecture de Salluste en Gaule, en 361, qu ‘Hilaire lui envoya son libelle contre le médecin Dioscore, ami de Julien. A cette date, Julien ne s’est pas encore déclaré païen. Mais il protège les évêques nicéens contre Constance (41). Comme il est peu probable qu’Hilaire se soit-adressé par la suite au préfet païen qui partageait les idées de Julien sur le christianisme, c’est en 361 qu’il faut placer le Libelle. Or Martin, venu de l’escorte de Julien, a [p. 1097] eu un premier contact avec Hilaire en 356, et a été fait exorciste ; il se trouve de nouveau auprès d’Hilaire entre 360 et son élection à l’évêché de Tours en 370 (42). Saint Hilaire exprimera dans son commentaire du psaume XIII, vers 365, ses idées sur la médecine, que l’on peut interpréter de manière allégorique, mais qui lui viennent peut-être de Martin et sont sans doute à prendre à la lettre : « Dans un monde perdu, on cherche un médecin : on avait besoin d’un médecin, qui guérisse par une seule et même œuvre universelle de secours, qui soigne dans le monde entier toutes les maladies aussi variées soient-elles, cela non par la science ou la technique (quand a-t-on fait appel à la science et à la technique avec succès ?), mais par la puissance du Verbe. C’est lui que réclame l’esprit, c’est lui qu’il attend, car à son arrivée la fièvre se calme, les aveugles voient, la paralysie cesse, la mort s’éloigne » (Tract. in Psalmos). Saint Hilaire croyait à l’efficacité des paroles chrétiennes pour chasser les démons : « Un mot retient, punit, chasse ces êtres invisibles et incompréhensibles pour nous » (Tract. in Psalmos).
Mais comment détecter la présence de démons ? Par définition, les non-baptisés sont la proie des démons et doivent être exorcisés. Mais dans les autres cas, la maladie, la folie, tous les troubles que les païens attribuent aux puissances malfaisantes, restent pour le christianisme le signe de l’emprise du démon sur un être, provoquée parfois par les maléfices d’une autre personne.
C’est ce que croit l’Église officielle, en la personne de ses évêques réunis en concile, ainsi à Elvire, où l’on refuse la réconciliation, même à l’heure de la mort, à celui qui a tué par maléfices. C’est ce que croient des chrétiens lettrés comme Prudence. Ce dernier affirme que les païens utilisent la magie pour hâter la mort des grand-mères à héritage (43). En réalité l’exorcisme devrait pouvoir être pratiqué par tout chrétien, mais dans le contexte général du temps, l’exorciste est à la fois le connaisseur des formules et le détenteur d’un pouvoir charismatique, qui guérit le corps et l’esprit par des formules religieuses ou magiques : incantations, imprécations.
Martin, contraint de s’exiler, s’installe à Milan, puis se retire dans l’ile de Gallinara où « il vécut quelque temps de racines ». Il prit un jour de l’ellébore « plante vénéneuse, mais sentant la violence du poison l’attaquer et la mort déjà prochaine, il repoussa par la prière la menace de ce péril ». Ainsi Sulpice Sévère nous montre-t-il un Martin compétent en herboristerie. Qui prendrait par mégarde de l’ellébore, s’il en connaît le nom ! Une grande partie des ouvrages de médecine est consacrée à la description des plantes qui entrent dans la composition des remèdes, et dont certaines sont vénéneuses, au moins dans certains cas. Celse avait enseigné que le venin de vipère ou l’ellébore sont nocifs sur les plaies, mais non par absorption (De Med., V, 27, 3 b). Le père et le grand¬père d’Oribase jugeaient que le meilleur purgatif est l’ellébore, mais ils recommandaient au patient de faire son testament avant de se purger, car, parmi ceux qui en prenaient, plusieurs étaient suffoqués et peu restaient en vie (Oribase, VIII, 8). Il faut donc prendre des précautions pour administrer ce dangereux remède (Oribase, VII, 26).
Rentré à Poitiers près d’Hilaire, et installé à Ligugé, il ressuscite un catéchumène en s’étendant sur le corps inanimé depuis trois jours : « C’est à partir de ce moment que, pour la première fois, le renom du bienheureux prit de l’éclat : ainsi celui que tous tenaient déjà pour saint, fut tenu pour un homme puissant et vraiment digne des apôtres » (Vira Mart., VII).
- Fontaine distingue quatre sortes de miracles opérés par saint Martin (44). Les voici, brièvement énumérés : miracles objectifs, les plus évangéliques : résurrections, guérisons, exorcismes ; miracles coïncidence : ici, la plupart « des gestes thaumaturgiques » liés à l’assaut de Martin contre le paganisme rural ; miracles folkloriques, issus de la fonction fabulatrice du milieu de Marmoutiers, ou des souvenirs littéraires de Sulpice; miracles littéraires à l’état pur : « Invention gratuite et personnelle de Sulpice ». J. Fontaine classe avec réserves la guérison de la cécité de Paulin dans cette catégorie. [p. 1098]
Ce schéma est fait du point de vue de l’histoire littéraire, du point de vue de Sulpice Sévère. Voici un classement peut-être moins hypercritique, orienté vers une réalité antérieure au fait littéraire : puissance de Martin et guérisons ; guérisons à caractère médical.
Martin fit une deuxième résurrection dans la région de Ligugé. L’esclave de Lupicin, un notable, s’était pendu. Le saint, qui passait par là, réitéra le geste qui avait rendu la vie au catéchumène. Il s’allongea sur le corps, et le miracle s’accomplit (Vita Mart., VIII). La population locale fut alors convaincue de son pouvoir. C’est la population de Tours, instruite de ce pouvoir de thaumaturge, qui exigea son ordination contre l’avis des évêques réunis pour la désignation d’un nouveau prélat. Pour le faire sortir de sa cellule et l’ordonner évêque, on le pria de venir voir une malade (Vita Mart., IX).
Une fois évêque, Martin continua de faire des guérisons : « Mais pour la grâce des guérisons, elle était chez lui si puissante, que presqu’aucun malade ne l’approchait sans recouvrer la santé » (Vita Mart., XVI, 1). Sulpice raconte cinq guérisons que l’on peut mettre en relation avec les traitements médicaux de l’époque.
La jeune fille de Trèves(Vita Mart., XVI). Martin est appelé au chevet d’une jeune paralytique par le père au désespoir. Il commence par prier, « puis examinant la malade, il se fait donner de l’huile. Après l’avoir bénie, il verse la vertu de ce saint breuvage dans la bouche de la jeune fille, et aussitôt elle recouvre la parole. Puis progressivement, à son contact, la vie se ranima dans les différents membres, jusqu’au moment où, d’un pied assuré, elle se leva devant le peuple ». L’huile était l’excipient de nombreux remèdes médicaux. Oribase l’employait pour faire vomir, et précisément dans les cas de paralysie. Pour obtenir les vomissements, il conseille d’humecter Je corps par une nourriture abondante et du repos (VII, 23). Ensuite le malade doit être prié de vomir, et s’il n’y parvient pas seul, le médecin intervient : « Reconnaissant donc l’imminence du péril, nous y porterons remède sans retard, en enfonçant à l’aide de plumes, des huiles aromatisées dans la bouche » (VIII, 6).
Le cuisinier(Vita Mart., XVIII, 5). Comme Martin passait, toujours à Trèves, devant la cour d’une maison, le démon se saisit d’un cuisinier. Le malheureux mordait tous ceux qui l’approchaient. Martin lui donna l’ordre de s’arrêter, mais « comme l’autre grondait en montrant les dents, et, la bouche ouverte, menaçait de le mordre, Martin lui enfonça les doigts dans la bouche en disant : « Si tu as quelque pouvoir, dévore-les » Mais alors le possédé, comme s’il avait reçu dans la gorge un fer incandescent, écartait ses dents loin des doigts du bienheureux en se gardant bien de les toucher. Contraint par ces châtiments et ces tortures à fuir Je corps qu’il possédait, mais n’étant point autorisé à sortir par la bouche, il fut évacué par un flux de ventre, en laissant derrière lui des traces repoussantes ». Voici, en comparaison, comment Oribase conseille de purger dans les cas difficiles : « Chez un malade qui éprouvait des étouffements et qui était sur Je point de mourir, puisqu’il serrait les dents et palpitait comme du bétail qu’on tue, j’ai moi-même fixé les dents.et ouvert la bouche à l’aide de coins afin qu’elle ne se fermât point, puis j’introduisis la main, et, trouvant sur les organes de la déglutition une poignée de pituite ramassée sous forme de boule, je J’enlevai, et elle ne se rompit pas quand elle fut jetée à terre» (VIII, 7). La technique est la même.
La guérison de Paulin de Nole, examinée plus haut.
L’esclave d’Evanthius? (Dial., II, 2). Dans les Dialogues de Sulpice Sévère, Gallus, Gaulois et ancien militaire (Dial.,II, 1) compagnon de Martin, relate les miracles du saint. Un esclave d’Evanthius, oncle de Gallus, avait été mordu par un serpent. Son [p. 1099] maître le remit inanimé à saint Martin, alors que le venin s’était déjà répandu dans tout le corps. Martin posa le doigt sur la plaie et le venin sortit avec du sang. L’esclave se releva, sain et sauf.
La muette(Dial., 111, 2). Cela se passait sans doute dans la région de Chartres ou de Rouen, car Martin était en compagnie des évêques de ces deux villes, Valentin et Victrice. Un père lui présenta son enfant de douze ans, muette de naissance. Devant la foule émue, Martin versa un peu d’huile dans la bouche de la jeune fille en tenant sa langue avec les doigts. Bien entendu la fillette retrouva la parole. Ajoutons à ces exemples de traitements médicaux, l’onguent préparé par un ange, qui guérit les contusions de Martin après une chute (Vita Mart., XIX, 4). Après ces exemples, je crois que l’on peut prendre au sérieux les descriptions de guérisons que fait Sulpice. Ainsi Martin, homme inculte de l’aveu même de Sulpice (Vita Mart., XXV. VIII), son biographe enflammé, avait quelques connaissances médicales, sans doute acquises à l’armée. II ne refusait son aide à personne. Ses succès étaient attribués au dieu qui agissait grâce à ses prières, ce que lui-même croyait avec les assistants. Ainsi naquit un second type de guérisons : celles qui sont dues à la foi du malade sans intervention directe de Martin.
Le préfet Arborius plaça sur la poitrine de sa fille une lettre de Martin, et la fièvre quarte passa (Vita Mart., XIX, I). Une simple imposition des mains suffit à guérir l’esclave de Tétradius (Vita Mari., XVII). L’oncle de Gallus, à l’article de la mort, fait venir Martin. Se rendant à sa rencontre, il est brusquement guéri (Dial., II, 2). Un autre notable, Lycontius, écrit à Martin qu’une épidémie s’est déclarée chez lui. A distance, Martin vainc par la prière le démon qui s’est emparé du domaine (Dial., III, 14). Mais l’histoire la plus savoureuse est celle de ces moniales enfermées dans un couvent de Clion (Claudiomagus), paroisse fondée par saint Martin. Au cours d’une visite paroissiale, ce dernier dormit dans la sacristie. Après son départ elles vinrent toucher tout ce qui l’avait touché et se partagèrent les brins de sa paillasse. L’une d’elles obtint la guérison d’un énergumène en lui suspendant au cou l’un de ces brins (Dial., II, 8). Enfin, pour résumer l’action de saint Martin. Sulpice dit qu’il « soignait les malades et prit soin des gens en péril » (Ep., II, 12).
Un vase d’officine a été exhumé en Vendée, à Saint-Martin-de-Fraigneau, sur lequel était gravée à la pointe l’inscription : + Divi Martini Antistitis balsamum oleum pro benedictione. La paléographie. dit H. Leclercq, est du Ve siècle (45). Deux solutions sont possibles si la lecture est bonne. Ou bien il s’agit d’une huile dont la recette a été donnée par saint Martin, ou qui lui est attribuée, ou il s’agit, comme le suppose H. Leclercq, de la coutume rapportée par Grégoire de Tours et Paulin de Périgueux, qui consiste à déposer des vases remplis d’huile près des corps saints afin que la grâce divine y pénètre. L’inscription étant gravée à la pointe et non moulée avec le vase, il ne peut s’agir d’une fabrique en série pour l’officine d’un certain Martin. On a vu l’emploi de l’huile en médecine. On a vu l’emploi qu’en fait Martin. Il y a des attestations littéraires de bénédiction d’huile par Martin, pour soigner des maladies : ainsi pour la femme du préfet Avitianus (46) ; ainsi encore le jour où l’un de ces vases d’huile bénite tomba à terre sans se rompre (Dial., III, 3). Il est donc possible que de son vivant certaines formules lui aient été personnelles.
L’autre interprétation trouve aussi des confirmations littéraires : Paulin de Périgueux raconte la guérison d’une paralytique par une onction d’huile bénite placée près du tombeau de saint Martin (De Vita Martini, VI. 145-151).
Ce qui frappait le plus en Martin, ce n’étaient pas ses visions, ses conversations avec les anges, mais ses guérisons. Paulin de Périgueux montre que Je pouvoir de guérir de Martin lui survécut : « Des foules denses viennent souvent te visiter. et en leur présence ton pouvoir de guérir est toujours vivant » (866-867). Oribase lui-même s’adonnait sans [p. 1100] doute avec Julien à la divination et croyait à la puissance de la magie. Mais Martin ? Qu’en tant que chrétien il pratique les exorcismes, agisse en leveur de sorts, cela est normal, et nous le voyons insulter le démon, dans la guérison du cuisinier, imposer les mains, prier. Mais la technique qu’il emploie, l’usage de l’huile, rappellent trop les procédés thérapeutiques d’Oribase pour qu’on puisse penser à une action purement spirituelle.
Foi de Martin et foi en Martin
La croix. Saint Martin, quand il s’agit de son salut ou de celui des autres, salut matériel en cas de danger ou salut dans l’autre monde, croit à l’efficacité totale du signe de la croix et du mot crux, lui-même. Quand il demanda son congé, et refusa le donativumde Julien, il fut accusé de couardise, et proposa d’aller au combat sans autre secours que le signe de la croix (Vita Mart., IV, 5). C’est par le signe de la croix qu’il arrête un cortège funéraire païen (Vita Mart., XII). C’est le signe de la croix qui détourne le pin sacré qu’on abat et qui doit tomber sur Martin (Vita Mart., XIII, 8).
Mais surtout dans le rêve prémonitoire de Sulpice Sévère, rêve annonciateur de la mort de Martin (Ep., II, 4) un passage est frappant : « et moi, ayant embrassé ses saints genoux, je sollicitais sa bénédiction comme à l’accoutumée, je sentais sur ma tête la caresse délicate de sa main, tandis qu’au milieu des paroles solennelles de la bénédiction, il répétait le nom de la croix, si familier à ses lèvres ». Ainsi Martin croit à la valeur, à l’efficacité du mot crux, répété sans doute au milieu des phrases rituelles de la bénédiction. Martin croit aussi à certains gestes, il lève la main pour arrêter une vache furieuse qui s’est écartée du troupeau (Dial., II, 9), il souffle sur le démon qu’il voit derrière le mauvais comte Avitianus et ce dernier se vexe d’être exorcisé (Dial., III, 8).
Les songes et visions. Saint Martin, comme tous les hommes de son temps, croit aux songes, et la psychanalyse ne le contredira pas. Il y voit des monitions divines. Lorsqu’il donna la moitié de son manteau, il vit le Christ en songe sous les traits du mendiant (Vita Mart., III, 3-5). C’est un songe qui le pousse à retourner voir ses parents en Illyricum (Vita Mart., V, 3). Sur la route, il rencontre le diable, et nous suivrons J. Fontaine pour voir là quelque métaphore à propos d’un contrôle de la police de Constance II (47). De manière générale, même si Martin s’entretient avec les anges, c’est le diable qui apparaît, sous forme de Jupiter, ou la plupart du temps de Mercure et de Vénus et Minerve (Vita Mart., XXII ; Dial., II, 13). Contre ce diable : le signe de la croix. Il est évident que Martin rêve ses désirs, et rêve ses craintes. Jupiter, Mercure, Vénus, particulièrement Vénus mère, sont des divinités que l’on retrouve souvent dans les sanctuaires celtiques, avec les Matres, les Matrones, Matrae, et Apollon qui n’est jamais évoqué dans la Vita Martini. Il est évident aussi que Martin est vivement impressionné par ses rêves et ses visions. Oribase, on s’en souvient, soignait à l’ellébore les personnes sujettes aux délires et aux cauchemars.
Martin apparaît donc à la fois comme un soldat, d’assez grande force physique pour maîtriser les énergumènes, le cœur compatissant, impressionnable à l’excès, au point de consacrer sa vie à répandre une religion dont finalement nous ignorons ce qu’il connaissait, bien qu’il eût fréquenté saint Hilaire.
Foi en Martin. Martin apparaît, sans doute malgré lui, mais il y croira lui-même, comme un possédé de Dieu, potens, puissant. C’est le qualificatif que tous lui attribuent (48). Le substantif, sa qualité, c’est la virtus qu’il faut traduire par pouvoir (49) et la tradition s’en maintient avec Grégoire de Tours qui écrit « Sur les vertus de saint Martin », c’est-à-dire sur les guérisons miraculeuses près de son tombeau. [p. 1101]
Ainsi chez Sulpice Sévère n’est-il jamais question de foi en Dieu, mais de foi en Martin. Sulpice rapporte la parole du Christ sur les merveilles que feront les croyants et en conclut que « ceux qui ne croient pas aux œuvres de Martin ne croient pas aux paroles du Christ » (Dial., I, 26) : c’est un sacrilège de dire que Martin a menti (Dial., II, 13). En effet, Postumianus, de retour d’Orient, passant à Primuliacumchez Sulpice Sévère, rapporta que l’opuscule sur la vie de saint Martin était connu dans le monde entier, mais que certains n’y voyaient que mensonge (Dial., I, 26).
La foi dans le Christ passe donc par la foi en Martin. Ceux qui ne croient pas en Martin sont les incrédules (Vita Mart., XXV), les infidèles ; en revanche, la femme de l’empereur Maxime, pendant le séjour de Martin à Trèves, voulut le servir elle-même, cuisinait pour lui, mélangeait son vin avant de lui offrir les coupes, et après le repas du saint, avec foi, satis fideliter, elle recueillait, pour les servir à la table royale, les miettes de pain qu’il avait laissées : illas reliquias (Dial., II. 6). Faut-il déjà l’entendre au sens de reliques, ou prendre le sens de reliefs ? sans doute Sulpice Sévère est-il bien près de proposer le premier sens, lui qui va être l’initiateur du culte de Martin. Ceux qui liront le livre de Sulpice sans y croire (infideliter), seront des pécheurs (Vita Mart., XXVII, 6 ; Ep., I, 5). Et en effet, Sulpice nous montre des foules qui ne demandent qu’à croire. Foule pour l’élection de Martin, venue de Tours et des cités voisines, pour forcer la main des évêques (Vita Mart., IX, 1-3), foule à Trèves devant la maison où il va soigner la jeune paralysée, foule à Chartres pour la résurrection d’un mort, foule à son enterrement (Ep., III, l 7).
On croit tellement à son pouvoir que certains finissent eux aussi par avoir des visions. Le préfet Arborius. qui avait guéri sa fille de la fièvre quarte en plaçant sur sa poitrine une lettre de Martin, vit un jour la main de Martin se couvrir de pierres précieuses pendant la messe (Dial., III, 10). Toujours pendant une messe, une vierge, un prêtre, et trois moines virent un globe de feu jaillir de la tête de Martin, tandis que la foule ne voyait rien (Dial., II, 2). Ainsi donc il s’opère une dialectique de la foi et de la guérison. Une coïncidence, la première résurrection, et ses succès médicaux appellent d’autres guérisons dues à la foi. La foi provoque les visions et Je tout concourt à un succès de Martin, une notoriété qu’il rapporte lui-même à la puissance de Dieu. Est-ce la certitude de son pouvoir qui lui fait dompter les animaux ? Lorsque les agents du fisc le rencontrent sur une route. Le battent et le laissent pour mort, leurs montures se sauvent (Dial., III, 3). Une vache en furie s’arrête devant Martin (Dial., II. 9), un serpent d’eau part sur l’autre rive (Dial., III. 9). On fait taire les chiens « au nom de Martin ! » (Dia!., III, 3). Coïncidence encore, il commande aux éléments : à la mer, à la grêle, au feu (Dial., III, 14 ; III, 7 ; Vita Mart., XIV, l). Comment ne ferait-il pas de miracles !
Guérison et conversion
C’est dans ce contexte psychologique qu’il faut placer les conversions faites par Martin : convaincu de la puissance du Dieu chrétien, il désire convertir les Gaulois à ce Dieu : nul doute qu’il fut missionnaire plus que les autres évêques de Gaule. Nul doute non plus que ses succès l’ont convaincu de la puissance de Dieu en lui, comme ils ont convaincu aussi les foules, avides de sécurité psychologique, que cet homme était l’homme de Dieu.
Dans ces conditions, nous allons trouver des conversions de deux sortes : par la prédication, rares, et par les miracles : c’est le cas général. Par la prédication, Martin convainquit le brigand qui l’assaillait dans les Alpes : c’était avant la révélation de ses pouvoirs de thaumaturge (Vita Mart., V, 4). De même il convertit sa mère et des habitants de l’Illyricum (Vita Mart., VI. 3). Mais dès que sa vocation de thaumaturge est [p. 1102] certaine à ses propres yeux et que ses succès fondent sa réputation, les conversions changent de critère et cela par deux procédés. Un grand personnage appelle Martin pour guérir un membre de sa famille (familia), esclave, enfant. C’est le cas de Tetradius. Païen, il promet de se convertir si Martin intervient (Vita Mart., XVII). Le préfet Arborius, déjà chrétien, voue sa fille à Dieu, après une amulette martinienne (Vita Mart., XIII). C’est certainement un des moyens par lesquels des maisons entières se convertirent, à la différence de la progressive conversion des familles romaines. Dans le second cas c’est une foule païenne tout entière qui passe au christianisme. Lorsque Martin accepta de se placer à l’endroit où le pin sacré devait tomber, la foule païenne tout entière réclama l’imposition des mains quand le pin tomba de l’autre côté (Vita Mart., XIII). A Levroux, il démolit un temple devant les païens paralysés (Vita Mart., XIV) , ils reconnaissent avoir été maintenus par le Dieu de Martin et se convertissent. Dans le pays éduen les foules se font chrétiennes (Vita Mart., XV). Dans la cité de Chartres on ne connaissait pas le Christ, mais on avait entendu parler de Martin ; aussi, à l’annonce de son arrivée, une multitude arriva, à laquelle Martin se mit à prêcher. C’est devant cette foule qu’il ressuscita le fils unique et aussitôt elle se rua à ses genoux pour demander à devenir chrétienne. « Sur le champ, il leur imposa les mains pour les faire catéchumènes » (Dial., II, 4). On ne s’étonnera pas qu’un ancien militaire comme Victrice de Rouen (Paulin de Nole, Ep., XVIII, 7), que Martin retrouva à Chartres, invite Martin, dans l’espoir sans doute, d’accroître son troupeau.
La documentation martinienne, à l’inverse de celle des sanctuaires de sources, apporte des exemples de guérisons et non une liste de maladies. Ces guérisons sont des miracles thérapeutiques, toutes guérisons inattendues et subites (50). Les deux cas de résurrection sont dus à l’initiative de Martin. Il fait chaque fois évacuer la pièce, s’allonge sur le mort, prie, sans avoir rien promis auparavant. Dans un autre cas, Martin se rendait précisément chez un notable. Dès l’entrée, il sentit une présence démoniaque. C’est alors qu’un démon s’empara du cuisinier de la maison, et que Martin intervint spontanément. Dans tous les autres récits de guérison, à l’inverse, on fait appel à lui, soit qu’on le prie de venir, soit qu’on lui conduise un malade.
Toutes les interventions, si l’on excepte l’enfant muette qu’on amène sur son passage, ont lieu au domicile de notables, et concernent le notable lui-même, sa fille ou un domestique. Considérons les maladies pour lesquelles on a recours à la puissance du thaumaturge. Lorsqu’il est témoin d’une phase aiguë de maladie entéro-gastrique et lorsqu’il arrive chez Gallus peu après une morsure de serpent, c’est le hasard qui le met en présence du malade. En revanche, son intervention est sollicitée pour deux cas d’aphasie, dont l’une avec paralysie, et pour un début de cécité. Ce sont les cas types pour lesquels la cure de sanctuaire aurait été indiquée.
Dans ces cas précis de paralysie et de cécité, on a le temps en effet d’appeler les médecins pour des soins à domicile. C’est après leur échec que l’on cherche un autre recours. On fait alors appel à Martin. Celui-ci se déplace comme le médecin, et emploie des techniques comparables. Mais sa personne véhicule la puissance que le paganisme attachait au lieu du sanctuaire de source. L’huile qu’il verse dans la bouche du patient est le liquide saint, équivalent des eaux saintes. Cependant il s’agit ici d’une clientèle aristocratique, accoutumée à mander le médecin, et qui mande Martin sur la foi de sa réputation. C’est une tout autre clientèle qui se déplace vers Tours, ou vers les villes que visite le saint. A l’exception de l’enfant muette qu’on lui présente dans une ville de l’Ouest, tous les autres cas évoqués sont des cas de possession. Notons d’abord la confusion faite par l’entourage, par Martin et par son biographe, entre les hurlements et l’agitation d’un homme en crise aiguë de maladie intestinale, comme c’est le cas du cuisinier, et l’agitation du possédé. On trouve ensuite un groupe d’énergumènes qui vit dans l’église de Tours, guettant le passage de Martin. Un énergumène encore est guéri [p. 1103] par une amulette martinienne. Donc pour la clientèle aristocratique. Martin remplace le médecin que l’on déplace, et pour la clientèle populaire. Martin devient le lieu de la guérison. Durant sa vie, par les amulettes et par J’huile, son pouvoir se déplace vers les malades. Après sa mort se perpétuent les deux mouvements : huile sanctifiée vers les malades, malades vers son tombeau, devenu le lieu fixe de la guérison, en tout point comparable au sanctuaire païen. Ce qui doit nous retenir, c’est le temps de la vie de Martin, comme temps de transition. Il nous faudrait avant d’aller plus loin, connaître les signes cliniques qui distinguent les énergumènes.
Les cas de paralysie, cécité, aphasie, sont décrits individuellement, sans aucune indication étiologique. Une fois seulement la maladie est mise en relation avec le démon, lors d’une épidémie chez Lycontius. Les autres cas se répartissent sous deux vocables qui sont en eux-mêmes des définitions : démoniaques et énergumènes. Sulpice ne relate que deux cas d’intervention de Martin auprès de démoniaques. Il s’agit de l’esclave de Tetradius et du cuisinier : deux domestiques. Les signes cliniques sont décrits : tous deux sont enragés, furieux ; tous deux se jettent sur leur entourage et mordent ceux qui s’approchent. Tous deux paraissent endurer de cruelles souffrances. Douleur, délire, gestes désordonnés, panique : voilà des symptômes qui pourraient être ceux de la frénésie, selon la classification des maladies chez Oribase, Pline, Marcellus. Dans le cas de l’esclave de Tetradius, c’est l’entourage païen qui définit la crise comme démoniaque, et court chercher Martin. Dans l’autre cas, c’est Martin qui détecte le démon et s’adresse à lui, le provoque, le fait fuir. Reste une autre catégorie, celle des énergumènes. Il est impossible de dire s’il s’agit d’épileptiques uniquement, ou si des agités sont avec eux sous le même vocable. L’étymologie renvoie à la possession. C’est le dieu qui habite l’épileptique. C’est précisément le cas pour les énergumènes rassemblés à Tours. Lorsqu’on leur demande leur nom, il répondent : « Jupiter, Mercure » (Dial., III, 5). Dans le cas du cuisinier, c’est au démon que s’adresse Martin en enfonçant ses doigts dans la bouche du malheureux : « Si tu as quelque pouvoir, dévore-les ! ». Dans les religions païennes, on attribuait bien l’épilepsie et les délires à l’installation d’une puissance divine dans le malade (51). Chez les Romains, on les nommait lymphes et larves, et on les croyait entrées par la bouche ou par le nez. Des pratiques magiques étaient employées pour y remédier : on plantait un clou là où tombait un épileptique, on faisait des cérémonies de purification pour la folie, des sacrifices, des exorcismes. On y ajoutait la récitation de formules, parfois de lettres éphésiennes sans signification apparente, et bien entendu le port d’amulettes pour protéger contre un retour du mal, ou attirer la vengeance des dieux sur l’ennemi jeteur de sort.
A Tours, les énergumènes n’ont pas nom de lymphes ou de larves. Ils avouent les noms des plus grands dieux du panthéon gallo-romain : Jupiter et Mercure. Ce sont ces mêmes dieux qui tourmentent le plus souvent saint Martin (Vita Mart., XXII), Mercure est l’un des dieux habituels des sanctuaires de sources (52), ainsi que des tablettes d’imprécation (53). Les énergumènes sont donc possédés par les dieux païens, identifiés aux démons par Martin. Les malades venus à Tours sont atteints des maladies qualifiées par le paganisme même de maladies démoniaques, de possession. A Martin, comme aux dieux gaulois, on demande la guérison. On s’adresse à lui pour des maladies qui relèvent de la cure de sanctuaire : paralysie, cécité ; mais apparaît alors une catégorie de malades qui ne sont d’ailleurs pas définis comme tels, les possédés, malades qui se rassemblent, ou que l’on achemine vers l’église de Tours. Le saint emploie les techniques médicales auxquelles les malades étaient habitués : usage de l’huile, du point de vue technique, usage de formules, de gestes et de prières, comme dans la tradition magico-médicale gauloise. A quoi rattacher son succès thérapeutique ? [p. 1104]
Depuis le début du IIIe siècle, les impératifs de la défense avaient déterminé la politique impériale. Ces impératifs étaient certes le recrutement de soldats et le paiement de soldes à des hommes improductifs, mais surtout la fourniture de ravitaillement aux armées. C’est ainsi que s’est engagé un processus de dégradation sociale, par le biais d’un prélèvement étatique confié aux mains de particuliers, les notables locaux. La première cause d’insécurité, pour les paysans les plus éloignés du front, était l’incertitude des quantités annuelles de produits agricoles à fournir sous forme de redevances ou d’impôts, et par conséquent de leur propre subsistance. A la fin du IVe siècle le processus est presque à son terme. Le paysan, surtout en Occident, s’en remet à un patron pour la défense de sa récolte contre les notables percepteurs. Il accroît sa dépendance à l’égard d’un homme pour diminuer sa dépendance à l’égard d’une institution. Mais cette dépendance ne lui apporte la sécurité ni du point de vue des impôts désormais convertis en redevances, ni surtout du point de vue militaire.
Si l’anxiété se résout dans deux directions, l’action, ou la dépendance sécurisante, ·on pourrait voir dans les bagaudes, révoltes paysannes gauloises, un exemple de réaction active. Ces bagaudes ont toujours été païennes, et parfois se sont attaquées aux édifices chrétiens. De l’autre côté, la dépendance sociale mise en place au IVe siècle, n’a pas donné la sécurité espérée. Elle n’a donc pu qu’engendrer un regain d’anxiété, accru par la conjoncture militaire. Que les manifestations de cette anxiété : maladies psychosomatiques ou phénomènes de possession, se multiplient, c’est ce que montrent les textes. Le processus social s’étend sur deux siècles, deux siècles d’incertitudes, d’invasions répétées à moins d’une génération d’intervalle, particulièrement en Gaule du Nord.
li ne s’agissait pas d’une adaptation à un nouveau corps social, ce qui sera le cas à partir de l’installation définitive des barbares sur le sol romain. Il s’agissait de contacts violents et épisodiques, dont la récurrence était certaine, et auxquels il faut ajouter les guerres civiles entre empereurs et usurpateurs, et les révoltes.
La situation était anxiogène. La documentation, insuffisante certes, donne deux types de réactions de dépendance accrue par la maladie. si nous admettons que la guérison inattendue et instantanée révèle l’aspect psychosomatique de la maladie. Le premier type, décrit chez les notables, est la maladie psychosomatique d’apparence organique : paralysie, aphasie. Le second type s’exprime par les symptômes de l’anxiété : corps souvent figé dans une attitude presque parkinsonienne, mouvements désordonnés, affolement dus aux douleurs précordiales, expression mimique particulière, surtout oculaire 54. Ces maladies n’ont d’intérêt historique que par leur fréquence et leur diffusion sociale. On ne peut en effet réduire l’action de Martin à la guérison de « maladies », sans tenter de préciser quelles maladies, et selon quels groupes sociaux, ce qui a été tenté ici. C’est ainsi seulement qu’on parviendra à cerner le pourquoi du succès et de la supériorité de Martin sur les dieux gaulois.
Du point de vue du malade, la thérapie martinienne est cumulative. Elle utilise le traitement médical le plus classique, celui des évacuations. Mais ce qui est évacué, par vomissements ou défécation, c’est le démon : « Contraint par ces châtiments et ces tortures à fuir le corps qu’il possédait, mais n’étant pas autorisé à sortir par la bouche, il fut évacué par un flux de ventre, en laissant derrière lui des traces repoussante » (Vita Mart., XVII), Le mal entré dans le corps en sort par la technique médicale mise dans les mains du prêtre. Deuxième élément constitutif de la cure martinienne : le port d’amulettes et la récitation de formules. Mais ce qui fait la grande différence entre la cure de sanctuaire et la cure martinienne, c’est la substitution de l’homme au lieu. Entre le malade et Martin peut se développer une relation thérapeutique. Le lien de dépendance est voulu, obligatoire. Le pouvoir est entièrement aux mains de Martin : pouvoir de Dieu sur le mal. Le malade est donc à la fois agi par le démon entré en lui, et agi dans le processus curatif par le contre-pouvoir de Martin, sans qu’il ait lui-même à faire d’autre [p. 1105] action que de se remettre entièrement au pouvoir du saint. La soif de dépendance est alors satisfaite. Comme dans l’étiologie de Marcellus et de la médecine gauloise, une explication du mal existe. Chez Tetradius, l’esclave enragé, possédé, ne veut pas se laisser mener auprès de Martin. Martin, de son côté, refuse d’entrer dans une maison païenne. La conversion est alors promise, et le démon aussitôt expulsé par imposition des mains. Les énergumènes en s’avouant Jupiter et Mercure, se disent malades du paganisme. La conversion tient alors lieu d’action magique, et le paganisme reconnu comme faute, tient lieu d’explication de la maladie. Ainsi la cause est-elle devenue interne au malade et doit-il s’en purifier toute sa vie dans une dépendance accrue à l’égard de nouveaux rites et de nouvelles institutions, car cette dépendance ne s’interrompt pas avec la disparition des symptômes. Elle est à la dimension de la faute totale qui a causé le mal.
En revanche la relation au thaumaturge, l’aura de la guérison miraculeuse, offrent la plus belle compensation à la situation de désespoir génératrice d’anxiété, compensation en sécurité dans la dépendance au thaumaturge père, et compensation en prestige social.
Aline ROUSSELLE
Centre Universitaire de Perpignan
Notes
(1) E. et L. EDEI.STEIN. Asclepius.A collection and interpretation of the Testimonies. Baltimore. 1945.
(2) R. HERZOG, « Die Wunderheilungen von Epidauros », Philologus, Supplement Band XX, 3, Leipzig, 1931, pp. 71-112 ; cf. A. J. FESTUGIÈRE, dans Histoire générale des religions. Grèce¬Rome, Paris, 1948, pp. 132-136.
(3) Drs R. BERNARD et P. VASSAL, « Étude médicale des ex-voto de la Seine ». R .A .E., T. IX. 1958, pp. 328-337 ; P. LEBEL, « Complément à l’étude médicale des sources de la Seine », avec une note complémentaire du Dr Vassal, R.A.E., T. XIII, 1962, pp. 220-222.
(4) S. DEYTS, « Nouvelles figurations anatomiques en bois des sources de la Seine». R.A.E., T. XX, 1969, pp. 235-245.
(5) Il est impossible de faire une étude parallèle à celle de P. A. Sigal, éMiracles et guérisons au XIIe siècle », Annales E.S.C.. nov.-déc. 1969, pp. 1522-1539. en particulier la carte de la provenance des malades.
(6) J. ALBISSON, Contribution à l’étude des maladies d’origine professionnelle en agriculture.
Thèse de Médecine de la Faculté de Paris, 1956, n° 143 ; à l’étude des maladies portées au tableau officiel, J. Albisson ajoute celle de maladies qui atteignent plus fréquemment les ruraux que les autres catégories socio-professionnelles, et qu’il suggère d’adjoindre aux premières. Les Drs Louis Fabre et Henri Arles, de la Mutualité Agricole de Montpellier, ont bien voulu examiner pour moi le tableau des maladies professionnelles de l’agriculture afin tout d’abord d’éliminer les maladies dues aux produits chimiques contemporains. Ils m ‘ont aidée par la description des symptômes et leur connaissance des séquelles.
(7) É. PATLAGEAN, Recherches sur les pauvres et la pauvreté dans l’Empire romain d’Orient, IVe-VIIe siècle. Thèse de Lettres de Paris, 1973, Service de reproduction des thèses de l’Université de Lille-III, 1974, T. I. pp. 234-261.
(8) Cf. A. J. FESTUGIÈRE. Histoire générale des religions. loc. cit., p. 136. n. 64.
(9) É. PATLAGEAN, loc. cit., p. 251.
(10) J. ALBISSON, loc. cit., p. 35.
(11) P. A. SIGAL, « Comment on concevait et on traitait la paralysie en Occident dans Je haut Moyen Age (Ve-XIIe siécle) ». dans la Revue d’Histoire des Sciences. T 197, pp. 193-211. [p. 1106]
(12) P. GERBAUT, J. R. HELLUY. J. LORRAIN, M. WF.BER. Ph. CANTON. « Le tétanos. dans Synthèses cliniques. Supplément des Monographies médicales et scientifiques, n° 108, déc. 1963. particulièrement pp. 53-55.
(13) Voir l’Index nominorum d’ESPÉRANDIEU. C. I. L. XIII. III. et R. A., !oc. cit. On posséde un cachet d’un oculiste nommé Balbinus, cachet trouvé dans le Puy-de-Dôme : C. I. L.. XIII. III1, 10 061. n° 181. Un vase pharmaceutique découvert près de Lapalisse, sort de l’officine d’un Q. Julius Balbinus, peut-être le même. C. I. L. XIII. III, 10 011. 208. Voir HÉRON DE VILLEFOSSE et E. THÉDENAT. « Note sur quelques cachets d’oculistes romains ». Bulletin monumental, 1881. pp. 75-90. 259-285. 563-611 ; 1882. pp. 5-55. 105-153. 603-718 ; 1883. pp. 153-185. 308-359. analyse des noms des remèdes des maladies.
(14) J. BEAUJEU, La médecine, dans L’Histoire générale des sciences. dir. R. TATON, T. 1, p. 404 : « Les collections de remèdes authentiques et de recettes extravagantes disséminées dans l’Histoirenaturellede Pline l’Ancien ou réunies dans les Compositionsde Scribonius Largus ne méritent guère de place dans un ouvrage d’Histoire des sciences. »
(15) MARCELLUS. De Medicamentis liber. éd. M. Niedermann. Corpus Medicorum Latinorum, T. V. Leipzig-Berlin. 1916 : cf. P.-M. DUVAL., dans Les Sources de l’Histoire de France, T. I. 2e partie, Paris, 1971, p. 630, bibliographie.
(16) MARCELLUS. Loc. cit., p. 3 : ab agrestibus et plebeis fortuita ac simplicia.
(17) J.-J. HATT, Celtes et Gallo-Romains. coll. Archaeologia Mundi, Genève. 1970. p. 300.
(18) J.-J. HATT, loc. cit., p. 300.
(19) AUSONE, Praefatiunculae, V. 6. Il épouse une jeune fille de Dax. Aquae Tarbellicae, et Parentalia. V. 12.
(20) Sur l’intégration des familles druidiques dans les cadres romains dès les débuts de l’Empire. voir M. CLAVEL-LÉVÊQUE, « Le syncrétisme gallo-romain : structures et finalités », dans Praelectiones patavinae. Rome, 1972. pp. 113-114.
(21) É. THÉVENOT. « Médecine et religion aux temps gallo-romains : le traitement des affections de la vue ». dans Latomus. T. IX, 1950. pp. 416-420.
(22) Par exemple, XV. 89 : Memineris ut mundus haec facial.
(23) C. l. L., XII. 5 367, dans la lecture qu’en donne Hirschfeld, admettant celle de Bonnefoy. A. LEBÈGUE, « Études sur quelques inscriptions latines trouvées dans la Narbonnaise ». Revue Archéologique, 1882. 2. p. 137. corrigea avec l’accord de Bonnefoy cette lecture et donne : Kantas Niskas. rogam (u)s et deprecamus{?) vos, et sonate, sur la plus complète des lamelles.
(24) G. DOTTIN. La langue gauloise, Paris, 1920. p. 214, pour les formules. Cf. P.-M. DUVAL, « Les inscriptions gallo-grecques trouvées en France ». Actes du Colloque sur les influences helléniques en Gaule. Paris. 1958, pp. 63-69. Bibliographie sur la langue gauloise de Marcellus dans P.-M. DUVAL, Les Sources de l’Histoire de France. T. I. La Gaule, pp. 630-631.
(25) HENRY. « Lettre à Monsieur Prisse d’Avennes sur les inscriptions recueillies aux sources minérales d’Amélie-les-Bains ». Revue Archéologique. 1847, pp. 409-414, avec un fac-similé d’autant plus précieux que les objets ont disparu depuis.
(26) R. CAGNAT, « La sorcellerie et les sorciers chez les Romains ». Annales du Musée Guimet. Bibliothèque de vulgarisation, XV, 1903-1904, pp. 134-175. sans référence, mais où l’on reconnaît les nombreuses allusions à Marcellus. [en lige sur notre site]
(27)C. l. L., XIII, III, 10 029, 328. 6e série. 1898. pp. 39-62.
(28) C. JULIAN, « La question des piles ». Mem, Soc. A.F.. T. 57.
(29)C. l. L., XII. 1983, qui pour lro KAJANTO, « Balnea. vina. Venus ». Mélanges Renard, II. coll. Latomus. Bruxelles, 1969, est une épitaphe érotique: Tu qui legis, vade in Appollinis lavari, quod ego cum conjuge feci, vellem sic adhuc possem.
(30) MARCELLUS. XXV : paralysie ; XVII. 6 et I, 25-26 : frenetici et lethargici.Medicina Plinii, III. 18 : lethargici, III. 19 : frenetici.
(31) Voir par exemple M. CHARCOT, La foi qui guérit, pour ulcères et tumeurs hystériques ; [en ligne sur notre site]ALEXANDER, La médecine psychosomatique. Paris. 1952.
(32) Je ne peux donner qu’un choix des lectures qui ont suggéré ou complété les questions posées aux textes. Plus que les histoires de la médecine, la Science dans l’Antiquité, de [p. 1107] B. FARRINGTON. éd. fr .. Paris. 1967, ma été utile. De même, davantage que les ouvrages spécialisés, études de cas d’hystérie, la présentation des Théories psychosomatiquesde J.-P. VALABRÉGA. Paris. 1954. a orienté mon travail. J’ai trouvé dans le livre de Ivan ILLICH. Némésis médicale, Paris. 1975, outre une bibliographie orientée vers le problème de la guérison et du malade et non vers les progrès de la connaissance du corps humain, des idées que l’on reconnaitra au passage. Sur l’explication plaquée et son fonctionnement, utile ou néfaste, J .-P. VALABRÉGA. Théories psychosomatiques, p. 44 ss.. présuppose que l’explication donnée est juste, scientifiquement juste, tandis qu’en ce qui concerne la présente étude, il s’agit d’une explication reconnue par le patient comme juste, quelle que soit l’appréciation que nous puissions porter sur ses fondements.
(33) Vita Martini, 19. 3. éd. J. Fontaine. T. 1. pp. 294-295. dans la traduction de J. Fontaine.
(34) Ibid., t. Il. p. 883 SS.
(35) M. RENARD, Asklepios el Hygie en Gaule, loc. cit., bibliographie.
(36) PAULIN DE NOLE. Epist., 18. 9. ed. Hartel. C. S. E. L. XXIX. 1, p. 136. écrite trois ans après sa conversion. en 398 : cf. P. FABRR. Essai sur la chronologie de l’œuvre de saint Paulin de Nole, Strasbourg. 1948. p. 138.
(37) H. LECLERCQ, art. exorciste, D. A . C. I., V. col. 964-978.
(38)K. F. STROHEKER. Der Senatorischer Ade! im Spätantikcn Gallien, Tübingen. 1948. p. 213. n° 343. Cf. R. ÉTIENNE, « Flavius Sallustius et Secundus Salutius ». R. E. A.LXV, 1963. pp. 104- 113 ?
(39) J. BIDEZ. La vie de l’empereur Julien, Paris. 1942, p. 140.
(40) E. STEIN. Histoire du Bas-Empire, éd. J. R. Palanque, Paris. 1959. l. L p. 156.
(41) E. STEIN. op. cit., T. 1, p. 158. Cf. SULP. SÉV., Chron., II. 45. p. 4 ss.
(42) J. FONTAINE, op. cit.,T. Il. p. 661.
(43) Concile d’Elvire. can. VI, dans Concilias Visigoticos e Hispano-Romanos, éd. J. Vivès, Barcelone, 1963. p. 3. PRUDENCE. Contra Symmachum, éd. M. Lavarende. coll. des Universités de France. 1948. T. Ill. p. 165, V. 165.
(44) J. FONTAINE. op. cit., T. 1, p. 303. Cf. encore J. FONTAINE. « Une clé littéraire de la vita Martini. de Sulpice Sévère : la typologie prophétique» dans les Mélanges Christine Mohrmann, 1963. pp. 84-96.
(45) H. LECLERCQ, D. A. C. L.XV. coll. 2 663. s.v .. Tours. Cette inscription ne figure ni au C. I. L, XIII. ni dans LE BLANT. Inscriptions chrétiennes de la Gaule.
(46) Dial., III, 3. et H. LECLERCQ. D. A. C. L.. I. s.v. ampoule.
(47) J. FONTAINE, T. II. p. 57. sous forme d’hypothèse.
(48) Lors de la première résurrection, lorsque tous prennent conscience du pouvoir de Martin, et lui de même, Vita Martini. VII. 7 : Ep, 1. 5 :, IDial. 24. p. 177 : personne en Égypte n’est plus puissant que Martin.
(49) Vita Martini. passim et Dial., 1. 23: 1. 27 et passim cf. Index de HALM.
(50) Sur les guérisons inattendues, dans le cadre des maladies mentales, voir par exemple : BARUK. Psychiatrie médicale, physiologique et expérimentale, Paris. 1938. p. 633 ou pp. 656- 657 : Jeanne ABOUDRAR. Contribution à l’ étude des guérisons inattendues au cours des maladies mentales, thèse de médecine de Paris. 1964. n° 48. En matière de maladies psychosomatiques, le problème est évoqué dans la plupart des ouvrages qui en traitent : bibliographie dans J .-P. VALABRÉGA, Les théories psvchosomatiques. Paris. 1954.
(51) Voir JOBÉ-DUVAI., Les morts malfaisants. Larves, Lémures, d’après le droit et les croyances populaires des Romains, Paris. 1924 : E. MASSONEAU. La magie dans l’Antiquité romaine. Paris, 1934, p. 77 ss.
(52) É. THÉVENOT. Médecins et religion, loc. cit., p. 421 ss .. et « Le dieu cavalier Mithra et Apollon, leurs affinités dans les cultes gallo-romainsé. dans La Nouvelle Clio. 1949. 1 et 2. p. 615.
(53. WUENCH. Defixionum tabellae. 1897 et R. HEIM,Incantamenta magica graeca el latina, Leipzig. 1902.
(54) Cf. P. GUIRAUD. Psychiatrie générale. Paris. 1950. p. 532.


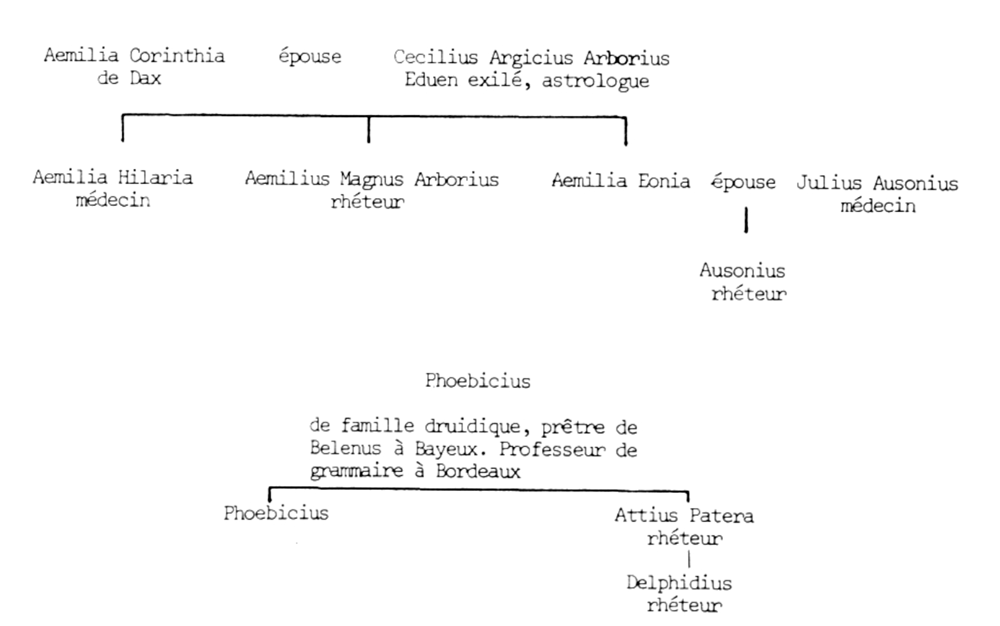
LAISSER UN COMMENTAIRE