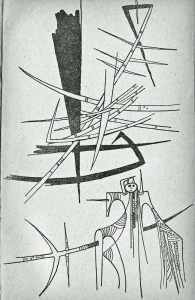 Pierre Mabille. Les loas parlant en govis. Sorcellerie et voyance dans la religion vaudou. Extrait de la revue « Les lettres nouvelles », (Paris), 4e année, n°64, octobre 1958, pp. 409-417.
Pierre Mabille. Les loas parlant en govis. Sorcellerie et voyance dans la religion vaudou. Extrait de la revue « Les lettres nouvelles », (Paris), 4e année, n°64, octobre 1958, pp. 409-417.
Il s’agit probablement de Pierre Mabille, médecin, écrivain et anthropologue (1904-1952), essayiste proche des surréalistes ? auteur de : Le miroir du merveilleux. Préface d’André Breton. Paris, Minuit, 1962. 1 vol. in-8°, 327 p.
[p. 409]
PIERRE MABILLE
LES LOAS PARLANT EN GOVIS
SORCELLERIE ET VOYANCE
DANS LA RELIGION VAUDOU
Un ami, le Docteur Maximilien, m’a proposé hier de m’emmener pour interroger les loas parlant en govis (1). Le problème l’inquiète, il voudrait mon avis. J’ai accepté avec enthousiasme et nous voici en fin d’après-midi, alors que la chaleur commence déjà à s’atténuer, sur la route qui mène à la Croix-aux-Bouquets, petite agglomération au-delà de laquelle habite la mamho (2) que nous allons voir.
Au départ de Port-au-Prince, la première partie de la route est asphaltée ; à notre droite s’étend le camp d’aviation avec son bâtiment neuf, ses signaux électriques, ses employés en uniforme, un camp semblable à ceux que l’on trouve dans tout le continent américain, pour le départ et l’arrivée des grands oiseaux métalliques. A notre gauche, des centaines de petites cases de bois, branlantes, grouillantes d’enfants à demi-nus qui crient, jacassent, vivent là joyeux dans une misère qui n’est tolérable que dans les tropiques et qui, aux abords des capitales européennes, serait une lèpre sordide.
Nous arrivons à la plaine où la route redevient une piste poussiéreuse, chaude, bordée de hauts palmiers dont la brise berce lentement les bras langoureux. Sur les bas-côtés, des files de paysannes et de paysans, comme des fourmis, marchant pieds nus auprès des bourricots croulant sous les chargements les plus hétéroclites ; ils rejoignent leur [p. 410] montagne après avoir vendu, au marché de la ville, leur maigre récolte et acheté quelque morceau de poisson salé et de sucrerie. Les femmes sont vêtues d’une chemise blanche faite le plus souvent dans un vieux sac à farine qui porte encore imprimée la marque de l’usine américaine ; l’étoffe est serrée sur leurs reins souples par une ceinture de ficelle. Elles portent sur leur tête toutes les commissions empilées sur un plateau de bois qui se maintient en équilibre malgré leur marche rapide, ou leurs gambades des plus acrobatiques.
Ces êtres, qui vivent dans les mornes xxx ou au fond de la plaine à plusieurs heures de marche à travers les champs de canne à sucre, sont plus cernés par l’inquiétude, et leur rire se transformera vite en cris angoissés si la fièvre les abat, si l’enfant, dans la case, s’est tordu dans les convulsions pendant la nuit, si cet autre que l’on avait laissé en train de jouer est retrouvé mort sur la natte de feuilles de bananier séchées. Qui prouve d’ailleurs que, lorsque l’on redescendra dans quelques jours, le policier de la ville se contentera des deux gourdes qu’il a exigées aujourd’hui pour laisser vendre le petit sac de café, le tas de mangots, les trois paires de poulets maigres, aux abords du marché ? Peut-être, mal disposé, ou sur la foi de racontars malveillants, frappera-t-il brutalement, anéantissant ainsi l’économie instable du foyer !
J’adore la chaleur si douce de ces fins d’après-midi tropicales ; il semble que l’on ne puisse aller plus loin dans le bonheur physique ; il semble que l’on dépasse la volupté des bains les plus tièdes ; toutes les odeurs âcres, résineuses, sucrées, se mêlent au vert foncé des arbres géants ; et pourtant, on sent la menace si proche ! L’orage et la destruction sont présents, à peine cachés, dans cette béatitude totale. Combien il faudrait peu changer ces grands éclats de rire pour qu’ils deviennent des cris de douleur ou de révolte ! Comme il s’en faut de peu que cette chaleur, si parfaitement agréable, ne tourne à la catastrophe si elle dure trop longtemps, si elle amène la sécheresse qui frappe de mort tout ce qui vit.
Nous sommes habitués, dans nos climats tempérés, à observer des séries favorables et d’autres nettement sinistres au cours desquelles on déplore la maladie des enfants, la [p. 411] perte des emplois, les deuils. Nous avons coutume de dire « un malheur ne vient jamais seul ! » Mais, soit que les climats tempérés soient hostiles aux outrances, soit que les secours sociaux soient mieux établis, il est bien rare que l’équilibre ne se produise entre les événements heureux et malheureux. De plus, la responsabilité personnelle paraît plus directement engagée et l’empire des forces naturelles moins lourd. Ce qui m’a frappé dans la zone tropicale, c’est la rapidité du revirement qui pousse une famille aisée, à laquelle tout réussissait, à la catastrophe Ia plus complète. Dès que, dans une maison, survient une mort ou un procès, il est rare que les choses en restent là et que, dans un délai de quelques semaines ou de quelques mois au plus, le nombre des malheurs ne se soit augmenté au point parfois d’anéantir toute la famille. Ce caractère brusque et implacable se trouve dans chaque élément : c’est la pluie qui tombe en trombe, inondant, ravageant, détruisant, emportant les récoltes et la terre elle-même ; c’est la descente des torrents qui se fait avec une telle brutalité, que l’on voit couramment une maison, un camion, entraînés par leurs eaux. C’est le passage d’un typhon, d’un cyclone, sur une zone très étroite, anéantissant les uns, épargnant les autres. C’est la poussée de fièvre qui se déclenche brusquement et cause la mort d’un être alors qu’il était en parfaite santé.
Cette insécurité, ce danger toujours présent et ‘qui semble électivement dirigé est un des traits les plus frappants de l’atmosphère tropicale, bien faite pour augmenter la peur. Car, en définitive rien ne paraît expliquer la ruine : la routine quotidienne n’a pas été changée. Que peut-il s’être passé ? Si l’on interroge le prêtre blanc, il invoque le péché, le sort de l’humanité ; mais puisque rien n’a varié, pourquoi soudain ce passage de la vie difficile aux drames affreux, et puis, le Dieu dont il se réclame est si grand, si éloigné, — le Dieu de tous les hommes — comment peut-il participer à l’élaboration d’un malheur si particulier et si personnel ? Non, il faut que le danger soit prochain, familier, qu’il vous connaisse, qu’il ait, des intentions directement hostiles. Peut-être qu’au cours de la cérémonie du samedi soir, un loa incarné daignera-t-il parler et apporter l’explication tant attendue. Mais viendra-t-il ? Faut-il attendre la problématique [p. 412] confidence et ne convient-il pas de la forcer en interrogeant le Dieu personnellement ? Mais pas le Dieu de tous les hommes, celui auquel la mambo est vouée, celui auquel elle peut parler directement. « C’est pourquoi on consulte le houngan (3) ou la mambo, témoins des malheurs injustes qui sont survenus, pour connaître l’origine de son infortune. Il s’agit moins d’interroger le surnaturel sur le futur que d’élucider le présent et de savoir à quelle intention correspondent les événements qui s’abattent brusquement sur la tête de ceux qui ne se sentent pas mauvaise conscience. Et voilà pourquoi, ce soir, nous assistons à l’appel des loas en govis.
Les govis, pots de terre assez grossiers, sont placés sur l’autel du Vaudou; ils sont consacrés à un dieu, celui-ci va parler, sa voix partira du vase, comme s’il était contenu à l’intérieur du govi.
Nous nous sommes approchés du houmfort (4), ne dépassant pas le seuil de la porte. La mambo a pénétré près de Fautel, elle est assise sur une chaise basse, elle tient en main l’açon (5) et la clochette (6). Elle, se concentre, récite longuement les prières: langage un Ave, un Pater, puis des prières de Guinée en africain. Elle invoque le dieu qu’elle sert, elle, particulièrement. Elle est ramassée sur elle-même, elle se concentre. C’est alors que l’on entend une voix caverneuse, lointaine, qui s’exprime en créole : c’est la voix du dieu. Il s’annonce, se nomme, salue et la mambo lui dit notre présence; elle lui demande s’il n’a pas un message à nous communiquer.
Le loa qui était survenu était Ogoun Feraille; nous lui posâmes des questions en français, il répondit en créole mais ne se hasarda pas à des prophéties bien précises; il semblait plutôt préoccupé de notre état de santé et des traitements qui étaient convenables pour y remédier car Ogoun, en dehors de ses fonctions de forgeron, est aussi un médecin et, pour peu que nous eussions insisté, il aurait dicté à sa servante, la mambo, une ordonnance complète comprenant, [p. 413] outre l’absorption de plantes, des prières et l’accomplissement de quelques cérémonies.
Ni pour le Dr Maximilien, ni pour moi, il ne peut être question que le dieu parle et nous sommes à l’affût de la supercherie. Nous avions entendu dire qu’une fois ; on avait trouvé un tuyau en caoutchouc passant sous la terre, sous le mur, et faisant communiquer le houmfort avec l’extérieur. Les réponses auraient été faites par un compère qui aurait utilisé, en somme, une sorte de téléphone acoustique semblable aux appareils d’appartements que nous possédions en Europe il y a quelque cinquante ans. Nous avons parlé de cette possibilité à la mambo qui nous a invités à explorer les alentours du houmfort : il n’y avait rien et, pour ma part, je crois même que cette explication a été donnée par des « esprits forts », toujours prompts à émettre des solutions rationnelles.
S’agit-il de ventriloquie ? Nous savons mal en quoi consiste ce phénomène ; il est infiniment probable que celui qui peut le réaliser considère qu’il constitue un pouvoir singulier et de là à penser que la voix intérieure est celle d’une divinité, il n’y a qu’un pas. J’ai assisté, à Paris, au cours de séances spirites, à des possessions qui se traduisaient par le changement de la voix, par la transformation du visage ; ces phénomènes étaient exactement semblables à celui qui se manifestait chez la mambo haïtienne : elle s’était mise dans un état second, s’était tendue nerveusement au point de perdre partiellement connaissance. Elle était arrivée à cette phase si particulière de dissociation dans laquelle le mécanisme conscient et le mécanisme inconscient coexistent, s’expriment sans que la valeur de l’un ou de l’autre soient exactement perçues par le sujet. Il ne s’agit point d’une supercherie organisée mais d’un état où l’opérateur fois simulateur et dupe. Je pense à cette petite est à la fille de sept ans qui, désirant faire peur à sa sœur moins âgée pour la faire tenir tranquille, criait : « Hou ! Voilà le loup ! » au début avec sérieux mais gaieté ; au bout de quatre ou cinq menaces, elle fondait en larmes parce qu’elle s’était prise à son propre piège et qu’elle avait peur, réellement, du loup. Toutes les discussions soulevées par les rationalistes modernes sur la simulation ou la sincérité des spirites, des pythonisses, [p. 414] prouvent à quel point l’esprit rationaliste, logicien, scientiste, qui manie avec lourdeur son principe d’identité est incapable d’appréhende, toutes les subtilités du mécanisme de la simulation et de la vérité. La comédie qu’un homme offre à un autre homme n’a de valeur que si celui qui la donne y croit, bien qu’informé de la technique qui lui permet de jouer.
L’état dans lequel se trouvait la mambo est très exactement comparable à celui dans lequel est l’artiste au moment où il crée, l’acteur pendant son jeu, tous ceux qui se sentent poussés par un mécanisme inconnu qu’ils appellent l’inspiration et qui est ressenti comme une voix, comme une force qui parle en eux, les pousse, les pénètre et les fait se mouvoir à leur insu. Le dieu, en fin de compte, ne nous dit rien de bien intéressant, il se retira et la mambo sortit épuisée de la séance, reprenant assez péniblement conscience d’elle même.
Plusieurs mois après, à Port-au-Prince, j’eus l’occasion de rencontrer longuement une vieille femme qui n’était pas une mambo, qui ne servait pas le Vaudou, mais qui avait le pouvoir de voyance. Elle était assise dans un fauteuil, ses yeux clairs se perdaient au loin et elle annonça à la personne qui m’accompagnait et l’interrogeait des événements qui eurent lieu peu de temps après. Pour moi, ses prévisions furent inexactes car je possède le pouvoir assez singulier de troubler les voyantes au point de les égarer complètement. La supériorité de cette femme sur les extra-lucides professionnelles est semblable à celle d’es artistes réellement inspirés sur ceux qui forcent l’inspiration à coups de technique et d’artifices. Tel encore le jaillissement spontané à côté de l’orientation méthodiquement contrôlée de tous les systèmes religieux quels qu’ils soient. Nous nous associons à la protestation surréaliste contre les religions qui ont étouffé et systématisé ce qui, en l’homme, avait pouvoir de le dépasser ; et cela dans un but d’exploitation bien conscient.
De cette exploitation, j’ai connu un exemple manifeste à Cuba. On nous avait emmenés, au fond de Marianao — un faubourg de la Havane — voir un sorcier qui interrogeait les dieux au moyen de coquillages qu’il jetait à terre autant de fois qu’il était nécessaire pour obtenir des figures et [p. 415] prédire selon les lois mêmes de la géomancie. C’était un nègre de belle prestance, jeune encore ; sa maison, confortable et avenante, eût pu être celle d’un médecin de campagne ; d’ailleurs notre homme s’entendait à établir diagnostic, pronostic et traitement. Je dois dire que, pour une fois, il fut assez brillant en ce qui me concerne, non point qu’il pût localiser ma profession ou la nature de mon déplacement, mais il annonça que, dans le voyage que je devais poursuivre, un papier jaune me manquerait et que cela me mettrait en péril de mort. Il se montra d’ailleurs extrêmement pessimiste dans les explications qu’il donna à la personne qui m’accompagnait et qui me servait d’interprète : il lui indiqua que j’étais dans les plus mauvais termes avec Guemaya, la déesse de la mer, que celle-ci était irritée contre moi et exigeait un sacrifice dont il inscrivit les modalités sur un papier. Il était question de sacrifier une poule et un coq blancs, une poule et un coq noirs, d’apporter plusieurs gâteaux, des bougies, des bouteilles de rhum et d’autres ingrédients dont l’utilisation alimentaire paraissait moins directe. A titre de service, il acceptait, moyennant une vingtaine de dollars, de célébrer ce sacrifice qui, s’il était accepté par la déesse, pouvait m’aider dans mes difficultés présentes. Là, je reconnaissais trop le savoir-faire du praticien avide et tout le parti qu’il prétendait tirer de son pouvoir, pour donner suite à ce projet.
Mon amie Lydia Cabrera, impressionnée par ces inquiétantes prédictions, me proposa de me conduire chez une négresse amie qui était presque centenaire et dont la mère était venue d’Afrique. Nous y allâmes le soir même dans ce quartier proche de la propriété de famille de Lydia ; quartier où la misère, constamment sale, ni triste. Elle n’était balayée par le soleil, n’est jamais pas triste non plus notre chère petite vieille, mais elle était grave. Je n’ai jamais vu autant de noblesse, autant de beauté que dans ce visage. Elle me reçut des mains de sa Lydia qu’elle avait élevée et m’accueil lit en hochant la tête, considérant mon cas avec grand intérêt. « Il me faut pratiquer un laver-tête », dit-elle. Par des manœuvres appropriées, elle devait ainsi retirer de ma tête les forces hostiles qui s’en étaient emparées. Elle me demanda de me déchausser et plaça mes pieds nus dans des [p. 416] récipients remplis d’eau. Les avant-bras découverts, je reçus sur la tête une onction de blanc de baleine et d’huile de palma christie. l,a vieille femme récita des prières, traça des signes sur moi et m’enjoignit de ne pas m’exposer sans chapeau au soleil pendant trois jours, tant que les effets ne seraient pas achevés. S’étant informée de l’heure exacte de mon départ de la Havane, elle se rendit au bord de la mer pour offrir à ce moment précis des fleurs à Guemaya, et apaiser son courroux. Il me faut bien avouer que, à mon entrée au Mexique, on me réclama un papier, qui était pourtant dans mon dossier mais que l’employé de l’émigration disait ne pas avoir reçu, espérant ainsi une récompense substantielle dans le cas où il le « retrouverait ». Il fallut trois semaines de difficultés administratives, et un bon pourboire, pour récupérer ce papier qui était effectivement jaune. Je partis enfin pour Mexico et l’avion qui m’emporta fut à deux doigts de s’écraser sur les pentes abruptes de l’Orizaba haut de quelque quatre mille mètres. La colère de la déesse avait été écartée de peu mais suffisamment pour que notre avion ne heurte pas le pic, masqué jusque-là par un épais nuage.
Ce que demande le fidèle est effectivement un traitement dont la thérapeutique est presque toujours végétale : application de plantes, bains et tisanes, auxquels s’adjoignent des cérémonies de réparation. Le malheur provient, soit de l’action volontaire d’un personnage qui vous poursuit de sa haine et qui a pratiqué ou fait pratiquer un envoûtement, soit de la colère d’un mort auquel on n’a pas rendu les devoirs nécessaires à son repos et qui se trouve ainsi à l’état d’âme errante et affamée, soit enfin à l’irritation d’un dieu dont les rites n’ont pas été célébrés en temps voulu ou avec le faste exigé par lui. La réparation entraîne donc à des cérémonies que le houngan ou la mambo vont célébrer et qui se solderont, comme toujours, par des dépenses considérables : il faudra vendre ou hypothéquer les quelques terres, la maison, pour mettre un terme au courroux surnaturel et pour éviter que la suite des catastrophes ne viennent tout emporter. Les frais de la thérapeutique achèvent souvent, hélas ! de ruiner le malade.
NOTES
(1) Les dieux, parlant du pot de grès dans lequel ils sont enfermés.
(2) Prêtresse vaudou.
(3) Prêtre vaudou.
(4) Case dans laquelle est placé l’autel vaudou.
(5) Sorte de calebasse à manche recouverte d’une résille de vertèbres de serpent et cieperlei;\,et qui sert d’instrument pendant les cérémonies.
(6) Clochette de bronze ou de fer forgé.

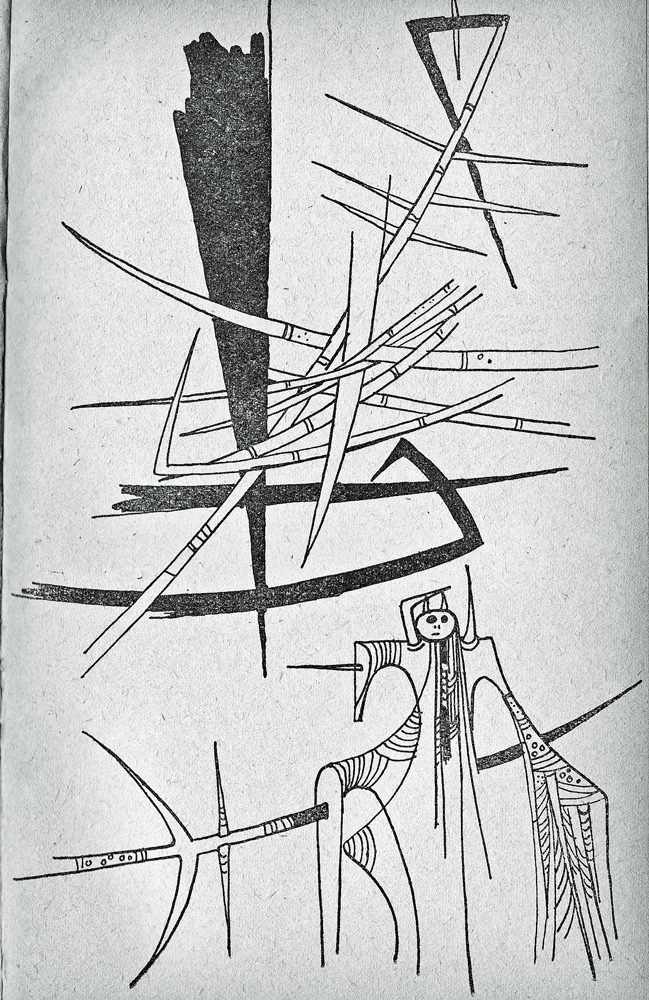
LAISSER UN COMMENTAIRE