 Louis Beirnaert. Freud, la religion et la civilisation. Article paru dans le numéro de la revue « Recherches et débats du centre catholique des intellectuels français » consacré aux « Problèmes de psychanalyse », (Paris), cahier n°21, novembre 1957, pp. 173-183.
Louis Beirnaert. Freud, la religion et la civilisation. Article paru dans le numéro de la revue « Recherches et débats du centre catholique des intellectuels français » consacré aux « Problèmes de psychanalyse », (Paris), cahier n°21, novembre 1957, pp. 173-183.
Louis Beirnaert (1906-1985). Jésuite et psychanalyste. Quelques publications.
— Expérience chrétienne et psychologie. 1964.
— Aux frontières de l’acte analytique : La Bible, Saint Ignace, Fred, Lacan. 1987.
— L’expérience du désir et la naissance du sujet : psychanalyse, éthique et mystique. 1989.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original.– Les notes de bas de page ont été renvoyées en fin d’article. – L’iconographie a été rajoutée par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire original de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 173]
FREUD,
la religion et la civilisation
Il est courant de présenter Freud comme un adversaire du christianisme, et la psychanalyse comme profondément pervertie par cette opposition. Une remarque s’impose dès l’abord : la religion que rejette Freud n’est point celle que nous révèlent les Livres Saints et l’enseignement de l’Église. On pourrait montrer sur textes les transformations qu’a subies l’authentique doctrine judéo-chrétienne dans l’exposé, ou plutôt la reconstruction qu’en donne Freud. Un exemple suffira. A plusieurs reprises, le créateur de la psychanalyse affirme que dans le christianisme, le Fils prend la place du Père. Ceci au mépris des données les plus claires de la foi. C’est donc à une religion déformée que s’applique le refus de Freud, mais cette déformation est son œuvre.
Autre chose est à noter également. On dit et l’on écrit assez généralement que Freud aurait substitué le culte de la science à celui de Dieu. Outre que l’on chercherait vainement une telle valorisation dans l’œuvre de ce penseur qui insistait à chaque instant sur nos incertitudes et sur le peu d’influence de la science sur la conduite des hommes, il apparaît nettement que si Freud a substitué une puissance suprême à Dieu, ce n’est pas la science, mais la Mort. Toute sa conception de la vie en commun des hommes implique que celle-ci est dominée sans recours par la crainte d’une mort qui pèse sur tous et sur chacun de ceux qui entreprendraient de réaliser leur vouloir-être illimité. L’homme civilisé, selon Freud, est un esclave dont le Maître est la Mort.
Ceci est intéressant pour la signification de la psychanalyse. Ce n’est pas, en effet, contre la religion comme telle, mais contre la civilisation avec ses interdits qui s’imposent au sujet humain sous peine de mort, que la psychanalyse entreprend de restaurer le désir individuel d’affirmation de soi, et l’amour, en tant que basé sur la relation fondamentale de l’homme à la femme, et de la femme à l’homme, pour la jouissance réciproque et la procréation. Dans la perspective d’une domination de la vie humaine par la Mort, la psychanalyse apparaît comme la restauration de quelque chose de fondamental, à savoir l’amour sexuel, non seulement dans sa réalité, mais dans son caractère de « prototype de tout bonheur », dans sa Vorbildlichkeit. [p. 174]
Freud qui attribue finalement à la civilisation l’origine des névroses, dit au contraire de la religion qu’elle épargne au sujet la névrose individuelle. Il n’y adhère pas pour autant, car, selon la représentation qu’il s’en fait, elle est fondée sur la restauration imaginaire des figures parentales de l’enfance. Elle ne protège l’individu qu’en le faisant participer à un délire collectif, socialisant, certes, mais maintenant dans l’irréel. Car, quoi qu’il écrive sur la contrainte que la Mort fait peser sur l’histoire de l’humanité, c’est à elle qu’il adhère. Il n’y a pour lui qu’à s’incliner sous l’Ananké, aussi dure que soit sa loi. Toute croyance qui présente l’histoire comme dominée par une Puissance bienveillante qui mènerait les hommes au bonheur est du ressort de l’illusion : extension fantasmatique aux dimensions de l’Histoire, de ce qui se passe pour chacun dans sa petite enfance.
Ainsi Freud oppose-t-il de façon antithétique la croyance religieuse au Père bienveillant, et la soumission réaliste à la domination de la Mort. Pour comprendre comment s’engendre chez lui cette opposition, il faut remonter à l’origine commune de la civilisation et de la religion : le crime primordial, le meurtre du Père primitif.
*
C’est le mythe qui livre un aspect essentiel de la pensée de Freud. Au moment où surgit devant les frères de la horde primitive l’image de la réalisation de leur désir dans le père omnipotent qui possède toutes les femmes, ils sont exclus et bannis de la jouissance par le père plus fort qui les chasse. Ils veulent être « tout », et « tout avoir » comme lui. Mais ils ne pourraient réaliser leurs désirs qu’en risquant la mort dans une lutte sans merci. Ils succombent, ou plutôt sont chassés avant même qu’une lutte ne s’engage. Il est intéressant de noter ici la transformation que Freud fait subir, sans qu’il s’en rende compte, à la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave. Le père, ce pré-humain mû exclusivement par ses désirs, au lieu de réduire en servitude les fils qu’il aurait vaincus dans un combat, et de les lier à lui, les bannit au loin. Les fils à leur tour, au lieu d’apprendre dans le travail servile dont la jouissance leur est dérobée par un autre, leur pouvoir sur la nature qu’ils humanisent, restent eux aussi des pré-humains exclusivement mûs par leurs désirs. Il n’est à attendre de l’exil dans lequel ils sont rassemblés qu’une reconnaissance de leur [p. 175] commune exclusion : de leur qualité d’être « également persécutés par le père ».
Ainsi, à la reconnaissance de l’esclave par le maître qui s’approprie le fruit de son travail, et du maître par l’esclave à qui grâce est faite de la vie, se substitue une reconnaissance purement horizontale en fonction d’un autre dont la puissance est pour les fils purement négative. La différence vient du fait que dans la dialectique freudienne du père de la horde et de ses fils, l’objet de la jouissance n’est pas simplement un objet de la nature qu’il est possible de faire produire par l’esclave, mais l’objet sexuel qui est déjà donné, et dont on ne peut qu’éloigner celui qui veut mettre la main sur lui. Aucun travail servile ne serait ici d’aucune utilité au maître.
Mais parce qu’elle constitue pour eux une situation de privation sous la contrainte, la situation d’égale exclusion de la jouissance sexuelle de la femme entraîne chez les fils une transformation de leur nature sexuelle. Ils s’identifient les uns aux autres, et nouent entre eux, dit Freud, des liens homosexuels par lesquels ce qui, chez le père, sépare, tend chez eux à s’universaliser. C’est alors que, prenant conscience de la force que représente leur union, ils peuvent faire ensemble ce qui était impossible à chacun d’eux : tuer le père.
Ce faisant, ils tuent en fait un animal qui est resté exclusivement mené par son appétit de jouissance immédiate, et sa jalousie féroce de mâle possessif. Freud n’a d’ailleurs pas assez de termes pour caractériser le père de la horde dans sa brutalité et dans son « narcissisme illimité ». Il est également significatif qu’il ait dû passer par l’animal totem pour introduire le père dans sa conception des origines. C’est pourtant ce père qui est à ce moment de leur conscience l’idéal des fils, leur « Vorbild ». Ils réalisent alors leur identification avec lui de la façon même dont se réalise l’identification avec un animal mort : en le mangeant.
Le père est mort ; désormais, tous et chacun veulent être le père et le remplacer. N’est-ce pas justement pour accomplir leur désir d’être tout, et de posséder toutes les femmes, à son image, qu’ils l’ont tué ? Mais voici que quelque chose de nouveau est apparu à leur conscience : la perspective de la mort qui attend celui qui devient semblable au père. C’est alors que pour se garantir réciproquement la vie et exclure pour tous et pour chacun la possibilité du sort qui avait frappé le père, ils s’interdisent de cueillir les fruits de leur acte, renoncent à l’usage des femmes du père, et prohibent l’agression meurtrière. [p. 176] Personne désormais ne sera plus père. La civilisation tout entière a pour fonction d’empêcher que le désir inextinguible que les hommes en ont se réalise jamais en personne. D’où l’inhibition des tendances sexuelles directes pour les transformer en sentiments tendres, destinés à faire échec à l’instinct d’agression, d’où aussi le retournement de ce dernier en agression contre soi-même et en culpabilité.
Arrêtons-nous ici ; la pensée de Freud est claire, il reste à l’interpréter. Que signifie donc pour l’homme civilisé la situation dans laquelle il se trouve depuis qu’il n’y a plus de père ?
Elle n’est pas tellement différente au fond, de la situation des fils également persécutés dans la horde primitive. D’un côté comme de l’autre, « la répression d’instincts » produit ses conséquences humanisantes. D’un côté comme de l’autre cette situation est maintenue par la violence : violence d’un seul contre tous dans la pré-histoire de la horde ; violence de tous contre un seul dans l’histoire de la communauté humaine. Dans une lettre à Einstein sur le problème de la guerre, Freud écrivait : « La violence (de l’individu) peut être brisée par l’union et la puissance de ceux qui, étant unis, représentent maintenant la loi, en contraste avec la violence de l’individu singulier… Le droit est le pouvoir de la communauté. Il est encore violence prête à être dirigée contre tout individu qui lui résiste ; il œuvre par les mêmes méthodes et suit les mêmes buts » (Why war ? Collected Papers, V, p. 275). Si la force de la communauté est pénétrée de droit, c’est qu’elle est reconnue par les hommes comme assurant précisément la vie en commun, ou, plus justement peut-être, la survie en commun. Si la force de tous est ici nécessaire, c’est toujours pour éliminer le père.
Celui-ci, en effet, est toujours restauré en figure par le désir inhérent à chacun de réaliser sa volonté de puissance et son désir de possession exclusive. Le père mort est aussi puissant que lorsqu’il était vivant. Chacun aspire à prendre sa place : n’est-il pas le « Vorbild », le modèle envié ? Mais en même temps tous et chacun sont amenés à le tuer constamment en chacun et en tous, car sa restauration dans la réalité de l’histoire signifierait la mort.
Il s’ensuit que les hommes, après s’être débarrassés une fois du père unique, passent leur temps à se défendre contre le maître possible que représente chacun d’eux pour tous les autres. Leur libération est condamnée à demeurer purement formelle, puisqu’au moment même où elle est sur le point de pouvoir s’actualiser, elle est immédiatement [p. 177] stoppée par la crainte de la mort. D’où le mouvement sans cesse répété : tuer avec tous le père en chacun, pour maintenir la liberté idéale conquise par le meurtre réalisé une fois, et garder la vie immédiate.
D’où aussi dans une sorte de consentement à la fatalité, à ce destin dans lequel Freud a su saisir le visage du père terrible, « Auch das Schicksal ist nur ein spatere Vater-projektion » (Dostoyewski und die Vatertotung, Ges. Werke, XIV, p. 409), le meurtre du père en soi- même : la réalisation de l’identification au père mort. Ainsi la Mort est-elle tout ensemble pour le civilisé selon Freud la fin redoutée et désirée, Le « Vorbild » en vérité qui s’oppose au « Vorbild » imaginaire. Il y a chez Freud une religion de la Mort.
Et dès lors, on pourrait montrer comment, quand il se trouve en présence des choses dernières, Freud fait jouer à la Mort le rôle même du Père. Elle était présente à l’origine de la vie, « le non-vivant est antérieur au vivant », et elle est le but de celle-ci : « la fin vers laquelle tend toute vie est la mort ». Ultime Autorité, elle mène l’homme à sa propre ressemblance, et par là à la libération en vérité. Elle engendre l’humanité à elle-même dans un mouvement qui n’est jamais qu’un retour à l’état antérieur. La véritable identification au père, c’est la mort qui l’accomplit.
Conception dure, et terrible pour le vouloir-être de l’homme, mais Freud ne pense pas que les désirs de l’homme soient susceptibles d’un accomplissement. Toute sa critique de la religion le manifeste clairement. A l’étudier maintenant nous verrons se déployer devant nous l’autre panneau du diptyque freudien concernant les conceptions du monde.
Menorah, chandelier à sept branches
*
La religion a la même origine que la civilisation. Mais elle dérive d’une autre source. Une fois le meurtre accompli et l’agressivité exercée, l’amour pour le père ressurgit chez les frères dans le remords. La nostalgie du père (Vaterseilllsucht), et le désir de renier leur acte, les amène à restaurer la figure du père sous des formes qui culminent finalement dans le Dieu unique de la tradition judéo-chrétienne. Par une « obéissance rétrospective », ils se soumettent maintenant à la volonté qu’ils avaient offensée, escomptant que par là leur Père continuera à leur dispenser la protection et les biens qu’il leur assurait jadis. Par toutes sortes d’exercices et de rites ils cherchent la réconciliation avec le Père. C’est dans la doctrine chrétienne, telle notamment [p. 17] qu’elle est présentée par saint Paul, que s’exprimerait le plus clairement le sens de la religion : l’offense envers le Père y est reconnue, et la réconciliation procurée par le sacrifice d’un seul au nom de tous.
C’est là, dit Freud une formation réactionnelle à jamais inachevable, car fondée sur l’ambivalence envers le père, à la fois haï et aimé, elle ne résout pas l’ambivalence : jusque dans la représentation chrétienne celle-ci se réalise dans le remplacement du Père par le Fils. C’est également une formation délirante, dans la mesure où elle méconnaît la réalité qui déçoit nécessairement les désirs, et lui substitue une Providence chargée d’assurer la réalisation de ceux-ci, à la manière même dont les parents veillaient dans la petite enfance sur la satisfaction des besoins de l’être démuni.
Ce bref rappel de la conception freudienne des origines de la religion suffit pour mettre en branle la réflexion.
La question qui se pose est la suivante : d’où vient donc l’amour pour le père ? La représentation que nous a donnée Freud du père primitif n’en rend absolument pas raison. Autant le meurtre a sa signification dans la rivalité cruelle qui oppose l’oppresseur à l’opprimé, autant le regret du meurtre est inintelligible. Freud s’étonne d’ailleurs lui-même que l’homme puisse se sentir coupable « d’un crime dont il devrait être si fier ». Le père, tel que le présente Freud dans la pré-histoire de la civilisation n’a rien pour être aimé. Tout indique par conséquent que nous nous trouvons ici devant une représentation dont l’origine est à chercher. Si le père au narcissisme illimité de la horde ne peut justifier l’amour qu’on lui porte, c’est que le père dont on regrette la mort est un autre père. Sa figure dérive d’une autre source que celle du premier.
D’où pourrait donc venir à l’homme la représentation d’un père à la fois aimé et redouté, auquel on obéit, dont on veut se concilier les bonnes grâces, sinon justement de la famille elle-même ; Freud nous donne ici l’image d’un père de famille qui reconnaît ses fils pour siens, et que ses fils reconnaissent pour leur père.
Un tel père impose sans doute la loi à l’enfant ; il récompense et punit. Mais il est bienveillant, dispense ses bienfaits pour la croissance de ses fils, et les aime. Freud a reconnu cet amour paternel : « La force irrésistible de la famille comme formation collective naturelle, écrit-il, vient précisément de cette croyance, justifiée par les faits, en un amour égal du père pour les enfants» (Psychologie collective et analyse du [p. 179] moi, Essais de psychanalyse, p. 140). C’est à partir d’une telle expérience qu’il est possible de comprendre un amour quelconque des fils pour le père. Le père de la horde n’est donc pas tout le père.
Il n’en est que plus remarquable que Freud considère l’universalisation des relations fils-père, nées dans la famille, aux dimensions du groupe social, comme « une transformation idéaliste des conditions existant dans la horde primitive, dans laquelle tous les fils se savent également persécutés par le père qui leur inspire à tous la même crainte » (ibid.). Cette transformation, c’est dans la religion juive qu’il la présente. En l’opérant, après le forfait qui les a libérés, les fils, au lieu d’accepter leur condition d’hommes adultes et désormais sans recours, se souviennent des jours passés, et restaurent en image le père d’antan. Ce faisant ils se dérobent à la reconnaissance de la maîtrise de la Mort.
Nous voici donc devant deux solutions antithétiques du problème que pose à l’homme son vouloir-être. Ou bien accepter la domination de la Mort et se soumettre à la loi qui inhibe les instincts ; ou bien nier cette domination, et restaurer la figure d’un Père bienveillant qui veillerait à la réalisation de ces mêmes désirs. Cette dernière solution est imaginaire ; nous pensons que la première ne l’est pas moins, bien qu’en un autre sens. Mais nous pensons surtout, avec Freud lui-même, que ni l’une ni l’autre n’est capable de fonder l’existence humaine (1).
La solution religieuse telle que la présente Freud est, à tout le moins, le signe que la mort de l’Autre n’a rien résolu. Elle témoigne, à sa manière, non seulement de l’inutilité, mais même de la nocivité du méfait. Le fait même que Freud parle à son sujet de névrose universelle, indique bien qu’elle recouvre un problème non résolu, un conflit toujours actuel : celui entre l’amour et la haine. Là, en effet, où l’Autre apparaît toujours comme puissance qui revendique pour lui-même souveraineté et usage exclusif, ct où le fils est encore esclave, la révolte alterne avec l’amour. Or tel est bien le cas sous la loi juive : « Aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien de l’esclave, quoiqu’il soit le maître de tout ; mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps marqué par le père. Nous aussi [p. 180] de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions en esclavage sous les rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d’une femme, etc… » (Gal. IV, I-4)· La différence ici entre saint Paul et Freud, c’est que le premier voit la condition judaïque à partir du Christ, et que dans l’esclave il saisit l’héritier à venir qui est déjà « le maître de tout », c’est aussi que le Père se montre précisément tel dans la libération apportée par son Fils ; tandis que le second voit la condition judaïque à partir de la Mort, et que dans le fils il saisit l’esclave du maître, qui ne veut pas se révolter, ou plutôt qui tente constamment de nier sa révolte. Nous verrons que là est la discrimination entre la religion vue par Freud comme névrose universelle, et la religion de Paul.
Névrose universelle, mais épargnant à l’individu une névrose individuelle, telle est la religion selon Freud. Vérité universelle, mais engendrant la névrose individuelle, tel est l’esclavage sous la domination de la Mort. Ici encore, la mort de l’Autre n’a pas résolu le problème de l’être. La névrose de l’individu témoigne, elle aussi, du conflit toujours actuel entre la révolte et la soumission au cœur de chacun. Mais la méconnaissance ne porte pas sur le même point dans les deux cas. Si la religion, qui met en avant l’amour, méconnaît les instincts d’agression liés au moi, la civilisation méconnaît de son côté la sexualité, et les instincts de vie. Il est vraisemblable qu’une étude approfondie du sens de ces oppositions terme à terme, et de cette complémentarité dans les conflits permettrait de jeter un peu de lumière sur la signification profonde de l’œuvre de Freud. Contentons-nous de remarquer les problèmes dialectiquement liés auxquels aboutissent, de l’aveu même de Freud, la solution religieuse infantile, et la soumission aux impératifs catégoriques de la civilisation dominée par la Mort.
Ainsi la psychanalyse apparaît-elle bien, comme nous le disions dès la première page, comme une entreprise de redécouverte. En s’attachant à restaurer chez le sujet sa capacité d’aimer sexuellement, elle arrache à la domination de la Mort quelque chose d’essentiel, non seulement à la vie et au bonheur de l’individu, mais aussi à la réalisation de la communauté humaine, pour laquelle les relations d’amour entre homme et femme, père, mère et enfants ont valeur de modèle.
La question se pose alors de savoir pourquoi Freud n’a pas achevé le mouvement qu’il contribue à inaugurer. Car il ne peut le mener à [p. 181] son terme, tant qu’il reste dominé par sa vision de la civilisation. L’homme est partagé entre sa recherche du bonheur individuel dans l’amour et la famille, et les impératifs d’une civilisation qui se nourrit, de la répression des tendances sexuelles. Il n’est pas un. Bien plus il n’a pas de principe d’unité, en ce sens qu’on ne voit pas ce qui chez lui pourrait dépasser l’opposition des termes de l’antinomie, et promouvoir une synthèse progressive. D’où le rabattement du conflit, qui doit permettre à l’homme nouveau de naître, sur le plan biologique, voire quantitatif, d’un problème « d’économie libidinale individuelle », d’une répartition convenable de « l’énergie libidinale » entre la poursuite des buts directs de l’amour sexuel, et la soumission aux contraintes de la civilisation. Le problème du « répartiteur » se pose, et sa solution oscille chez Freud entre l’appel à la biologie et à la constitution, et l’appel au mystère même du sujet, en tant qu’il domine les termes de l’antinomie.
D’où vient ce manque dans la pensée freudienne ? De la séparation dans laquelle elle maintient finalement le mouvement de l’« amour qui fonda la famille », et le mouvement de l’agressivité qui fonde la société humaine sur la relation maître-esclave issue de la lutte à mort. Le seul groupe qui, pour Freud, inaugure l’interaction des deux mouvements est le groupe familial. Dans la famille, en effet, l’amour des époux qui engendrent les enfants est à la base d’une reconnaissance réciproque de l’homme par 1a femme, et des enfants par leurs parents. Reconnaissance qui pénètre de plus en plus la relation maître-esclave qui assure la domination de l’homme sur la femme, et des parents sur les enfants, tandis qu’inversement la domination du maître sur l’esclave arrache peu à peu l’amour à la poursuite de la satisfaction immédiate, et l’oriente progressivement vers la poursuite de valeurs universalisables (2).
Mais ce qui se passe au sen de la famille, et s’y réengendre sans cesse, ne peut, pour Freud devenir à la fois universel et réel au sein de l’humanité. A la frontière du familial et du social, la barrière est fermée. Tout l’amour dans la fonction positive et promotrice d’être pour chacun et pour tous reste d’un côté, et toute l’agressivité en tant que fondant un rapport universalisant sous l’égide de la mort passe de [p. 182] l’autre. De sorte que, considéré par rapport à la famille dont il vient, et à celle qu’il va fonder, l’homme inaugure un accomplissement, mais que, considéré par rapport à la société dans laquelle il entre comme membre égal aux autres, il n’est qu’un esclave de la mort, de la loi, et de la culpabilité, et ceci sans recours.
Il aurait suffi à Freud de pousser à la limite l’interaction de la reconnaissance d’amour inaugurée dans la sexualité procréatrice et la relation maître-esclave inaugurée dans la lutte à mort des « moi », pour aboutir à ce point où dans l’amour, le maître renonce lui-même à sa volonté de puissance, « non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo », et se fait librement esclave « exinanivit semetipsum, formamservi accipiens », et se soumet librement à la mort « factus obediens usque ad mortem », manifestant ainsi dans la Mort, non point le maître universel, mais le vaincu, dépouillé de sa puissance : « et mors ultra non dominabitur ». La doctrine paulinienne résout le problème posé par Freud. Le juif devenu chrétien répond au juif infidèle en le délivrant de ses chaînes.
Parler ici de l’infidélité de Freud et de son judaïsme, c’est s’introduire au cœur même de sa position. On pourrait montrer qu’elle revient à donner une solution grecque à un problème que seul un homme nourri de la Bible — comme il le fut, de son propre aveu — et dans la situation d’un juif minoritaire au sein d’un monde chrétien, pouvait se poser. Par qui les frères sont-ils finalement également persécutés, sinon par la majorité chrétienne « compacte » que le jeune Freud rencontra dans son enfance et sa jeunesse, notamment à l’université de Vienne ? Il semble bien que c’est à travers cela que Freud appréhenda le christianisme. Jamais il ne parvint à le dégager d’une condition de fait. D’où sa révolte constante, et aussi sa soumission. C’est au retour de Rome en 1901, qu’il apprend que « le vieux monde est régi par l’Autorité comme le nouveau par le Dollar », et qu’il fait ses « courbettes » à ceux qui détenaient le pouvoir et les places. Il faut bien vivre et faire son œuvre. Freud s’est laissé piper par le visage humain, trop humain d’une religion établie qui participe à la fois de la pensée magique, et de la domination des possédants. Il a méconnu le christianisme authentique, et est retombé lui-même sous la domination de la Mort, de la Loi, et de la culpabilité. Juif, par conséquent, mais juif infidèle qui fait de ces Puissances non des pédagogues au service de la libération, mais des serviteurs de l’Ananké grecque.
Le psychanalyste selon Freud est celui qui se bat contre cela, pour [p. 183] qu’au moins dans l’individu et dans la cellule familiale, l’amour humain existe, pour que là, au moins, Éros dans son mouvement qui tend à unir tous les hommes soit vainqueur.
Mais le « moment » analytique ne peut s’isoler et s’ériger en absolu sans constituer un paganisme. C’est uniquement du conflit entre le gentil retrouvé et le juif encore esclave que peut naître l’Homme nouveau, comme celui qui les réconcilie. C’est pour avoir toujours maintenu le conflit ouvert que Freud n’est pas le païen que l’on présente souvent, mais l’homme déchiré et tragique dont certains accents sonnent à l’égal des plaintes de Job.
Louis Beirnaert
NOTES
(1) Précisons que nous parlons ici de la solution religieuse que Freud la présente, et telle peut-être qu’elle est vécue à un certain niveau par certains croyant, mais nullement de la solution chrétienne telle qu’elle est présentée par L’Écriture et par l’Église.
(2) Cf. G. FESSARD. Le mystère de la Société. Recherche de Science religieuse, janvier et avril 1948.



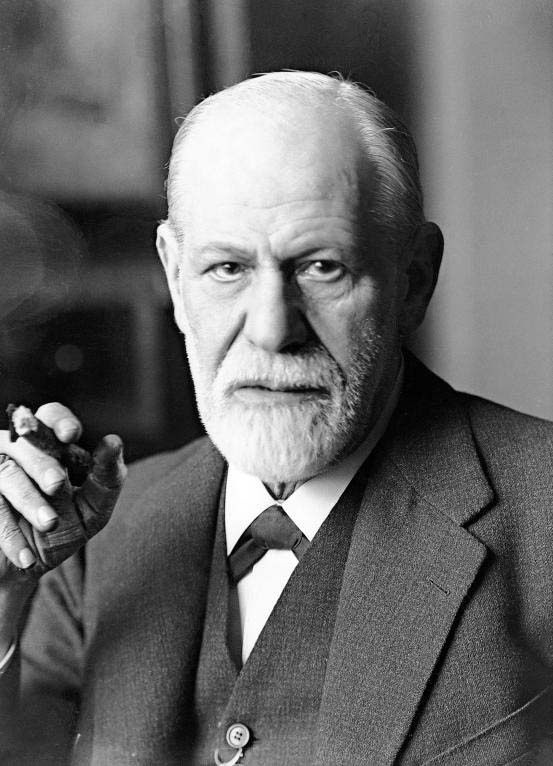
Interesante
ဟ တ တယ အမ မၿင မ ရ …ဓ လ ထ စ တ ရ ႕ လ မ မ မ က မ လ န လ တယ အ မ မ လည လ လ ဆယ တ အ ဒ WHY တ ပ ဆ ည နတ ပ ပ 🙂 မ ဘန ႔ သ သမ ၾက က မ တတ ဆ မ တ က လ က ရ က ဖ ႔ မ ဘက ပ ၿပ ႀက စ ရမ ပ ပ အမ ရ႕… C’est la vie ပ ပ … န န ၵ …ဆ တ င အတ က က ဇ ပ ပ ဗ န က တခ ဂ န ဗ ရ က တ အခ အခ န ရရင Lausanne ဖက က ပ လ လည လ ဂ န ဗ ထက ပ လ တယ :)မခင ဥ မ … က ဇ တင ပ တယ အမ ရ.. မ င မ …က န တ ႔လည အမ နည တ နထ င ဖ ႔ သင ၾက သင ၾက ဖ ႔ နထ င ပ ပ စ လ ဖ ယ က င လ တ ဆ တ င လ အတ က က ဇ ပ ပ ဗ ဟ တ တယ က ဖ အ င ရ …တခ တခ အမ နည တ ဝင ဆ ခ င ပမယ ဘ မ လ ႔ မ ရမ န တ င မသ တ အ ဖစ က အ တ ဆ တယ လ ႔ ပ ရမ ပ 🙂 Stupid question ဆ တ မ႐ ဘ မ႐ င တ မ န သမ မ သ မ လ ႔ ဖ င ပ တ ဆရ မ န ႔ တ ႔ရင သ ပ မရ တ က င သ တ အတ က လည အဆင ပပ တယ