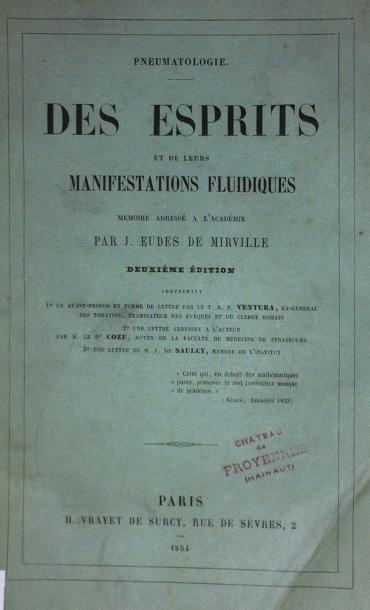 Eudes de Mirville. Névropathies mystérieuses ou l’homme possédé par les esprits. Extrait de la « Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations fluidiques, devant la science moderne. Mémoire adressé à l’Académie… Quatrième édition », Paris, H. Vrayet de Surcy, 1858, Chapitre V. pp. 124-204
Eudes de Mirville. Névropathies mystérieuses ou l’homme possédé par les esprits. Extrait de la « Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations fluidiques, devant la science moderne. Mémoire adressé à l’Académie… Quatrième édition », Paris, H. Vrayet de Surcy, 1858, Chapitre V. pp. 124-204
Etudes de Mireille [Charles, Jules Eudes de Watteville de Mirville] (1802-1873). Le marquis de Mireille était médium, illuminisme, mais aussi un écrivain érudit. Il a beaucoup écrit sur le spiritisme.
— Le peuple ramené à la foi par des raisons et des exemples, Paris, 1841.
— Le peuple et les savants du XIXe siècleu en matière de religion, Paris, 1845.
— Pneumologie. Des esprits et de leurs manifestations fluidiques, devant la science moderne. Mémoires adressés au Académies… Paris, H. Vrayet de Surcy, 1863-1868. 6 vol. in-8.
— Question des esprits, ses progrès dans la science, examen de faits nouveaux & de publications importantes sur les tables, les esprits…, Paris, 1855.
— Des esprits. De l’Esprit saint et du miracle dans les six premiers et les six derniers siècles de notre ère, spécialement des résurrections des morts, des exorcismes, apparitions, transports, etc., Paris, 1863.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr
[p. 124]
NÉVROPATHIES (1) MYSTÉRIEUSES
ou
L’HOMME POSSÉDÉ PAR LES ESPRITS
Les anciens possédés retrouvés par le XIXe siècle et l’aimantation rotatoire observée depuis longtemps. — Le moyen âge justifié à l’Institut. — La complète bonne foi des Ursuline de Loudun, des trembleurs des Cévennes, et des convulsionnaires de Saint-Médard, proclamée et mise hors de toute discussion par l’élite de la science moderne. — Longs mensonges historiques réduits à néant. — Analyse et discussions. — Nouvelles hypothèses proposées par une science à bout de voie, et bien autrement inadmissibles que le merveilleux dont elle a peur.
Les magnétiseurs répétaient depuis longtemps aux savants : « Regardez-y donc de plus près, et vous trouverez une partie de nos phénomènes classés parmi les vôtres. » Les voilà justifiés, puisque des hommes d’un grand mérite, après avoir regardé de plus près, viennent de reconnaître et même de proclamer la justesse de l’avis donné. Vous les avez entendus, Messieurs : selon eux, l’analogie est frappante entre certains phénomènes magnétiques et leurs plus mystérieuses hallucinations. Il y a donc là plus d’un sujet de triomphe pour les disciples de Mesmer, car s’il est assez peu flatteur d’être classé si près du délire et de la folie, il ne faut pas oublier non plus que [p. 125]
les rêveries de Socrate, de Jeanne d’Arc et de la plupart des hommes célèbres, se trouvant comprises dans le même cadre, une telle solidarité tient lieu de circonstance atténuantes, et laisse aux condamnés plus d’une consolation.
A présent voici tout autre chose ! Nous allons aborder une série de phénomènes bien autrement sérieux. La science va s’assombrir ; le côté terrible et vraiment satanique de nos fascinations spirituelles va se dessiner largement, et, repassant notre histoire, nous allons contempler l’Europe se débattant pendant de longues années sous les cruelles étreintes d’un fléau aussi mystérieux que redoutable.
Et ce fléau, vous allez entendre notre imprudent magnétisme le réclamer comme son œuvre et s’écrier encore une fois : « C’était moi, c’était moi-même. » Quel paradoxe, ou quelle témérité !
Nous savions bien que tous les ennemis du mesmérisme avaient pris à tâche de le rattacher à ces grandes épidémies, effroi des siècles précédents, et notamment aux possessions de Loudun, aux terribles Camisades, aux convulsions de Saint-Médard ; de la part d’adversaires cela nous paraissait fort logique, et nous disions : « Après tout, c’est probablement une calomnie. »
Ainsi, M. le docteur Dubois (d’Amiens), imitant en cela le célèbre Thouret, avait eu le plus grand soin de faire précéder son histoire magnétique d’une dissertation sur ces derniers phénomènes de Saint-Médard et de Loudun.
Le docteur Calmeil, nous allons le voir, passe à chaque instant des derniers aux premiers, pour tâcher de les éclairer tous ensemble et les uns par les autres.
Presque tous les manigraphes modernes suivent le même ordre et soutiennent l’identité.
Le Rév. Père de Breyne en fait autant. M. l’abbé Migne, dans un ouvrage tout récent (Dict. des Miracles), met sur la même ligne toutes ces jongleries.
Mais des magnétiseurs ! qui donc aurait pu s’en douter ? [p. 126] Connaissent-ils bien ce qu’ils réclament et toute la responsabilité qu’ils assument !
Le docteur Bertrand, par exemple, voit dans toutes les grandes épidémies d’extase précitées, la solution de tout le somnambulisme moderne (De l’Ext.).
Le docteur Teste dit que « cette identité ne peut plus aujourd’hui faire l’ombre d’un seul doute » (Magn. expliqué).
Le baron Du Potet est bien plus explicite encore : « Ce que nous ont enseigné les Mesmer, les Puységur et les Deleuze, est certainement, sous d’autres noms, ce que les Écritures condamnent et ce que les anciens prêtres de notre religion poursuivaient sans miséricorde et sans pitié. » (Journal du Magn., IX, p. 27.)
Enfin, le sage et modeste Deleuze, si bien fait pour ramener tant d’ennemis à sa cause, ne peut se dispenser de parler comme ceux-ci : « La comparaison des effets magnétiques, dit-il (Hist. crit., t. l, p. 32), avec ceux qui avaient eu lieu, quarante ans auparavant, sur le tombeau du diacre Pâris était encore un rapprochement fâcheux pour le magnétisme… Je suis loin de nier la vérité de ce rapprochement… Au tombeau de Pâris, le magnétisme agissait de même qu’au baquet de Mesmer… »
Il dit encore ailleurs : « La comparaison exacte de toutes les circonstances de Saint-Médard et de l’acte magnétique, montre l’identité de l’agent. » (Ibid., t. Il, p. 320.)
L’identité ! Nous eussions dit, nous, l’analogie, et encore peut-être l’eussions-nous restreinte au mode d’importation et d’action.
Mais vous allez en juger, Messieurs, et lorsque vous aurez prononcé, les magnétiseurs s’entendront, s’ils le peuvent, avec vous. C’est leur affaire et non la nôtre aujourd’hui.
Nous sommes préoccupé d’un soin bien autrement grave, celui d’établir tout à l’heure, ou plutôt de laisser s’établir toute seule, la justification complète, absolue, de nos croyances catholiques les plus délicates et les plus sacrifiées en apparence.
Le comte de Montalembert remerciait dernièrement tous [p. 127] les écrivains catholiques qui avaient travaillé dans ces derniers temps à la restauration de la vérité historique, philosophique et sociale, et il ajoutait : « Chaque jour nous ramène à une appréciation plus vraie de ces grands siècles où l’Église était tout ; de ces grands siècles si longtemps oubliés ou insultés par la plupart des écrivains religieux » (2).
Sans vouloir plus que lui ressusciter le moyen âge, nous prétendons le justifier aujourd’hui de l’accusation la plus grave qu’on ait jamais portée contre lui, celle d’avoir, par ignorance, fait périr des milliers d’innocents.
Connaissez-vous en effet un reproche plus fréquent et plus sanglant que celui qu’on adresse depuis deux siècles à l’Église, à propos des sortilèges, des possessions et des exorcismes ?
Eh bien ! nous venons répondre à ce reproche aujourd’hui. La réponse sera péremptoire, absolue, et cette fois ce ne seront plus des ignorants, des enthousiastes ou des enfants perdus, qui vous la fourniront, Messieurs, ce seront vos plus honorables collègues, vos pairs, et vous ne pourrez plus vous révolter devant quelques bluettes magnétiques, lorsque vous entendrez ces graves autorités accepter et discuter les énormités qui vont suivre.
Pour ne pas trop abuser de vos moments, ni grossir mal à propos le nombre de nos adversaires, nous allons prendre à partie le premier de tous nos manigraphes actuels, M. le docteur Calmeil, médecin des aliénés de Charenton, l’un de ces hommes que leur position et leur talent entourent de toute la considération voulue pour que l’on puisse hardiment s’abriter derrière eux. Après les études sérieuses, les recherches infatigables auxquelles il a consacré sa vie, qui donc oserait s’inscrire en faux contre ses affirmations historiques ? Personne assurément.
Pour nous, il sera donc le représentant de toute cette nouvelle école, que l’on pourrait appeler l’école vengeresse du [p. 128] passé, car vous avez déjà vu, Messieurs, que les docteurs Brierre de Boismont, Leuret, Lélut, Michéa, Moreau, etc., sont d’accord avec lui pour restituer, sinon la raison, au moins la probité, à toute une masse de victimes calomniées par l’histoire.
On en conviendra, n’eussions-nous d’autre but aujourd’hui que de compléter de telles réhabilitations historiques, et de faire comprendre un peu mieux tout ce génie du moyen âge, si misérablement travesti, notre travail ne manquerait encore, il nous semble, ni d’actualité ni d’une assez grande importance. Mais nos prétentions sont plus hautes : nous espérons qu’après avoir rétabli la vérité dans tous ses détails, un large pas aura été fait dans les voies de la fusion scientifique et religieuse, puisqu’il va rester démontré que, sous des noms différents, on s’occupe, tous les jours encore, des mêmes choses, et que l’on combat le même ennemi.
Ouvrons donc hardiment le bel ouvrage de notre docteur sur la folie (2), mais, avant d’aborder le chapitre de ces grandes épidémies de délire, que nous appelons, nous, des épidémies et des intoxications (3) spirituelles, choisissons, entre mille, un exemple et une preuve modèles de ce que nous venons d’énoncer.
Le voici :
Veuillez, Messieurs, prêter toute votre attention au récit qui va suivre, surtout à sa ratification par le docteur Calmeil, et à l’explication qu’il en propose. Si, contrairement à toutes nos habitudes, nous citons ce fait à peu près en entier, c’est que ce développement nous parait absolument nécessaire, les détails seuls pouvant bien préciser la question. Nous n’en connaissons pas de mieux posée, car si la folie est là, sans complication et purement naturelle, nous nous tenons immédiatement [p. 129] pour battu, et nous vous prions de jeter au feu à l’instant même tout le fatras que nous allions vous présenter.
« Aujourd’hui, dit M. Calmeil (t. II, p. 417), les ecclésiastiques qui font la traversée des mers pour aller répandre les lumières de la foi jusque dans les déserts du Nouveau Monde sont souvent tout surpris de rencontrer des énergumènes parmi les néophytes dont se compose leur nouveau troupeau, tandis qu’il est rare, de leur propre aveu, que le démon prenne à présent possession des fidèles au sein de la mère patrie. La lettre que je vais rapporter, et qui fut adressée à Winslow (célèbre médecin) en 1738, par un digne missionnaire, prouve que le délire de la démonopathie peut devenir partout le partage des âmes faibles et timorées.
« Je ne puis enfin me refuser à votre empressement, écrit le missionnaire Lacour, d’avoir par écrit le détail de ce qui s’est passé au sujet du Cochinchinois possédé, dont j’ai eu l’honneur de vous parler… L’an 1733, environ au mois de mai ou de juin, étant dans la province de Cham, royaume de Cochinchine, dans l’église d’un bourg qu’on nomme Chéta, distant d’une demi-lieue environ de la capitale de la province, on m’amena un jeune homme de 18 à 19 ans, chrétien … Ses parents me dirent qu’il était possédé du démon … Un peu incrédule, je pourrais même dire, à ma confusion, trop pour lors, à cause de mon peu d’expérience dans ces sortes de choses, dont je n’avais jamais eu d’exemple et dont néanmoins j’entendais souvent parler aux chrétiens, je les questionnai pour savoir s’il n’y aurait pas de la simplicité ou de la malice dans le fait. Voici ce qu’ils me dirent… »
Ici vient le récit des parents, dont voici la substance en deux mots : Le jeune homme, après avoir fait une communion indigne, avait disparu du village, s’était retiré dans les montagnes, et ne s’appelait plus lui-même que le traître Judas.
« Sur cet exposé et après quelques difficultés, reprend le missionnaire, je me transportai dans l’hôpital où était ce jeune homme, bien résolu de ne rien croire à moins que je ne [p. 130] visse des marques au-dessus de la nature, et, au premier abord, je l’interrogeai en latin dont je savais qu’il ne pouvait avoir aucune teinture. Étendu qu’il était à terre, bavant extraordinairement, et s’agitant avec force, il se leva aussitôt sur son séant et me répondit très-distinctement : Ego nescio loqui latinè (4). Ma surprise fut si grande que, tout troublé, je me retirai épouvanté, sans avoir le courage de l’interroger davantage.
« ….. Toutefois quelques jours après je recommençai par de nouveaux commandements probatoires, observant toujours de lui parler latin, que le jeune homme ignorait ; et entre autres ayant commandé au démon de le jeter par terre sur-lechamp, je fus obéi dans le moment ; mais il le renversa avec une si grande violence, tous ses membres tendus et roides comme une barre, qu’on aurait cru, par le bruit, que c’était plutôt une poutre qu’un homme qui tombait… Lassé, fatigué de sa longue résistance, je pris la résolution de faire un dernier effort ; ce fut d’imiter l’exemple de Mgr l’évêque de Titopolis en semblable occasion. Je m’avisai donc, dans un exorcisme, de commander au démon, en latin, de le transporter au plancher de l’église, les pieds les premiers et la tête en bas. Aussitôt son corps devint roide, et, comme s’il eût été impotent de tous ses membres, il fut traîné du milieu de l’église à une colonne, et là (écoutez bien, Messieurs), les pieds joints, le dos collé à la colonne, sans s’aider de ses mains, il fut transporté en un clin d’œil au plancher, comme un poids qui serait attiré d’en haut avec vitesse sans qu’il parût qu’il agit. Suspendu au plancher, les pieds collés et la tête en bas (vous acceptez le fait, M. Calmeil ?…), je fis avouer au démon, comme je me l’étais proposé pour le confondre, l’humilier et l’obliger à quitter prise, la fausseté de la religion païenne. Je lui fis confesser qu’il était un trompeur, et en même temps je l’obligeai d’avouer la sainteté de notre religion. Je le tins plus d’une demi- [p. 131] heure en l’air (la tête en bas et les pieds collés au plafond), et n’ayant pas eu assez de constance pour l’y tenir plus longtemps, tant j’étais effrayé moi-même de ce que je voyais, je lui ordonnai de le rendre à mes pieds sans lui faire de mai… Il me le rejeta sur-le-champ comme un paquet de linge sale sans l’incommoder, et depuis ce jour-là mon énergumène, quoique pas entièrement délivré, fut beaucoup soulagé ; chaque jour ses vexations diminuaient, mais surtout lorsque j’étais à la maison, il paraissait si raisonnable qu’on l’aurait cru entièrement libre… Il resta l’espace environ de cinq mois dans mon église, et au bout de ce temps il se trouva enfin délivré, et c’est aujourd’hui le meilleur chrétien peut-être qu’il y ait à la Cochinchine. »
Qu’en dites-vous, Messieurs ? Le fait vous parait-il assez curieux ! Au point de vue du christianisme, c’est un de ces prodiges dont abondent les récits évangéliques et les annales de l’Eglise ; mais, au point de vue médical, écoutez bien la conclusion toute naturelle que l’on en tire :
« On doit savoir gré au frère Delacourt, dit M. Calmeil, de n’avoir pas gardé le silence sur ce prétendu fait de possession, car ce missionnaire a décrit à son insu les phénomènes de la monomanie religieuse ; et il est clair pour tout le monde aujourd’hui qu’il n’a exorcisé qu’un homme atteint de délire… Espérons qu’une méprise pareille ne sera plus commise par les ecclésiastiques qui se vouent aux missions (5). »
Vous l’entendez, Messieurs ; le docteur Calmeil est obligé d’admettre un tel fait, d’abord parce que l’autorité du narrateur lui parait irréfragable, ensuite parce que ce n’est qu’un fait de plus à ajouter à mille autres du même genre. Mais ce qu’il faut bien constater, c’est que lorsqu’on se trouve atteint de ce certain délire (délire sans fièvre, et qui vous laisse après des années parfaitement frais et dispos), lorsqu’on a, disons nous, ce certain délire, il n’y a rien de plus naturel que de [p. 132] répondre pendant des mois en latin lorsqu’on n’en sait pas le premier mot ; que de grimper jusqu’au plafond d’une église, les pieds joints, le dos contre la colonne et sans s’aider de ses mains; d’y rester suspendu par la simple application des pieds et la tête en bas; de faire pendant une demi-heure de la controverse dans cette position peu commode, et d’être enfin rejeté sans la moindre blessure de ce plafond sur le pavé, et parfaite ment guéri plus tard par le seul nom de Jésus-Christ.
Quel délire, quel traitement… et quelle méprise !
Mais nous vous comprenons, Messieurs, vous n’acceptez pas, vous, un tel fait ; vous n’appelez pas cela une névropathie, vous l’appelez un conte bleu. Soit ; ce n’est pas contre vous que nous argumentons. Seulement, nous vous avons prévenus que, pour rejeter les éléments du procès, vous seriez obligés de vous brouiller avec l’élite de la science, et nous vous avons tenu parole, car ce n’est pas là, notez-le bien encore une fois, une historiette isolée, une distraction de professeur ; non, c’est un spécimen admirable, choisi parmi mille autres, et celui qui le donne est le chef de toute une école qui va marcher sur ses traces.
Maintenant, abordons les grands sujets, et choisissons de préférence ceux qui, plus célèbres, plus ressassés si vous le voulez, sont par cela même le plus entachés de cette mensongère accusation d’imposture et réclament impérieusement un nouvel examen.
Laissons donc parler notre auteur, et ne citons que pour mémoire quelques-uns de ces avant-coureurs de la grande scène de Loudun, par exemple la prétendue folie des religieuses d’Uvertet, qui, « vers 1550, sous le nom de possession des nonnains, causa pendant longtemps un si grand étonnement dans le Brandebourg, la Hollande, l’Italie, et principalement en Allemagne (6). Singulière folie, en effet, que celle qui débutait ainsi : « D’abord elles étaient réveillées en sursaut, croyant [p 133] entendre des gémissements plaintifs… Quelquefois elles se sentaient entraînées hors du lit et glissaient sur le parquet comme si on les eût tirées par les jambes… Les bras, les extrémités inférieures se tordaient en tous sens… Parfois elles bondissaient en l’air et retombaient avec force sur le sol… Dans les instants où elles paraissaient jouir d’un calme parfait, il leur arrivait de tomber à la renverse, d’être privées de l’usage de la parole… quelques-unes, au contraire, marchaient sur les genoux, en traînant les jambes derrière elles. D’autres s’amusaient à grimper en haut des arbres, d’où elles descendaient les pieds en l’air et la tête en bas (ibid., 256). Ces attaques commencèrent à perdre de leur intensité après une durée de trois ans. »
Le grand Dictionnaire des sciences médicales n’est pas moins explicite. « Cette épidémie des nonnains, dit-il, s’étendit sur tous les couvents de femmes de l’Allemagne, et en particulier des États de Saxe et de Brandebourg, et gagna jusqu’à la Hollande. Tous les miracles des convulsionnaires ou du magnétisme animal étaient familiers à ces non nains, que l’on regardait comme possédées. Elles prédisaient, cabriolaient, grimpaient contre les murailles, parlaient des langues étrangères, etc » (Dict., art. Convulsionnaires.)
M. Calmeil a bien soin d’ajouter, de son côté, « que toutes attribuaient leurs souffrances à un pacte, et qu’elles désignaient celle qui leur avait lancé le sort. » Or, ceci est fort utile à noter, Messieurs, car, en fait d’épidémies, ne perdez jamais de vue l’importation, qu’il s’agisse de la peste, du choléra ou des névropathies mystérieuses.
Nous n’appuierons pas beaucoup sur l’épidémie nerveuse des enfants d’Amsterdam, consignée dans tous les ouvrages d’histoire et de médecine, et sur laquelle M. Calmiez semble admettre la narration rapportée par de Wier, narration qui nous les représente « comme grimpant sur les murailles et sur les toits…, comme parlant des langues étrangères, sachant ce qui se passait ailleurs, même dans le grand conseil [p. 134] de la ville (p. 269), et vomissant pendant les exorcismes c force aiguilles, des épingles, des doigtiers à coudre, des lopins de drap, des pièces de pots cassés, des verres, des cheveux, etc., etc. » (p. 274).
Nous reviendrons plus tard sur ce dernier phénomène, que nous retrouverons dans plus d’une circonstance. Et notez bien que pas plus qu’aujourd’hui il ne manquait alors d’esprits forts qui prétendaient que « ces enfants se jouaient de la crédulité des simples ; qu’on n’aurait pas dû ajouter foi à leur état de souffrance ; qu’il était absurde de croire qu’ils ne pouvaient s’empêcher de miauler, de monter aux arbres ; qu’ils en imposaient en assurant que le démon entassait mille ordures dans leur estomac … » « Mais, dit toujours M. Calmeil, a-t-on donc oublié que ce n’était pas seulement les démoniaques d’Amsterdam, et que les prétendus possédés et possédées se comportaient partout comme les orphelins de la Hollande ? » (p. 278).
En effet, les religieuses d’Auxonne, comme la plupart des malades qu’on avait précédemment jugées possédées, laissaient échapper de leur bouche, après des conjurations réitérées, « des cheveux, des cailloux, des morceaux de cire, des ossements, et jusqu’à des reptiles vivants. Ces objets offraient aux yeux du clergé une preuve non équivoque de possession » (t. Il, p. 134).
Nous ne citerons aussi qu’en passant ces religieuses de Louvier « qui, de l’état de sainteté passant tout à coup aux plus horribles blasphèmes, crachaient sur le saint-sacrement, se proclamaient démons, rattachant le point de départ de leur maladie à leur confesseur et directeur Picard, qui connaissait à fond tous les secrets de la magie (t. Il, p. 118), et dont nous voyons plus tard le cadavre exhumé et la mémoire frappée d’excommunication par l’évêque d’Évreux, assisté de l’archevêque de Toulouse et des docteurs envoyés par la reine. »
Nous omettons enfin les démonopathies de Lyon, de Nîmes, de la Pouille, de l’Allemagne, du Puy en Velay et celles du [p. 135] diocèse de Bayeux, attribuées encore par les pauvres malades à un curé indigne renfermé depuis à l’abbaye de Belle-Étoile. Nous ne discuterons donc aucun de ces faits précurseurs ou rivaux de Loudun, et nous garderons toutes nos forces et les vôtres, Messieurs, pour ces derniers phénomènes. Nous ferons seulement remarquer qu’il ne s’agissait plus ici, comme on le voit, d’un couvent on d’un homme, d’un Laubardemont ou d’un Grandier, puisque le mal était général, et que toute l’Europe en était là.
Ier
La vérité se fait jour, grâce à de nouvelles études. — Les ursulines de Loudun sont transformées de comédiennes en malades.
— Urbain Grandier est transformé de martyr en criminel infâme.
— La relation du protestant Aubin, sur laquelle étaient basés nos préjugés historiques, est déclarée calomniatrice et absurde.
Nous l’avouerons en toute humilité, nous partagions bien complétement l’erreur générale, lorsque le hasard nous fit rencontrer un jour un ouvrage sur l‘extase par le docteur Bertrand (7), cet aimable savant enlevé trop tôt à l’Académie des sciences, et nous restâmes trop frappé du nouveau jour sous lequel il envisageait tous ces faits pour ne pas lui consacrer aujourd’hui quelques lignes. D’ailleurs, le docteur Calmeil s’appuyant sur cet ouvrage et nous y renvoyant sans cesse, nous ne pouvions nous dispenser de commencer par lui.
« On a beaucoup écrit, dit Bertrand (8), sur cette malheureuse affaire ; cependant je ne crains pas d’avancer que personne jusqu’ici ne l’a considérée avec un esprit entièrement dégagé de préjugés et sous un point de vue philosophique… Vers l’an 1632, deux jeunes religieuses d’une des communautés [p 136] de la ville de Loudun ayant été atteintes de violentes convulsions accompagnées de symptômes bizarres…, on les exorcisa …, on produisit sur elles l’extase, et le prêtre, dans cet état, leur ayant, suivant l’usage, adressé la parole en s’exprimant comme s’il parlait au diable même, elles répondirent en conséquence, et les diables, parlant par leur bouche, déclarèrent qu’ils avaient été envoyés par un curé de la ville appelé Urbain Grandier. Plus d’une raison devait fixer l’attention des religieuses sur ce prêtre, qui depuis quelque temps faisait grand bruit dans la ville. C’était, en effet, un homme d’un esprit cultivé, d’un extérieur agréable, et plus porté à la galanterie qu’il n’aurait été convenable à sa profession. Les aventures scandaleuses qu’on lui imputait faisaient le sujet des conversations…, et, quoique absous d’un interdit prononcé par son évêque, ce curé n’en était pas moins un scandale pour la plus grande partie des habitants de Loudun… »
Ailleurs Bertrand le représente « comme un grand criminel, et s’appuie sur les aveux de ses défenseurs eux-mêmes pour prouver que « ses ennemis n’auraient eu besoin que de ses crimes précédents pour le faire condamner à mort (9). » « Grandier cependant, dit-il, n’avait pas craint de se faire proposer pour remplir les fonctions de directeur auprès de ces religieuses, et avait été refusé à cause de cette mauvaise réputation. (p. 358).
Bertrand passe ensuite à la maladie sans mentionner les détails de l’importation. C’est une faute philosophique, mais laissons-le continuer : [p. 137]
« Le mal ne resta pas renfermé dans la communauté ; plusieurs filles séculières de la ville tombèrent dans un état semblable à celui des religieuses, et furent également exorcisées. La contagion gagna même les villes voisines… Cependant on continuait les exorcismes, auxquels on donnait la plus grande publicité ; toutes les possédées, sans exception, s’accordèrent à accuser Grandier. Ce fut dans cet état de choses que Laubardemont eut occasion de venir à Loudun. Entrant, à ce qu’il paraît, dans les vues des ennemis de Grandier…, il créa pour cet effet une commission de douze juges choisis dans les environs et parmi les plus grands hommes de bien. Le procès dura huit mois, pendant lesquels les religieuses ne cessèrent d’être exorcisées deux fois par jour. Le résultat de tout cela fut la condamnation et la mort de l’accusé » (p. 341).
« Il n’y eut pas sur l’affaire de Grandier la même unanimité d’opinion dans le public que parmi les juges… Tandis que les catholiques voulaient à tout prix voir des miracles dans ce que faisaient les religieuses, les protestants, qui n’étaient pas comme eux témoins de tous les exorcismes (10), prétendaient que tout ce qui se passait n’était qu’un jeu pour faire périr le malheureux Grandier, que les juges étaient gagnés, que les exorcistes étaient des scélérats, et que les religieuses ne faisaient que répéter en public une comédie qu’on Ieur avait fait étudier long temps à l’avance. Cette dernière opinion est celle qu’on a conservée sur cette malheureuse affaire, surtout depuis la publication de l’histoire des diables de Loudun… J’ai dit plus haut quelle estime on peut accorder à cet historien qui écrivit près d’un siècle après l’événement, et je crois avoir prouvé combien ses conjectures hasardées sans preuves sont absurdes (p. 11) (p. 342). « Que Laubardemont soit entré dans un complot infâme pour faire périr un innocent, je le veux bien. Que les douze juges fussent aussi dans le complot, je l’accorderai encore, quoiqu’il [p. 138] soit bien difficile de concevoir comment douze juges (12) auraient pu se rendre coupables d’une pareille horreur ; mais que les religieuses soient entrées dans ce complot, c’est ce que ma raison se refuse à croire. Jamais on ne me persuadera que, dans une communauté peu nombreuse, on ait trouvé huit femmes, huit jeunes filles, aussi endurcies dans le crime, etc. » (ib.).
Bertrand examine ensuite comment on aurait pu les styler à une aussi effroyable comédie :
« Il aurait donc fallu. dit-il, que de longue main elles eussent étudié la langue latine pour répondre aux questions qui leur étaient faites dans cette langue… Il aurait fallu qu’elles se fussent étudiées longtemps à l’avance à feindre ces épouvantables convulsions… que les plus habiles saltimbanques ne sauraient imiter… Or, imagine-t-on rien de plus horrible que l’infernal rassemblement de huit femmes (vous oubliez les villes voisines) s’exerçant en secret à la plus épouvantable comédie ? Et pourquoi ? Pour conduire à une mort cruelle un malheureux prêtre innocent qu’elles n’avaient aucun intérêt à faire périr… Une pareille horreur ne se conçoit pas dans la nature… On répugnerait à la supposer dans un seul homme mû par le plus grand intérêt, comment l’imaginer dans huit femmes, huit jeunes filles ?… Il résulte pour moi de l’ensemble de ces considérations une preuve morale si forte, que mon esprit se refuse absolument à aller contre ce qu’elle établit « (p. 346).
Jusqu’ici, vous le voyez, Messieurs, Bertrand, tout philosophe qu’il soit, rend hommage, comme il le doit, à la véracité des religieuses.
« Mais, dit-il, si on consent à ne voir en elles que des filles malades et s’abusant elles-mêmes sur leur propre état, tout s’explique, tout devient facile à comprendre » (p.347).
Ah ! facile ! nous allons voir. Et tout d’abord, puisque c’est si facile, pourquoi donc, M. Bertrand, remarque-t-on à chacune de vos lignes tout l’embarras qu’elles vous causent ? [p. 139] embarras qui parait redoubler lorsque vous retrouvez tous ces phénomènes dans le rituel de ces exorcistes auxquels votre impartialité rend une complète justice en disant « qu’ils ne se décidaient pas à la légère » (p. 321).
Or, selon vous et selon le rituel, voici les phénomènes nécessaires pour toute possession :
1° Faculté de connaître les pensées même non exprimées ;
2° Intelligence des langues inconnues ;
3° Faculté de parler ces langues inconnues ou étrangères ;
4° Connaissance des événements futurs ;
5° Connaissance de ce qui se passe dans les lieux éloignés ;
6° Développement de forces physiques supérieures ;
7° Suspension du corps en l’air, pendant un temps considérable.
A l’exception de ce dernier phénomène, que vous n’avez pas constaté, mais que bien d’autres ont pu voir, et que nous allons retrouver tout à l’heure, vous constatez tout cela à Loudun, et vous êtes parfaitement d’accord avec le rituel ; seulement celui-ci ne trouve pas une seule explication naturelle et guérit surnaturellement, tandis que vous, vous déclarez l’explication facile, mais ne la donnez pas le moins du monde et ne guérissez jamais. Néanmoins, grâce à vous, un pas immense vient d’être fait : nous sommes enfin d’ accord sur les symptômes ; ils sont réels, ils sont terribles, nous finirons par nous entendre sur la cause.
Maintenant écoutons notre savant manigraphe, le docteur Calmeil, l’historien tout spécial de ces cruelles maladies. Peut être va-t-il trouver dans sa longue expérience le secret tant cherché.
Mais, avant tout, n’oublions pas que c’est un médecin in croyant qui nous parle, et tâchons seulement, ne pouvant [p140] reproduire sa longue et intéressante narration, d’en extraire la pensée et les principaux détails (13).
Pour M. le docteur Calmeil, Urbain Grandier était donc, comme pour Bertrand, « un homme distingué par l’esprit, le talent, les avantages physiques ; éclat des manières, mœurs faciles et galantes, procès scandaleux, inimitiés passionnées, alternatives de revers et de fortune, rien n’avait manqué à l’existence tour à tour enviée ou tourmentée de cet homme véritablement superbe » (t. Il, p. 32).
« Non, ce ne fut pas Mignon, le directeur des Ursulines, qui leur suggéra l’idée de perdre Grandier… Les malheureuses, en devenant hallucinées, n’eurent plus sous les yeux d’autre image que la sienne…, et elles durent… en raison de leur impuissance à la chasser par les macérations, le jeûne et la prière, le considérer comme un redoutable magicien.
« Quant à ces religieuses elles-mêmes, à la tête desquelles était comme abbesse madame Jeanne de Belfiel, issue de la maison du baron de Cose, on voyait figurer parmi elles, comme simples sœurs, madame Claire de Sazilly, parente de Richelieu, les deux dames de Barbezieux de la maison de Nogaret, les deux dames d’Escoubleau de la maison de Sourdis. Ces dames ne le cédaient à aucune personne de leur sexe pour la culture de l’esprit, la politesse des manières, le soin qui avait présidé à leur éducation. Toutes se vouaient, en se conformant aux règles de leur ordre, à l’instruction des jeunes filles qui leur étaient confiées à titre de pensionnaires ou d’externes… Les écrivains protestants ont soutenu que ces religieuses s’entendaient avec les ennemis d’un homme dont on avait décidé la perte, et qu’elles n’avaient jamais éprouvé les symptômes d’une véritable monomanie convulsive ; CETTE CALOMNIE EST RÉFUTÉE PAR LE SEUL EXPOSÉ DES FAITS, quelque défigurés qu’ils soient [p. 141] dans les récits des exorcistes et dans tous les mémoires qui traitent de l’affaire d’Urbain Grandier » (p. 8).
Un instant, monsieur Calmeil ; pourquoi donc, s’il vous plait, ces faits seraient-ils défigurés dans les récits des exorcistes. Du moment où vous admettez la parfaite bonne foi et de ces pieux exorcistes, et des pauvres malades, et de tant de témoins considérables, tels que princes, magistrats, évêques, docteurs, tous parfaitement d’accord, dites-vous, avec la masse des populations, comment pouvez-vous, à deux cents ans de distance, rectifier d’un trait de plume ce que vous appelez les inexactitudes de tant de procès-verbaux ? Ne serait-ce pas par hasard parce que ces quelques inexactitudes généraient tant soit peu vos théories, et qu’après avoir blâmé cette méthode chez les autres, vous n’accepteriez à votre tour que des faits qui vous paraîtraient acceptables ? Il n’y a pas de milieu cependant ; quand il s’agit de faits qui durèrent six ans, à la clarté du soleil et en présence de plusieurs milliers de témoins, il faut supposer ou l’artifice dans leur production, comme t’ont fait les protestants, ou la sincérité des juges et la fidélité des rédacteurs. Or, puisque vous déclarez souverainement absurde la supposition d’artifice, acceptez bravement, comme votre célèbre confrère, la fidélité d’un compte rendu signé par cette masse de témoins réhabilités par vous-même.
Car vous le remarquez avec raison (p. 72) : « Il n’est que trop vrai que presque tous les médecins (appelés des villes, grandes ou petites, situées dans un rayon distant de vingt-cinq à trente lieues de la communauté), comptaient plus sur l’efficacité des exorcismes que sur la puissance de leur art, et que jamais la crédulité de leur esprit ne se montra d’une manière plus fâcheuse que dans les réponses qu’ils firent aux questions posées pendant le cours du procès… »
Mais, soit dit en passant, on interrogeait donc les médecins ? on les consultait donc soigneusement ? Oui, car on exigea d’eux jusqu’à vingt-cinq ou trente rapports différents. On avait donc envie d’avoir la vérité ? Apparemment, à moins qu’on ne dise [p. 142] encore que tous ces médecins, appelés de tant de lieux différents, étaient tous aussi gagnés par Laubardemont. Voilà pourtant où l’on va avec ce malheureux système de la jonglerie ! Épiscopat, magistrature, sainte austérité du cloitre, autorité de la science elle-même, tout y passe, tout s’écroule à la fois sous l’inculpation toute gratuite du plus infâme et du plus impossible compérage.
Vous ne tombez pas dans cet écueil, vous, Monsieur, car vous gourmandez très-sévèrement et très-justement les docteurs de Montpellier, et entre autres le célèbre Duncan, appelés, précisément pendant le procès de Loudun, à donner leur avis sur des accidents tout semblables qui se passaient dans le Languedoc et à Nîmes, tant le compérage avait les bras longs à cette malheureuse époque ! Vous les blâmez vigoureusement d’avoir laissé entrevoir que les démoniaques (qu’ils n’avaient pas vus du reste) se jouaient impudemment de la piété du peuple. Vous déclarez, avec raison, leurs conclusions « tout à fait indignes d’une Université qui comptait dans son sein des hommes tels que Rivière, Lazzari, Ranchin, de Belleval, etc., et vous vous hâtez, au contraire, de justifier tous les médecins témoins et partisans cette fois de la possession. « Car, dites vous, nulle part la démonopathie n’étant décrite comme l’expression d’une simple altération des fonctions naturelles, il fallait en venir à confesser que l’ensemble des accidents que l’on avait sous les yeux ne ressemblait positivement à rien de ce qui avait été signalé jusque-là par les pathologistes … et opter entre… l’explication par la jonglerie ou par la véritable possession » (p. 28). Or, selon vous, ceux qui ont voté pour la jonglerie s’étant déshonorés, les autres, en votant pour la possession, obéissaient ponctuellement à votre manière de voir.
Après l’établissement de cette base capitale, voyons donc maintenant ce que deviennent ces pauvres religieuses parfaitement bien portantes, ne l’oublions pas, jusqu’au moment où elles refusent Grandier pour directeur de leur couvent.
A partir de ce moment, les hallucinations commencent, et [p. 143] lorsque, après plusieurs semaines du silence le plus prudent, on se voit forcé d’en venir aux exorcismes, voici que les phénomènes changent tout à coup de nature en prenant des proportions gigantesques. « Telle religieuse, dit M. Calmeil,…. couchée sur le ventre, les bras tordus sur le dos, défie de la sorte le prêtre qui la poursuit avec le saint-sacrement; celle-ci, courbée en arrière, pliée en double, affecte de marcher la nuque posée sur les talons; celle-là imprime à sa tête des mouvements étranges… « Je vis une chose qui me surprit beaucoup, confesse le Père Surin, et qui était ordinaire à toutes les possédées : c’est qu’étant renversées en arrière, la tête leur venait aux talons et elles marchaient ainsi avec une vitesse surprenante et fort longtemps ; j’en vis une qui étant relevée se frappait la poitrine et les épaules avec sa tête, mais d’une si grande vitesse et si rudement, qu’il n’y a au monde personne, quelque agile qu’il soit, qui puisse rien faire qui en approche… Quant à leurs cris, c’étaient des hurlements de damnés, de loups enragés, de bêtes horribles. On ne saurait imaginer de quelle force elles criaient. Souvent la langue des énergumènes pendait hors de la bouche, mais la noirceur, la tuméfaction et la dureté de cet organe disparaissaient aussitôt qu’il était rentré dans la cavité buccale. »
« Puis viennent les hallucinations visuelles qui leur font attribuer leur état à la présence et à l’obsession des esprits malfaisants… Madame de Belfiel (et notez bien qu’elle n’a pas plus que les autres l’ombre de fièvre ou de folie), tout en répondant aux questions des exorcistes, entend parler un être vivant dans son propre corps, se figurant qu’une voix étrangère émane de son pharynx (p. 13)… Et comment ces démoniaques auraient elles douté de la présence des diables dans leur corps, quand il leur semblait qu’une voix nettement articulée, et partant de leur intérieur, affirmait que les mauvais anges avaient pris possession de leur personne, ou quand cette voix allait jusqu’à indiquer le nom, le nombre et le lieu de la résidence des démons ?… (P. 15.) [p. 144]
« Souvent encore il y avait après la crise oubli complet de tout ce qui avait été dit pendant sa durée (14), et comme les exorcistes attestent que le diable endormait (15) quelquefois les religieuses soumises à l’exorcisme, l’état de ces filles ressemblait peut-être par instants à celui des somnambules magnétiques. »
« Lorsque la supérieure s’avisa de demander une neuvaine au Père Surin, elle venait de faire une dissertation qui avait duré deux heures. A la fin de ce discours, elle ignorait absolument tout ce qu’elle avait débité pendant son improvisation. Obéissait-elle alors à l’inspiration du somnambulisme ? Elle était certainement en extase quand sa figure parut prendre une teinte pourpre… »
Ailleurs, M. Calmeil ajoute : « Aujourd’hui la puissance magnétique détermine une partie des effets dont on prétendait alors rendre les démons responsables. (p. 29). A merveille ; mais auparavant il eût fallu nous dire ce que c’est que la puissance magnétique ; car nous ne sortons pas des pétitions de principes. On explique tous les prodiges par le magnétisme ; et lorsqu’il s’agit de magnétisme, on le nie contre toute évidence.
Continuons : « Au mois de mai 1635, Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, voulant juger par lui-même de l’état des Ursulines, se rendit à Loudun et assista à quelques séances des exorcismes. La supérieure, exorcisée par le Père Surin, adora d’abord le saint-sacrement, en donnant tous les signes d’un violent désespoir. Bientôt le Père, répétant le commandement qu’il avait déjà fait, mit le corps de la prieure dans une violente convulsion, tirant une langue horriblement difforme, noirâtre et grenée comme du maroquin sans être pressée des dents… On remarqua, entre autres postures, une telle extension des jambes, qu’il y avait sept pieds d’un pied à l’autre… Elle demeura dans cette posture assez longtemps, avec tremblements étranges, ne touchant la terre que du ventre. [p. 145] S’étant relevée, il fut commandé encore une fois au démon de s’approcher du Saint-Sacrement… Ayant proféré quelques paroles, il devint encore plus forcené, se mordant les bras… Puis l’agitation cessa peu après, et la fille revint à elle, n’ayant pas le pouls plus ému que s’il ne se fût passé rien d’extraordinaire » (p. 23).
Mais voici que « le Père Surin, qui parlait à Monsieur, et qui allait faire l’exorcisme, sentit les attaques de l’un des diables, qui le renversa deux fois ; le démon, forcé de se retirer par le Saint-Sacrement qu’on lui appliquait, rentra tout à coup dans la prieure qui était à deux pas de là… Au même instant, l’exorciste, s’étant relevé, alla combattre le démon auquel le Père Tranquille demanda d’où lui venait cette audace de tourmenter le Père Surin. Il répondit en furie, s’adressant au père Surin lui-même : « C’est pour me venger de toi. » Et l’on verra bientôt, ajoute M. Calmeil (p. 24), si le Père Surin simulait le délire de la possession (16). »
« La même religieuse exécuta aussi, sur la fin de l’exorcisme, un ordre que le duc venait de communiquer secrètement à l’exorciste. Dans cent occasions, on put croire, en effet, que les énergumènes lisaient dans la pensée des religieux chargés de combattre les démons » (p. 29).
Restons-en là. Voici donc à peu près le résumé de ce qu’on nous accorde. — Les faits sont vrais ; — les religieuses, les exorcistes et les juges ont été absurdement calomniés. Grandier est, selon M. Calmeil, un prêtre libertin et, selon Bertrand, un grand criminel ; les médecins présents durent croire à la possession ; ceux de Montpellier, en optant pour la jonglerie, firent preuve d’ignorance, car il ne s’agissait là que d’une maladie terrible et nouvelle, que, de nos jours, le somnambulisme magnétique rappelle quelquefois. [p. 146]
Il suffit. A nous maintenant de compléter l’exposition des faits, car si vous nous le permettez, monsieur Calmeil, nous vous reprocherons fortement d’avoir choisi, parmi toutes les dépositions sincères, celles qui pouvaient à la rigueur entrer dans votre cadre nosologique (17), et d’avoir laissé à la porte toutes celles qui ne s’y ajustaient pas facilement, infraction capitale aux conventions que nous avons signées en commençant.
A notre avis, en effet, vous auriez dû :
1° Vous étendre un peu davantage sur les débuts et les détails de l’importation subite d’une telle maladie, chez des religieuses jouissant jusque-là de la santé la plus brillante, car tout un couvent de pieuses nonnes ne tombe pas, instantanément, dans un état de damnation anticipée (ce sont vos expressions), sans une cause extérieure et pour le moins déterminante, sans un agent de l’épidémie et de la contagion. Puis, du moment où toutes ces religieuses, dans leur extrême bonne foi (que vous reconnaissez encore) signalent à la justice ce Grandier que vous venez de sacrifier, un pareil scélérat, convenez en, devient à bon droit fort suspect. Dans tous les pays du monde la justice s’en empare et l’amène sur ses bancs. Il fallait donc insister davantage sur les détails de cette prévention vraie ou fausse, car là pouvait reposer le mystère et tout le secret de la maladie.
2° Vous avez stigmatisé justement ce caprice de l’opinion publique qui s’en va préférer au témoignage si positif de tant de gens considérables et de la plus haute probité, le témoignage d’un écrivain protestant, rédigeant son pamphlet plus d’un siècle après l’événement, arrangeant bien à son aise toutes ces calomnies que le docteur Bertrand déclare absurdes et que vous affirmez bouleversées de fond en comble par la seule exposition des faits. C’est fort bien, mais il eût été mieux encore [p. 147] et vraiment bien facile de le convaincre sur-le-champ d’imposture en le prenant tout simplement par ses propres paroles. Tout le monde y aurait gagné, à commencer par vous, Monsieur ; car il vous suffisait, par exemple, de lui objecter cet aveu qu’il nous fait dans un moment d’oubli : « Toutes les personnes, réformées ou papistes, avec lesquelles on a eu des entretiens à ce sujet, et qui avaient assisté aux exorcismes, sont demeurées d’accord de tous les faits relatifs à la possession des deux exorcistes, comme de la plupart des autres faits contenus dans ra relation de ce qui s’est passé en présence de Monsieur, frère du roi (18). En regard d’une distraction pareille, vous en conviendrez, toute l’autorité de son pauvre livre tombait ; il s’écroulait sur sa base, et dès lors, vous, Monsieur, vous vous trouviez forcé de méditer un peu plus sérieusement sur ces mêmes faits, faits prodigieux il est vrai, mais d’autant plus irrécusables que leur plus grand ennemi les déclarait authentiques : parmi ces faits acceptés par tout le monde, vous auriez remarqué surtout celui des hosties transportées à commandement et sans ma leur visible, suivant l’ordre donné par le prince et transmis mentalement par les exorcistes. Dès lors, vous auriez mieux compris que ce prince ait signé toutes ces affirmations en ajoutant verbalement « qu’il fallait être fou pour ne pas croire aux possessions. »
3° Cela vous eût encore facilité l’acceptation des faits équivalents, attestés par les évêques de Châlons, de Besançon, de Toulouse, de Rennes, de Rodez, etc., par des conseillers de parlement, comme M. Deniau, et surtout comme M. de Keriolet, qui se convertit à la peinture trop vraie que lui fit une possédée de l’état le plus secret de sa conscience. A ces faits serait venu se joindre celui de lord Montagu, cet Anglais protestant, qui, bouleversé de voir des stigmates et des mots s’imprimer en lettres de sang, et à son simple commandement mental, sur le front et sur les mains de la supérieure, se rendit [p. 148] à Rome pour y abjurer le protestantisme entre les mains du Saint-Père et y recevoir les ordres sacrés (19).
4° Il est un autre fait que vous passez encore beaucoup trop légèrement sous silence, c’est celui de la suspension en l’air pendant un temps déterminé, phénomène assigné par le rituel comme un des criterium de la possession, toutes les fois qu’on ne pouvait l’attribuer à l’Esprit-Saint. Or il est certifié, toujours par ces mêmes autorités que vous déclares véridiques (ne l’oubliez pas), que la supérieure resta pendant quelque temps véritablement suspendue à deux pieds d’élévation. Ce phénomène transcendant produisit, à ce qu’il parait, un effet immense parmi tous les assistants, et fut un des plus certifiés. Comment donc espérez-vous, Monsieur, pouvoir vous en tire l’ par cette phrase qui jure avec tous vos aveux ? « Faut-il conclure de ce que ces monomaniaques mettaient tout en œuvre pour faire accroire aux assistants que les esprits déchus n’avaient pas man qué à l’accomplissement de leurs promesses, qu’elles n’ont ja mais joué qu’un rôle de convention ? » (P. 21) Prenez-y garde, monsieur Calmeil, l’auteur protestant si bien battu par vous tout à l’heure va vous battre à son tour. Comment ! vous établissez la parfaite bonne foi des religieuses pour tous les faits qui peuvent à la rigueur être expliqués par votre théorie, et pour ceux qui lui échappent vous admettez, par exception, que ces religieuses mettaient tout en œuvre pour en faire accroire au public !… Mais vous n’y pensez pas ; par cet expédient exceptionnel, vous sapez votre ouvrage par sa base, comme l’auteur protestant sapait le sien tout à l’heure; et d’ailleurs, songez donc que dans ce dernier cas il ne s’agit pas du secret des religieuses, mais bien de leur adresse. Comment donc auront-elles pu s’y prendre pour opérer ce tour de force que nous n’avons jamais vu tenter, nous, fût-ce par les plus habiles de nos acrobates ? Ici, pas de méprise possible, le fait est des plus simples, et du moment où toutes ces graves autorités attestent [p. 149] l’immense sensation qu’il produisit, croyez-vous par hasard, que nous pourrons nous contenter de cette assertion de notre posthume écrivain. que la supérieure reposait tout simple ment alors sur la pointe de ses pieds T JI Comme il devient probable qu’après tant de précautions minutieuses prises par tant de gens éclairés, toute la ville, qui ne faisait qu’un avec eux, se sera laissé prendre à une simple pirouette! En vérité, il y aurait par trop de simplicité à supposer les gens aussi simples !
5° Il en est de même des langues étrangères. Ce phénomène, un des plus importants signalés dans le rituel et si fréquent à Loudun, ne semble pas vous préoccuper extrêmement. A peine lui consacrez-vous quelques mots. Malheureusement pour vous, ces mêmes témoins de si bonne foi sont toujours là, pour vous attester solennellement « que Mme la supérieure répondait d’abord en latin aux questions du rituel, mais que, dans la suite, elle et les autres répondirent EN QUELQUE LANGUE qu’on jugeât à propos de les interroger ; si c’est vrai, que devient la petite plaisanterie de l’auteur protestant, sur le mauvais latin des religieuses ? ou bien encore l’historiette de la plume et des reliques ? Faisons donc de l’histoire et non pas des lazzi, lorsqu’il s’agit d’une épidémie européenne. Or, dans les procès-verbaux, nous voyons plusieurs autorités très- graves certifier par écrit avoir interrogé la sœur Claire de Sazilly en turc, en espagnol, en italien, et qu’à toutes elle répondit fort à propos ; nous voyons le sieur de Nîmes, docteur en Sorbonne, et l’un des aumôniers du cardinal de Lyon, interroger en grec et en latin et obtenir des réponses en l’une et l’autre langue ; le père Viguier, supérieur de l’Oratoire, à la Rochelle, interroger en grec pendant toute une après-dînée, et obtenir des réponses parfaitement justes ; nous voyons l’évêque de Nîmes commander en grec et obtenir le même résultat, ce qui fit dire publiquement à ce prélat « qu’il fallait être athée ou fou pour ne pas croire à la possession. » Nous voyons enfin des médecins interroger aussi sur des termes grecs de leur science, termes très-difficiles, [p. 150] connus uniquement des savants, et obtenir les explications les plus nettes (20).
Nous voyons mieux que cela ; nous voyons un M. de Launay de Razelly, qui avait demeuré en Amérique, attester que, pendant son voyage à Loudun, il avait parlé le langage de certains sauvages aux énergumènes, qui lui répondirent fort pertinemment, en lui révélant même des choses qui s’étaient passées dans ce pays.
Enfin nous voyons Urbain Grandier lui-même, sommé par son évêque de prendre l’étole pour exorciser la mère supérieure, qu’il disait savoir le latin, refuser de l’interroger en grec ni elle ni les autres, quoiqu’elle lui en fissent le défi, de quoi il resta fort confus (21).
Pourquoi du moins ne vous retranchez-vous pas dans la distinction formulée par votre savant collègue M. Bertrand ? Forcé de convenir que « presque toutes les possédées entendaient des langues, bien qu’à l’exception de deux ou trois elles ne pussent pas les parler, » il explique ce phénomène par la pénétration magnétique des pensée. Il est vrai que cette explication ne vous paraîtrait pas plus commode, mais encore une fois, les témoins n’affirmant, selon Bertrand, avec un minutieux scrupule que ce qu’ils ont vu (2), pourquoi vouloir corriger leur relation lorsqu’elle vous dit : « Dans la suite, les unes et les autres répondirent en quelque langue qu’on jugeât à propos de les interroger ? » Vous ne vous êtes pas soucié, Monsieur, de la capitulation de Bertrand, la jugeant probablement peu avantageuse : mais alors, n’allez pas croire non plus avoir abordé les vrais phénomènes et dites-vous bien que tout est à recommencer.
6° Ce qu’il faudrait modifier encore, ce sont vos conclusions [p. 151] sur ce procès que vous appelez quelque part inique et cruel, conclusions formellement opposées à toute votre plaidoirie et qui, nous vous en prévenons, vous laisse encore bien loin de la logique protestante. Tout se tient dans une affaire semblable, et l’on peut dire qu’en pareil cas il n’y a pas de circonstances atténuantes. Ainsi, l’écrivain protestant enveloppe, lui, tout son monde dans la prétendue conspiration de Richelieu ; oui, tout son monde, depuis les ursulines jusqu’aux évêques, magistrats, médecins, etc. A ses yeux, c’est une vraie franc-maçonnerie, qui de tous les bouts de la France envoie ses émissaires à Loudun. Et il a raison de les mettre tous sur la même ligne, parce que dans une comédie, ou plutôt dans une tragédie semblable, tous les acteurs doivent être nécessairement dans le secret.
Mais du moment où nous admettons, avec Bertrand, que « toutes ces suppositions sont absurdes, » et, avec Bayle, que « Laubardemont avait choisi les douze juges parmi les plus grands hommes de bien » (singulière manière, soit dit en passant, d’organiser une conspiration atroce) ; du moment où nous disons avec vous, Monsieur, que toutes ces calomnies sont complètement détruites par la seule exposition des faits, » l’esprit de justice et de logique demandait beaucoup plus et vous lais sait fort à faire.
Avant de qualifier le procès d’inique et de cruel il fallait reprendre en main toute la cause, et l’étudier sérieusement. Vous auriez vu, clair comme le jour, que, bien loin d’avoir monté toute l’affaire. Laubardemont et Richelieu y étaient restés bien longtemps étrangers, car tout le dossier se traduit en peu de mots, et nous allons vous en donner, à notre tour, la substance, telle que nous la comprenons.
Envahissement d’une maladie effroyable aussitôt après le refus fait à Grandier de l’agréer comme directeur du couvent, — mystère et profond silence, dans lesquels cette communauté, si honorée jusque-là, cherche à ensevelir sa honte et ses cruelles épreuves (23) — Après deux ou trois mois de remèdes et de [p. 152] prières, puis enfin d’exorcismes secrets, puis enfin d’exorcismes publics et d’effervescence à Loudun, la cour commence à s’en préoccuper un peu, et la reine envoie sur les lieux l’abbé de Marescot, son aumônier, qu’elle charge de lui mander ce qu’il en pense. L’abbé fait son rapport, et ce rapport ne contient que ce que le procès établira plus tard. Trois mois après seulement. M. de Laubardemont, intendant de la province, s’étant transporté à Loudun pour la destruction du château, mission qui venait de lui être confiée par Louis XIII, s’alarme de la fermentation générale des esprits, et comprend la nécessité de couper court au scandale. Interprète fidèle, à cet égard, du vœu de tous les habitants, il en informe Richelieu, qui jusque-là ne s’en était pas occupé ; celui-ci en réfère au roi, qui charge Laubardemont, en sa qualité d’intendant, d’en connaître souverainement et sans appel, lui donne l’ordre d’arrêter Grandier, et de choisir dans les juridictions environnantes les juges les plus intègres et les plus habiles, (Voyez quel guet-apens !) Que fait alors Laubardemont ? il choisit précisément ses juges parmi l’élite des magistrats. — Ces juges se préparent au grand et pénible devoir qu’ils vont avoir à remplir, non plus, comme aujourd’hui, par une messe basse du Saint-Esprit, mais par la réception publique des sacrements, les processions générales, la visitation des églises, et les prières des Quarante-Heures. Laubardemont, conformément aux ordres du roi, fait arrêter Grandier, mais en même temps, du consentement de l’évêque, il fait aussi, remarquez-le bien, séquestrer absolument les religieuses dans différentes maisons, les fait interroger séparément, en compagnie d’évêques et de docteurs ; il Y apporte tous les soins possibles, s’enquiert de tous les précédents, les confronte les unes avec les autres, puis enfin, prenant en main les intérêts de l’accusé, lui expose toutes les charges qui pèsent sur lui, exige qu’il assiste à tous les exorcismes, ne néglige absolument rien de ce qui peut le [p. 153] convaincre ou le ramener, et lorsque, après les trente rapports librement et très-soigneusement rédigés par les évêques, les docteurs et les médecins, Grandier est condamné au supplice, nous voyons toujours ce même Laubardemont s’attacher à ses pas, l’adjurer sans relâche, et ne l’abandonner à la justice qu’après avoir perdu toute espérance de repentir et d’aveu, de la part de celui qu’à tort ou à raison il devait regarder, avec Bertrand, comme un grand criminel (24).
Voilà la véritable histoire de Loudun, non plus celle que l’on invente à un siècle de distance, mais celle qui résulte de toute une masse de documents contemporains émanés de sources diverses et tous parfaitement identiques. Et l’on vou drait nous faire croire que ce long drame, cette longue succession de prodiges et de tortures, était r œuvre de je ne sais quel futile compérage entre un intendant de province et un ministre ! Mais, ne nous lassons jamais de le répéter, l’histoire bien étudiée vous montrera toujours ces deux personnages n’entrant dans cette affaire que lorsqu’elle était déjà dans son plein, c’est-à-dire lorsque toute la province était en feu. Alors que signifient toutes ces déclamations sur une prétendue rancune de Richelieu, à propos d’un certain petit libelle ? Rien, absolument rien. Que Laubardemont et Richelieu aient mis plus ou [p. 154] moins de sévérité dans l’accomplissement de fonctions qu’il leur devenait impossible de décliner plus longtemps, nous ne nous en soucions guère, car là n’est pas la question, la forme pouvant être blâmable sans que le procès fût inique. Mais, si vous voulez que nous vous disions toute notre pensée, lorsque nous voyons Laubardemont envoyer chercher en toute hâte, et la nuit, les exorcistes de Loudun, pour sa femme, prise, à Loches, de la même maladie (25), lorsque nous le voyons conduire dans sa propre voiture, de Loudun à Paris, la supérieure du couvent, uniquement pour faire vérifier par la cour et par toute la capitale les stigmates sanglants imprimés sur les mains de cette femme que vous élevez vous-même au-dessus de tout soupçon ; lorsque nous le voyons, enfin, conférer longuement de toutes ces merveilles avec ces hommes de Dieu dont vous reconnaissez aussi l’entière sincérité, et que nous entendons ceux-ci nous affirmer que ce même Laubardemont partageait toutes leurs vues, rien que leur saintes vues, nous. vous l’avouons, nous sommes plus que tenté de croire, nous sommes certain, que Laubardemont, coupable ou non dans les formes, coupable ou non dans d’autres procédures, est complétement innocent dans celle-ci, et qu’il doit figurer au premier rang parmi ces nombreuses victimes de calomnies qu’avec tant de raison vous déclarez absurdes.
Comment ! Loudun, l’ œuvre de Laubardemont, quand toute l’Europe en était là ! quand, pour ainsi dire, au même moment, cette terrible contagion rayonnait à Chinon, à Louviers, à Auxonne, à Nîmes, dans le Labourd, puis se montrait simultanément en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Hollande et dans toutes les parties de l’Allemagne ! et partout, notez le bien, importée par un seul homme, partout offrant ces mêmes prodiges, étrangers, selon M. Calmeil, à toutes les maladies connues jusque-là ! Etait-ce donc aussi Laubardemont qui, après avoir fasciné sa province, fascinait toute l’Europe ? [p. 155]
Mon Dieu ! quelle manière d’écrire l’histoire, et que le comte de Maistre avait donc raison d’affirmer que « depuis trois cents ans la nôtre n’était plus, sur toutes ces matières, qu’une longue suite de mensonges (26) ! »
Mais encore faudrait-il que ces mensonges eussent pour eux quelque apparence de vérité, et n’expliquassent pas Loudun par Richelieu, les camisards par Louvois, et Saint-Médard par les jésuites, car c’est abuser un peu trop de la facilité de ses lecteurs.
M. Calmeil, il faut le reconnaître, ne donne pas dans de pareilles sottises, il explique médicalement tous ces faits. Mais, avant de discuter ses théories, passons à l’exposition d’une seconde épidémie, bien plus extraordinaire encore que cette dernière.
II.
Les camisards, ou les trembleurs des Cévennes. — Domination de ces malheureux, par une grande puissance inconnue. —
Magnétisme historique à grands effets. — Apologie nouvelle, par M. Bost.
Si vous consultez l’Encyclopédie et tous les auteurs du XVIIIe siècle sans exception, si vous vous contentez de recourir à tous les lieux communs de l’ignorance et des préjugés, ce seul nom de camisards réveille à l’instant tous les vôtres, et, pour vous, leur histoire se résume en deux mots : intolérance odieuse de Louis XIV, et fanatisme de populations exaspérées par leurs persécuteurs.
Or, puisque la science s’empare encore une fois de ce sujet et déclare, tout en le mutilant comme les autres, qu’il n’a pas été compris jusqu’ici, puisque le roman lui-même (27) veut lui faire subir le même travestissement qu’il a fait subir à Loudun, il est temps que la vérité s’en occupe à son tour. [p. 156]
Eh bien! l’histoire à la main (et l’histoire protestante, en tendons-nous bien), il nous serait bien facile de démontrer que, tout en flétrissant les détails d’application comme ils le méritent et comme les ont flétris eux-mêmes tous les honnêtes catholiques, à commencer par le monarque, il n’en est pas moins vrai que son gouvernement n’avait usé, dans le principe, que du droit ou plutôt du devoir le plus sacré de légitime défense, devoir que remplirent et rempliront toujours, sous peine de mort, toutes les autorités possibles, monarchiques, constitutionnelles ou républicaines, y compris celles de juin 1848. Que des conspirateurs armés du fer et de la torche s’appellent camisards ou insurgés, qu’ils inscrivent le droit à la prière sur une croix ou le droit au travail sur les plis de leur drapeau rouge, partout ils nécessiteront des représailles ou plutôt des répressions égales à leurs excès ; nécessités funestes et toujours mal jugées par l’histoire, qui, sous la dernière et terrible impression de la résistance, perd de vue trop souvent la violence de l’attaque.
Mais cette thèse ne rentrant pas dans notre ordre du jour, nous n’irons pas, Messieurs, sortir d’une paisible discussion philosophique pour nous jeter, à deux siècles de distance, sur le terrain des récriminations politiques. Qu’il nous suffise de rappeler, à propos de cette révocation de l’édit de Nantes qui donna naissance aux camisards, ces remerciements votés alors par toutes les villes de France et inscrits sur tous les monuments de cette époque. Ils vous expliqueront ces mots du philosophe Saint-Lambert : « En agissant ainsi, Louis XIV n’avait fait réellement que céder au Vœu général de la nation. » Convenez-en, Messieurs, il est assez piquant de voir la philosophie du XVIIIe siècle faire de Louis XIV le sujet le plus soumis du suffrage universel, comme il l’est aussi d’entendre dire au plus docte et au plus vénéré de tous les protestants, le célèbre Grotius : « Le gouvernement français paraissait suivre en cela le système politique que les gouvernements protestants avaient mis depuis longtemps, à exécution contre leurs sujets catholiques [p. 157] ; et même, en comparant leur code pénal avec celui de la France, il serait facile de prouver que celui-ci se montra plus indulgent et plus tolérant (28). »
Notre unique rôle sera donc d’examiner les singuliers phénomènes, de nature psychologique ou autre, qui accompagnèrent cette vaste insurrection et lui donnèrent un cachet que nulle autre n’avait présenté jusque-là.
Avant de discuter ces faits, passons à leur exposition, telle que la science moderne commence à la rédiger, et hors de laquelle nous défions hardiment les historiens les plus habiles de comprendre jamais le premier mot à toutes les querelles religieuses qui ensanglantèrent cette époque.
Au moment où, vers la fin du XVIIe siècle, les ministres français réfugiés à Genève cherchaient à fomenter la rébellion chez tous leur coreligionnaires restés dans la mère patrie, on vit surgir d’une verrerie du Dauphiné (Peyra), et à la voix d’un homme sur lequel les ministres protestants avaient imposé les mains, cette trombe fanatique qui ravagea pendant plusieurs années une partie du continent, sous le nom de camisards ou trembleurs des Cévennes.
Rien de plus curieux que le mode d’importation ou d’initiation. « Quand un élève avait fait des progrès, dit l’abbé Grégoire, et se trouvait suffisamment prévenu contre les abominations papistes, un fanatique nommé Du Serre, — celui qui avait reçu la mission des pasteurs, — lui soufflait dans la bouche pour lui communiquer le don de prophétie en l’exhortant à le communiquer à tous ceux qu’il en jugerait véritablement dignes. Les autres disciples, stupéfaits, attendaient avec impatience le moment d’obtenir la même faveur. De là il sortit un essaim d’enthousiastes. Bientôt les prophètes pullulèrent de toutes parts ; on les comptait par centaines ; c’étaient quelquefois des enfants de sept à huit ans… Les fanatiques s’assemblaient dans les bois, les cavernes, les lieux déserts, sur [p. 158] les cimes des montagnes, au nombre de quatre ou cinq cents, quelquefois même de trois à quatre mille. Là, ils attendaient l’esprit d’en haut… Puis le prophète soufflait dans la bouche des aspirants au don de prophétie, en leur disant : « Recevez le Saint-Esprit. » Alors ils prophétisaient à leur tour, tremblaient, se roulaient, écumaient…
« Ce fanatisme réduit en système comptait quatre grades : l’avertissement, le souffle, la prophétie, et le don. Chaque troupe avait un prophète. On pillait, on brûlait les églises, on massacrait les curés ; environ quatre mille catholiques et quatrevingts prêtres furent égorgés en 1704. Celui de Saint-André de Lancise fut précipité du haut de son clocher. Fléchier, l’illustre et pieux évêque de Nîmes, décrit dans une lettre pastorale tous leurs ravages et leurs massacres, que Villars, Berwick et divers généraux parvinrent enfin à calmer. » (Hist. des sectes religieuses, T. Il, p. 117.)
S’il faut en croire ce même abbé Grégoire, si prévenu pourtant contre Rome et surtout contre Louis XIV, nous n’aurions donc eu de pitié jusqu’ici que pour des assassins incendiaires et d’indignation que pour les Villars et les Berwick, chargés de la défense du pays ! Ce serait malheureux, mais cette injustice ne serait peut-être pas sans exemple chez nous.
Quoi qu’il en soit, les camisards battus se rendent bientôt à Londres, d’où l’indifférence publique les ayant chassés, ils refluent sur l’Allemagne et la Suisse dont ils bouleversent toutes les têtes en y déposant le germe de ce fanatisme ardent qui les désole encore aujourd’hui.
Le voyageur Misson est celui qui, dans son Théâtre sacré des Cévennes, a donné le plus de détails curieux sur cette épidémie ; mais comme il en avait épousé la cause, il devient impossible peut-être de s’en rapporter complétement à lui. Remarquons seulement que lorsqu’il revint à Londres, on se demandait partout comment ce Misson, si incrédule à tous ces faits en partant pour l’Italie, était revenu si crédule en Angleterre. [p. 159] La réponse était facile ; c’est qu’il avait passé par la France et qu’ayant vu tous ces prodiges, il en avait fait des miracles.
Le docteur Bertrand, qui veut les juger en médecin et en savant, a donc le plus grand tort de commencer ainsi (p. 355) « quelques paysans, plus fortement affectés que d’autres, ou plus éminemment doués de cette disposition organique qui favorise la production de l’extase… » Qu’on relise attentivement les relations historiques, qu’on remonte jusqu’aux sources, et l’on restera convaincu que, bien loin d’exiger une disposition organique, le véritable début, le mode d’importation était, comme l’a dit l’abbé Grégoire, l’imposition des mains ou bien un souffle qui saisissait d’abord celui qui le recevait, et puis tous ceux qui se le transmettaient. Voilà la vérité. Comment peut-on d’ailleurs expliquer, par un organisme plus ou moins favorisé, une trombe qui brise tout ce qu’elle touche, hommes, femmes, enfants, etc. ? Prenons-y donc bien garde, et ne faisons pas d’un envahissement une question de tempérament, puisque la seule prédisposition était une adhésion morale.
La Revue indépendante de mars 1814 en jugeait plus sainement lorsque, en rendant compte d’un ouvrage publié récemment sur ce sujet par M. Peyrat, protestant, elle s’exprimait ainsi : « A coup sûr un voyageur inopinément témoin de pareilles scènes aurait fort bien pu se croire transporté hors de ce monde, parmi les lutins et les démons. Et ceux qui supposent que les facultés des extatiques ne sont antre chose que l’exagération de celles que présente un homme fortement passionné, nous semblent bien éloignés de la vérité. »
Médecins, n’en doutez plus, ce que la Revue indépendante vient de vous dire, tout le monde vous le redira bientôt. Vous ne satisferez personne, saches-le bien, lorsque, après avoir examiné les faits, vous en tirerez la même conclusion que vos confrères de Montpellier, si plaisamment critiqués par Brueys, auteur contemporain et témoin impartial tant des faits en eux mêmes que de l’embarras qu’ils causaient à toute ta faculté. [p. 160] Le nombre des jeunes prophètes, disait-il, s’étant élevé jusqu’à près de huit mille dans les Cévennes et le Languedoc, M. de Bâville, intendant de la province, ordonna à ces messieurs de Montpellier, qu’on appelle la Faculté de médecine, de s’assembler à Uzès, où l’on avait emprisonné une grande quantité de ces petits enfants, pour considérer leur état. Conformément à cet ordre, les médecins observèrent à leur manière la contenance de ces enfants, leurs extases et les discours qu’ils faisaient sur-le-champ et sans dessein. Je ne sais pas si ces fameux docteurs disputèrent en latin, ni s’ils se battirent, car il y avait matière à s’échauffer ; mais je sais bien que, quoiqu’ils témoignassent être ravis en admiration d’entendre ces jeunes enfants sans lettres prononcer des choses qu’ils n’avaient jamais apprises et citer la sainte Écriture fort à propos, ils décidèrent en oracles fort ambigus, et donnèrent à ces enfants le nom de fanatiques. Cela fut bientôt fait, n’étant pas difficile à faire. »
En effet, pas n’était besoin, pour arriver là, de consulter l’Académie.
Voyons maintenant ce que M. Calmeil pourra nous accorder au nom de la science moderne.
Le voici : « Probablement, dit-il, la première petite troupe de prophètes sortit de la montagne de Peyra, en Dauphiné, et positivement les inspirés étaient maîtrisés par une impulsion maladive… Une fois le discours de l’apôtre protestant terminé, il s’approchait des néophytes qu’il estimait dignes de recevoir le don prophétique, et soufflant dans la bouche de l’un d’eux : Reçois, lui disait-il, le souffle du Saint-Esprit. Tout de suite,
le nouvel élu se mettait à parler comme par inspiration (T. Il,p. 282)… Tous les inspirés étaient pleinement persuadés que le Saint-Esprit s’introduisait dans leur poitrine au moment où ils se sentaient entraînés par une puissance qui les contraignait à prophétiser. (id., p. 228).
Très-bien ; voilà pour nous l’essentiel : adhésion, insufflation, et tout de suite le don prophétique. [p. 161]
Puis viennent les citations des fanatiques eux-mêmes, et, entre autres, celle d’Isabeau Vincent, dite la bergère du Cret, qui, à l’âge de dix-sept ans, avait inoculé à elle seule le don de l’esprit à des cantons tout entiers. « L’analogie, reprend M. Calmeil, qui existe entre l’état où tombait cette inspirée, et l’état où se trouvent la plupart des somnambules artificielles, est frappante (p. 30)… Mais hâtons-nous de déclarer que très-peu de prophètes ou de prophétesses ont offert des crises de somnambulisme aussi parfaites que celles de la bergère du Cret. Le transport prophétique constitue réellement un état pathologique particulier que les camisards savaient très-bien distinguer du somnambulisme naturel, bien différent du somnambulisme artificiel. »
« Ces somnambules (naturels), disaient-ils, parlent et gesticulent comme une personne qui est dans la rêvasserie ; les inspirés, eux, se sentent saisis par une puissance invisible, inconnue, qui s’empare de leur langue, de leurs lèvres, et leur fait prononcer des choses qui ne viennent pas d’eux » (p. 302).
« En résumé, la folie prophétique fit son apparition dans le Dauphiné et dans le Vivarais en 1688 ; elle se répandit bientôt dans une infinité de localités et persista sans interruption parmi les calvinistes, pendant près de vingt années. » (p. 307).
Voilà donc toujours la puissance inconnue, envahissante et possédante bien et dûment établie par M. le docteur Calmeil.
Maintenant passons à un autre adversaire ou plutôt à un autre interlocuteur, puisque nous ne voulons faire ici que de la conversation scientifique et non de la controverse irritante.
Nous avons donc là, sous les yeux, une nouvelle réimpression de la brochure de Misson, portant cette fois pour titre : LES PROPHÈTES PROTESTANTS, et publiée avec une préface et des notes très-curieuses de M. A Bost (29).
Bien loin de faire la guerre à M. Bost comme historien, nous [p. 162] serons heureux de le voir appuyer nos propres récits, et nous croirons très-volontiers avec lui :
« Qu’il était tout aussi difficile à cette multitude de gens sans malice, et n’ayant jamais entendu que le patois, de faire un discours en français, qu’il le serait à un Français qui ne ferait que d’arriver à Londres de parler anglais » (p. 44).
Comme lui, nous ne doutons pas un moment que « la poitrine de quelques adeptes restât en de certains moments invulnérable, comme si elle eût été de fer, aux coups de couteaux les plus pointus, au feu, et même aux balles de fusils déchargés à bout portant. » Nous le croyons, parce que nous allons tout à l’heure retrouver des milliers d’analogues toujours certifiés par la science, même la plus incrédule (p. 65 et 69).
Nous croyons très-fort que « Cavalier n’avait jamais pu regarder une église sans frissonner » (page 92 ).
Qu’Élie Marion avait parfaitement raison lorsqu’il disait :
« Je proteste ici et je déclare, devant l’Être suprême, que je ne suis nullement sollicité ni gagné, ou séduit par qui que ce soit, à prononcer nulles autres paroles que celles que l’esprit ou l’ange de Dieu forme lui-même en se servant de mes organes ; et c’est à lui que j’abandonne entièrement, dans mes extases, le gouvernement de ma langue, n’occupant alors mon esprit qu’à penser à Dieu et à me rendre attentif aux paroles que ma bouche même récite. Je sais que c’est alors un pouvoir étranger et supérieur qui me fait parler. Je ne médite point ni ne connais pas par avance les choses que je dois dire moi même. Pendant que je parle, mon esprit fait attention à ce que ma bouche prononce, comme si c’était un discours récité par un autre, mais qui laisse ordinairement des impressions plus ou moins vives dans ma mémoire » (p. 71).
Comme M. Bost, nous croyons que Clary supporta l’épreuve miraculeuse du feu, et que « toute l’assemblée fut témoin que les flammes, qui s’élevaient beaucoup au-dessus de sa tête, l’environnaient de tous côtés, et qu’il y demeura jusqu’à ce qu’elles fussent éteintes et tout le bois consumé » (p. 117). [p. 163]
Nous croyons très-fort à ces mélodies merveilleuses qui venaient parfois comme du haut des airs (p. i 75). Nous y croyons parce que des mélodies non moins merveilleuses se font entendre à l’heure qu’il est, en 1853, aux États-Unis d’Amérique, et que savants, pasteurs ou magistrats nous l’affirment également.
Nous croyons très-fort aussi « que les papistes atteints de la maladie se mettaient à déblatérer contre la messe et contre Rome, » et nous en prendrons occasion de faire remarquer que ce n’était pas alors par « obéissance à leurs habitudes intellectuelles et spirituelles qu’ils en agissaient ainsi. »
Nous terminerons ici ce très-court exposé ; et, avant d’engager la lutte avec les savants, nous adresserons quelques mots au prosélyte ardent que nous venons de combattre. Qu’il se rassure ; bien que nous soyons catholique, nous ne nous permettrons aucune conclusion du genre de celle que tirait la Revue indépendante, si peu suspecte cependant en fait de catholicisme. Ainsi nous ne dirons pas, comme elle : « que les habitudes de ces chefs à l’œil farouche, à l’air sombre, au poil hérissé, ne quittant la Bible que pour le fusil et le poignard, n’ayant en pensée que la destruction de Babylone, semblaient appartenir plutôt aux aventures d’un chef de bandits qu’à la vie d’un prophète et d’un saint. j (Revue indép., avril 1844.)
Nous ne le dirons pas, parce qu’au fond de toutes ces horribles scènes, nous constatons un entraînement tyrannique. Nous allons plus loin, nous appellerions volontiers les camisards des martyrs de leur foi, quoiqu’ils ne fussent martyrs que de l’erreur, et nous avouerons naïvement avoir été plus d’une fois édifié devant l’expression de ce dévouement, fanatique si vous le voulez, mais aussi complet que désintéressé, qui leur faisait endurer les persécutions et braver la mort la plus terrible pour t cette erreur qu’ils croyaient être la vérité. Tant il est vrai que le fameux argument de Pascal : « J’en crois fort des témoins qui se font égorger, » — argument dont chaque secte et chaque parti aurait pu se servir également — n’a de valeur que comme [p. 164] sincérité de témoignage et comme attestation de faits, mais nullement comme appréciations et comme conclusions doctrinales.
Ainsi, nous, catholique, nous croyons donner à M. Bost un grand exemple de justice et d’impartialité, en rangeant les camisards dans la classe de ces ignorants invincibles, de ces fanatiques de bonne foi, que l’Église elle-même prend tant de soin de distinguer des hérétiques proprement dits, et, sans les juger en théologien, nous sommes sûr de ne pas nous tromper en affinant qu’ils croyaient plaire à Dieu.
Mais nous serons en droit d’exiger la même justice à notre tour. Que M. Bost prenne l’histoire en main, non pas l’histoire écrite au XVIIIe siècle, mais celle qui s’écrivait au XVIIe ; non plus cette fois uniquement celle des catholiques et des protestants, mais celle des hommes impartiaux de cette époque ; qu’il examine et surtout qu’il pèse les suffrages, puis, qu’il nous dise, la main sur la conscience, s’il n’est pas vrai 1° que les prêtres catholiques n’employèrent d’abord, et en général, que les voies de douceur, d’instruction et de persuasion ; 2° que les fanatiques, ou, si l’on veut, les croyants, bouleversèrent tous les esprits dans les provinces dont ils entreprenaient la régénération, et que les choses en étaient venues au point, qu’il n’y avait même plus, où ils étaient, d’administration possible (30).
Quant à la nature de l’agent inspirateur, nous lui demanderons pourquoi ce qu’il appelle le Saint-Esprit de ses coreligionnaires revêt précisément les caractères opposés à ceux du Saint-Esprit des catholiques ? pourquoi, chez les camisards, comme chez tous les sectaires du monde, chez les quakers ou trembleurs, chez les sckakers ou pirouetteurs, chez les spiritains, les anabaptistes, les méthodistes anciens et modernes, etc., nous retrouvons presque toujours cet envahissement du système nerveux, ces contorsions, ces convulsions, ces coups et [p. 165] secousses effrayantes dont nous ne voyons pas la moindre trace dans nos pieuses réunions catholiques ? Pourquoi donc ces dernières sont-elles les seules exceptées ? M. Bost nous répondra sans doute que c’est parce qu’elles ne sont pas visitées par l’esprit, qui les en juge indignes ; mais nous verrons plus loin, lorsque nous en serons à l’analyse, qu’il est embarrassé lui même de ce symptôme exceptionnel, qu’il cherche vainement à étendre à tout le monde ; on le pressera davantage encore en lui demandant pourquoi, même dans ces premiers siècles, où, selon les aveux de sa religion, la sainteté était notre état habituel, rien de semblable ne se faisait observer chez ceux-là mêmes qui voyaient les cieux entr’ouverts ? Il nous semble que ce n’était l’habitude ni des Sébastien, ni des Pulchérie, même au moment de leur martyre, d’être fouettés à terre par l’Esprit, de se rouler dans la poussière, de se tordre comme des démoniaques, en un mot d’offrir tous ces signes extérieurs de désordre que commencèrent à présenter les premiers hérétiques (Montan et les Gnostiques), signes qui servirent avec l’oubli au réveil, c’est-à-dire l’oubli après la crise, à les faire classer sur-le-champ parmi les faux prophètes et les inspirés de l’autre esprit (31). [p. 167]
Nous confierons ces scrupules à la loyauté de ses méditations, et, s’il est juste, nous lui pardonnerons d’avoir terminé par les paroles suivantes un ouvrage qui s’annonçait, nous devons le dire, sous des auspices plus tolérants : « Bien des protestants croyaient que le jésuitisme était mort, mais le boa dormait ; quelques-uns espèrent que l’incrédulité même nous délivrera de la superstition et du despotisme de Rome ; chrétiens, ne vous y fiez pas ! je ne sais quelle combinaison se prépare, mais il se pourrait bien qu’avant peu nous vissions et les impies, et l’Église romaine, et, chose singulière! la grande masse des protestants, se ranger contre les chrétiens qui ne veulent que la Bible, et qui tout d’un coup se verront seuls. (p. 189).
Plaise à Dieu ! plaise à Dieu ! car si les impies et la grande masse des protestants font jamais cause commune avec l’Église romaine, vous ne voudrez pas rester tout seul, monsieur Bost, et nous fraterniserons tous avec bonheur, fût-ce dans les replis du boa (32).
Continuons notre exposé ; nous passerons tout à l’heure aux analyses.
III.
Les convulsionnaires de Saint-Médard. — En dépit des deux vers de Voltaire, « ces faits merveilleux
furent attestés et prouvés immédiatement sur les lieux, devant des juges parfaitement intègres ;
on ne peut rien opposer à cette nuée de témoins. » (David Hume.)
Les siècles se succèdent, les événements se rapprochent et les mêmes causes, toujours subsistantes, soulèvent de temps en temps le rideau du théâtre pour rajeunir ces drames trop connus, sous de nouveaux noms et de nouveaux décors qui donnent facilement le change à nos souvenirs et à notre ignorance.
Nous voici donc arrivés à l’épidémie modèle, à celle que le XVIIIe siècle a le plus complétement travestie, et que deux mauvaises rimes (il n’en faut pas davantage en France) ont fait ranger incontinent parmi les fables et les roueries (33). [p. 168]
Cette fois-ci, cependant, pour ceux qui regardaient d’un peu près, les embarras étaient inextricables, parce que l’évidence de ces faits était par trop éblouissante, et que, selon la remarque de M. le docteur Calmeil, « la population tout entière de Paris était là pour affirmer les plus étranges. » (T. II, p. 373).
Comprenez dans cette population les médecins les plus rebelles, les historiens les plus graves, les magistrats les plus rigides, les personnages les plus haut placés, et vous serez contraints de reconnaître que Saint-Médard est l’enclume formidable sur laquelle viendront toujours se briser les dénégations du rationalisme le plus obstiné. Que faire, que dire, qu’opposer à des milliers de faits attestés, signés par des hommes comme Rollin, Folard, La Condamine, Toussaint, Hume lui-même, etc. ? Rien, absolument rien qui vaille, comme dit Bayle. Il ne reste donc plus qu’à se résigner, qu’à bien examiner ces faits, à ne pas les mutiler surtout, puis à mûrement analyser les théories proposées, si toutefois une seule d’entre elles peut mériter cet honneur.
Voyons d’abord ces faits (34).
Le diacre Pâris, mort en protestant avec énergie contre la bulle Unigenitus qui condamnait les jansénistes, avait été [p. 169] inhumé au petit cimetière de Saint-Médard. Ses coreligionnaires se portèrent en foule sur sa tombe, y prièrent avec ferveur, et bientôt proclamèrent l’apparition d’un premier miracle, qui fut promptement suivi de beaucoup d’autres. Toujours est-il que, selon le docteur Calmeil lui-même, « les pathologistes purent approfondir avec un intérêt mêlé d’étonnement la cause des guérisons presque toujours désespérées qui s’effectièrent en assez grand nombre sur ce tombeau et sur celui de quelques fervents jansénistes. » (p. 314).
Plusieurs de ces miracles » (prenez-y garde, Messieurs, en ce moment c’est David Hume, l’incroyance incarnée, qui vous parle), « plusieurs de ces miracles furent prouvés immédiatement, sur les lieux, devant des juges d’une intégrité indubitable, et attestés par des témoins accrédités, par des gens de distinction, dans un siècle éclairé, et sur le théâtre le plus brillant qu’il y ait actuellement dans l’univers …. Où trouver ailleurs une aussi prodigieuse quantité de circonstances qui concourent pour la confirmation d’un fait, et qu’opposer à cette nuée de témoins, si ce n’est l’impossibilité absolue de nier la nature miraculeuse des événements qu’ils attestent (35) ? »
Vous voyez que nous ne choisissons pas nos autorités parmi les jésuites.
Écoutons à présent la description que M. le docteur Calmeil va nous en faire, d’après le médecin Hecquet et l’historien Dulaure.
« La plupart des sujets, dit-il, que la gravité de leurs maux engageait à se rendre au cimetière de Saint-Médard, avaient à peine senti le contact du marbre de Pâris, que leurs membres étaient agités de mouvements tumultueux (36). Tantôt, le patient en était quitte pour un accès convulsif déterminé par [p. 170] chaque nouveau pèlerinage à Saint-Médard ; tantôt il éprouvait une série d’accès dans l’espace de quelques heures. Le sol du cimetière était disputé par une multitude de filles, de femmes, d’infirmes, d’individus de tout âge qui se débattaient dans les convulsions. On rencontrait des convulsionnaires dans les rues voisines du cimetière, dans les cabarets où ils allaient chercher des rafraîchissements ; plusieurs femmes éprouvaient ensuite dans leurs familles de nombreux accès de convulsions (p. 325). Au bout de quelques mois, le chiffre connu s’élevait à huit cents. »
Un des premiers faits que signale M. Calmeil est celui-ci, et nous l’enregistrons parce qu’il offre une circonstance toute spéciale.
« Le 20 septembre 1734, la veuve Thévenet, espérant se débarrasser d’une surdité incomplète, se décide à boire et boit de l’eau tenant en suspension quelques molécules terreuses provenant de la fosse de Pâris… puis, elle commence une neuvaine en l’honneur du feu diacre. Le 29, elle entreprend une seconde neuvaine en invoquant Pâris. Les nuits suivantes elle se sent agitée, émue, en proie à un saisissement et à une frayeur extraordinaire… Le 1er or octobre, la malade annonce qu’il se passe en elle des choses étranges ; le 2, pendant une messe à laquelle elle assiste, elle perçoit dans toute son organisation une perturbation indéfinissable qui l’oblige à sortir dans un jardin où sa tête commence à être secouée sans la participation de sa volonté… Un frère de cette femme, chanoine à Corbeil, s’épuise en efforts superflus pour l’empêcher de se frapper…. Dans certains moments, elle fait des sauts violents comme pour s’élever jusqu’au plafond ; le désordre de ses vêtements prouve qu’elle méconnaît tous les sentiments de la pudeur… Les mots qu’elle prononce n’appartiennent à aucune langue connue… Mme***, s’étant mise à genoux, [p. 171] récite une oraison à Pâris, pendant laquelle la dame Thévenet, devenue encore plus furieuse…, sort du lit, et se met à sauter s’élevant à peu près jusqu’à la hauteur du plancher… , et ses deux seins, sortant de son corps, tournaient d’eux-mêmes et s’entortillaient, comme si quelqu’un les eût tordus avec la main… Vers une heure après minuit, la servante, entendant toujours des hurlements dans la chambre de la convulsionnaire, regarde par la fenêtre, et voit ces deux femmes en chemise, riant et jetant leurs bonnets de côté et d’autre.
« Pendant la nuit du 3 au 4 octobre, on crut que la veuve Thévenet allait expirer… Le 4, craignant une fin prochaine, elle supplie le chanoine Mariette, son frère, de la confesser… A peine eût-elle commencé à accuser ses péchés, que les convulsions deviennent plus intenses… Mais le mardi 5, le prêtre ayant dit à dessein que c’étaient là des mystères de Satan, la veuve Thévenet tombe dans les attaques les plus terribles. Le soir, elle consent cependant à remettre à son frère un manuel de piété (37), dont la lecture provoquait aussitôt le retour des paroxysmes convulsifs, et la nuit du 4 au 5 est exempte d’agitation .
« Le mardi 5 octobre, son frère le chanoine lui ayant fait des représentations sur son affreux état, elle se rend complétement. En présence de son confesseur janséniste…, elle remet à son frère le portrait du diacre Pâris, deux paquets de terre de son tombeau, un morceau de bois de son lit, qu’on jette au feu ; puis elle fait profession de foi à l’Église catholique…, et elle n’éprouve plus ni agitation, ni mouvement convulsif, ne conservant qu’un esprit sain. » (p. 329).
M. Calmeil n’a pas craint de puiser ces détails dans le Père Lataste. Voici ce qu’il ajoute sur cette dévote, dont la conduite et la moralité avaient toujours passé pour irréprochables, et qui constitue, dit-il, au point de vue de la science, une des observations les plus intéressantes de Saint-Médard : [p. 172]
« Le 6 octobre, un sentiment de répulsion terrible enchaîne encore sa volonté quand elle cherche à franchir le seuil du saint lieu (l’église), où elle était attendue… Il fallut recourir encore à des aspersions d’eau bénite pour soutenir son cou rage … (p. 329).
« On trouve réunis ici, dit M. Calmeil, tous les signes de l’hystérie, de l’extase, de la nymphomanie, de la théomanie, et une partie des accidents propres à la démonopathie » (p. 330).
Passons maintenant à une seconde observation : « La conversion du secrétaire des commandements de Louis XV au jansénisme s’annonça par un singulier genre d’agitation musculaire… Ce personnage, nommé Fontaine, très-opposé jusque-là, comme toute la cour, à la cause des appelants (38), étant à Paris au commencement de 1733, dans une maison où on l’avait invité à diner avec une grande compagnie, se sentit tout à coup forcé, par une puissance invisible, à tourner sur un pied avec une vitesse prodigieuse, sans pouvoir se retenir, ce qui dura plus d’une heure sans un seul instant de relâche. Dès le premier instant de cette convulsion si singulière, un instinct qui venait d’en haut lui fit demander qu’on lui donnât au plus vite un livre de piété. Celui qu’on lui présenta fut un tome des Réflexions morales, du Père Quesnel, et quoique Fontaine ne cessât pas de tourner avec une rapidité éblouissante, il lut tout haut dans ce livre tant que dura sa convulsion » (p. 332) .
« Cette convulsion continua pendant plus de six mois… Elle lui prenait tous les jours à neuf heures et durait une heure et demie et deux heures de suite… Un grand nombre de personnes ont compté jusqu’à 60 tours par minute… Dans l’après midi, Fontaine se sentait une force et un état de santé parfaits jusqu’au lendemain matin. (39) (p. 333). [p. 173]
M. Calmeil fait suivre ce récit des réflexions suivantes : « Quand l’espèce d’entraînement qui obligea Fontaine à tourner sur un pied commença à agir sur lui, on mit entre ses mains un livre de Quesnel. Il est donc probable que Fontaine se trouvait à diner avec de fervents jansénistes, et l’on peut présumer avec quelque vraisemblance qu’on avait parlé avec enthousiasme devant lui des convulsions et des miracles… Quoi qu’il en soit, le cerveau du secrétaire de la cour subissait en ce moment une modification fâcheuse » (p. 333). En effet, très fâcheuse, car, à la suite d’une pareille initiation, nous voyons Fontaine se livrer à toutes les austérités possibles, « entre autres à des jeûnes de dix-huit jours sans manger, et enfin de quarante jours pendant lesquels il ne se permit que de boire » (p. 335). A ce point que ce ne fut plus bientôt « qu’un squelette couvert d’une peau sèche et livide » (p. 337) .
« Tout cela, dit M. Calmeil, dut, il faut en convenir, produire une grande impression sur l’imagination des partisans du miracle. »
Ensuite, venait, chez les convulsionnaires, le fameux état de mort, qui durait deux ou même trois jours, et pendant lequel l’insensibilité devenait absolue.
Puis les improvisations dans lesquelles le Tout-Puissant leur faisait développer, de la manière la plus lumineuse, l’importance des vérités condamnées par la bulle, car cette bulle du pape, la bulle Unigenitus, était toujours l’ennemi, le delenda Carthago.
Reprenons. »Tous les observateurs s’accordent donc à [p. 174] confesser que le souffle de l’inspiration prophétique gourmanda plus d’une fois l’esprit des convulsionnaires jusque dans leurs accès de véritables extases » (p. 347).
« Quelques malades récitaient les prières les plus ordinaires sur le ton de l’inspiration, et le dérèglement de leur imagination donnait souvent à cet acte de piété toute l’apparence d’un acte de dérision ou de scandale. Une convulsionnaire, dit un auteur, récite le De profundis en français avec une piété affectueuse qui édifie, mais, avant que de le réciter, elle veut qu’on lui mette la tête en bas, les pieds en haut et le corps en l’air…, ce qui représente, déclare-t-elle gravement, que tout est renversé dans l’Église » (p. 350).
« Une convulsionnaire, surnommée l’Invisible, chantait les louanges de Dieu en faisant la culbute… Poncet en a vu une qui faisait ses prières en tirant la langue comme une possédée, et dont le visage était décomposé par d’horribles contorsions. » (lb.)
« Plusieurs théomanes parlaient comme si les lèvres, la langue, tous les organes de la prononciation eussent été remués par une force étrangère… Quelques-uns entendaient sortir de leurs poumons une voix autre que la leur ; ils se comparaient à un écho ou à une personne qui ne dicte que ce qu’elle entend dicter » (Id.)
« Les convulsionnaires qui entendaient dicter les termes de leur discours, fait observer M. Calmeil, soit intérieurement, soit en dehors de l’oreille, ressemblaient à la plupart des somnambules, ou à nos halluciné » (354).
Enfin nous voici parvenus à l’effroyable chapitre des grands secours, ce summum des inventions démoniaques, dont le récit soulève l’indignation et resterait au bout de la plume s’il ne nous paraissait indispensable à l’entière démonstration de la vérité.
« Quelques convulsionnaires allaient jusqu’à se faire étendre et lier avec des cordes sur des croix de bois. Plusieurs d’entres elles, assure-t-on (c’est Dulaure qui parle en ce moment, [p. 175] LVII, p. 436, et le célèbre chirurgien Morand, de l’HôtelDieu, affirme en avoir vu trois exemples), se firent traverser les pieds et les mains par d’immenses clous de fer, qui allaient ensuite se fixer dans les branches et dans l’arbre de la croix, et, pendant cette espèce de martyre, elles trouvaient la résignation nécessaire pour admonester les assistants. D’autres se faisaient percer la langue et larder les chairs avec des épées… Ces tableaux, disait-on, faisaient ressortir la laideur du péché, qui n’avait pu être expié que par la souffrance d’une chair divine. »
Nous avons bien soin de le répéter, c’est l’historien Dulaure qui parle ici et qui parle D’APRÈS LE CÉLÈBRE CHIRURGIEN DB L’HÔTEL-DIBU, témoin oculaire.
Mais tout ceci se conçoit encore, parce que, à la rigueur, le fanatisme et son courage peuvent en expliquer une partie ; mais voici ce qui ne se conçoit plus du tout, parce que toutes les lois de la physique s’y trouvent bouleversées de fond en comble.
« On a dit avec raison que ces théomanes se seraient fait ouvrir tout vivants, si l’idée qu’un pareil martyre pût être agréable à l’Être suprême se fût, par hasard, offerte à leur imagination. Ce ne fut pas sans quelque surprise néanmoins qu’on les vit, dans le principe, courir par différents motifs, après les plus effrayantes tortures corporelles. Se serait-on résigné (dit toujours M. Calmeil) à croire jamais, SI LA POPULATION TOUT ENTlÈRE DE PARIS NE L’EUT AFFIRMÉ, que plus de cinq cents personnes du sexe aient poussé la rage du fanatisme, ou la perversion de la sensibilité, au point de s’exposer à l’ardeur du feu (40), de se faire presser la tête entre des planches, de se faire administrer sur l’abdomen, sur les seins, sur l’épigastre, [p. 176] sur toutes les parties du corps, des coups de bûche, des coups de pied, des coups de pierre, des coups de barre de fer ? Les théomanes de Saint-Médard affrontaient pourtant ces épreuves… tantôt pour démontrer que Dieu les rendait invulnérables… tantôt pour prouver que des coups, habituellement douloureux, ne leur procuraient que de douces jouissances » (p. 373).
Habituellement douloureux est bien dit, car on estime que près de quatre mille enthousiastes firent emploi de leurs forces, pour piétiner, pour frapper sans relâche, des infirmes et de toutes jeunes filles, qui imploraient la violence de leurs coups.
Mais, avant d’essayer d’en donner une idée, nous sentons qu’il est nécessaire de remonter aux autorités historiques, à cette masse de témoignages assez irrésistibles pour avoir pu forcer à ce point l’incrédulité moderne et l’avoir condamnée à enregistrer et discuter de pareils faits.
Laissons donc pour un moment MM. Calmeil et Bertrand, et appelons-en à d’autres noms, pour compléter notre exposé.
Empruntons nos derniers traits au grave magistrat Carré de Montgeron, et faisons-nous-le garantir par la parole peu crédule de Diderot : « Nous avons, dit celui-ci, de ces miracles prétendus un vaste recueil qui peut braver l’incrédulité la plus déterminée. L’auteur, Carré de Montgeron, est un magistrat, un homme grave qui jusque-là faisait profession d’un matérialisme assez mal entendu, il est vrai, mais qui du moins n’attendait pas sa fortune de sa conversion au jansénisme. Témoin oculaire des faits qu’il raconte, et dont il a pu juger sans prévention et sans intérêt, son témoignage est accompagné de mille autres. Tous disent qu’ils ont vu, et leur déposition a toute [p. 177] l’authenticité possible : les actes originaux en sont conservés dans les archives publiques (41. »
Le grand Dictionnaire des sciences médicales, dans un article signé par un savant physiologiste, le docteur Montègre, cautionne ainsi le même auteur : « Carré de Montgeron entoura ces prodiges de témoignages si nombreux et si authentiques, qu’il ne reste, après les avoir examinés, aucun doute à former… Quelle que soit ma répugnance pour admettre de semblables faits (et l’on sait qu’elle est grande en général chez les médecins), il ne m’a pas été possible de me refuser à les recevoir. » (Art. CONVULSIONS.)
Le docteur Montègre a raison, car, si ces faits étaient faux, attestés comme ils le sont, c’en serait fait à jamais du témoignage, et nous ne comprendrions plus, pour notre part, ce que signifierait dans le cours ordinaire des choses l’attestation d’un médecin, d’un savant, d’une académie, à plus forte raison l’institution du jury, etc. Sur toutes les questions, il n’y aurait plus qu’à se croiser les bras, et à douter même de sa propre existence.
Voici donc ces derniers faits garantis par le Dictionnaire des sciences médicales.
« Jeanne Moulu, jeune fille de vingt-deux à vingt-trois ans, étant appuyée contre la muraille, un homme des plus robustes prenait un chenet, pesant, dit-on, de vingt-cinq à trente livres, et lui en déchargeait, de toute sa force, plusieurs coups, toujours dans le ventre ; on en a compté quelquefois jusqu’à cent et plus. Un frère, lui en ayant donné un jour soixante, essaya contre un mur, et on assure qu’au vingt-cinquième coup, il y fit une ouverture. Ce fut en vain, dit Carré de Montgeron, que j’employais tout ce que je pouvais rassembler de forces… La convulsionnaire se plaignit que mes coups ne lui procuraient aucun soulagement et m’obligea de remettre le chenet entre les mains d’un grand homme fort vigoureux qui se trouvait parmi [p. 178] les spectateurs. Celui-ci ne ménagea rien. Instruit par l’épreuve que je venais de faire, il lui en déchargea de si terrible., toujours dans le creux de l’estomac, qu’ils ébranlaient le mur contre lequel elle était appuyée. La convulsionnaire se fit donner tout de suite les cent coups qu’elle avait demandés d’abord, ne comptant pour rien les soixante qu’elle avait reçus de moi… Je repris et voulus essayer contre un mur, si mes coups, qu’elle trouvait si faibles, et dont elle se plaignait si amèrement, n’y produiraient aucun effet. Au vingt-cinquième coup, la pierre sur laquelle je frappais acheva de se briser. Tout ce qui la retenait tombait de l’autre côté du mur et y fit une ouverture de plus d’un demi-pied de large. Lorsque le chenet s’enfonçait si avant dans l’estomac de la convulsionnaire qu’il paraissait pénétrer jusqu’au dos, elle s’écriait avec un air de contentement peint sur son visage : Ah ! que cela est bon !… Ah ! que cela me fait du bien ! Courage, mon frère, redoublez encore de forces, si vous pouvez… Les coups assommants du chenet frappaient d’abord sur la peau, mais sans y faire la plus légère meurtrissure.
Suivait l’exercice de la planche. « La convulsionnaire se couchait à terre, mettait une énorme planche sur elle, et faisait monter sur cette planche une vingtaine de personnes, équivalant au moins à un poids de quatre milliers. Elle trouvait encore que cela ne pesait pas assez.
Puis venait l’exercice du caillou de vingt-deux livres, « que l’on déchargeait à tour de bras, et cent fois de suite, sur le sein de la convulsionnaire. A chaque coup toute la chambre était ébranlée, le plancher tremblait, et les spectateurs ne pouvaient s’empêcher de frémir, en entendant le bruit épouvantable que les coups faisaient sur le sein. »
« Quelqu’un ayant fait le récit de ces effroyables secours à un grand physicien, celui-ci soutint que les faits ne pouvaient être vrais, parce qu’ils étaient physiquement impossibles…On lui laissa tranquillement faire ses démonstrations, et à la fin on lui dit : « Venez voir. » Il y court. Saisi d’étonnement, il [p. 179] demande que ce soit lui-même qui administre le secours. On lui met aussitôt dans les mains les instruments de fer les plus forts et les plus assommants. Il ne s’épargne pas ; il frappe avec la dernière violence. Il enfonce dans les chairs l’instrument de fer dont il est armé, il le fait pénétrer jusqu’au fond des entrailles. Cependant la convulsionnaire rit de tous ses vains efforts. Tous les coups qu’il lui porte ne servent qu’à lui faire du bien, sans laisser la moindre impression, la moindre trace, le moindre vestige, non-seulement dans les chairs, mais même sur l’épiderme de la peau.
« La Salamandre (celle qui restait couchée au travers du brasier) se mettait encore en arc renversé, la tête et les pieds posant à terre, et les reins soutenus en l’air par un pieu des plus aigus. Puis, au moyen d’une poulie, on laissait tomber à plusieurs reprises sur son estomac, et du plafond de l’appartement, une pierre pesant cinquante livres, ses reins portant toujours sur la pointe. La peau ni la chair n’ont jamais reçu la moindre atteinte. »
« Une autre, du bourg de Méru, diocèse de Beauvais, assise à terre, le dos contre un mur, se fait donner dans le creux de l’estomac jusqu’à deux mille coups de pieds de suite. Elle prend une broche à rôtir, la plus forte qu’elle peut trouver, elle en place la pointe dans le creux de son estomac ou entre ses fausses côtes ; elle la fait ensuite pousser contre elle par quatre, cinq ou six personnes, de toutes leurs forces, en sorte que ces broches plient souvent ou se faussent... De même à sa gorge, à son front… Enfin, depuis deux mois elle se fait donner des coups d’épée par tout le corps ; quoique sa peau plie sous les pointes, et qu’il y reste quelquefois une petite marque rouge, néanmoins la chair n’en est jamais percée. (Dict. des se. méd.).
Nous ne savons pourquoi M. Calmeil n’a pas voulu rapporter ce dernier fait. Lui parait-il donc moins certifié que tous ceux qu’il accepte ? Nous ne le pensons pas, car, parmi les vingt et un témoins acteurs qui ont signé ce procès-verbal, on remarque des personnages de la plus haute distinction, tels que [p. 180] milord de Perth, maréchal de camp, M. le comte de Novion, des magistrats, des officiers du roi, des ecclésiastiques, etc., etc. Lui paraît-il trop inacceptable ? Allons donc ! quand on rapporte celui du physicien faisant pénétrer le fer jusqu’au fond des entrailles, sans pouvoir laisser le moindre vestige, même sur la peau (p. 377), quand on a accepté l’épreuve du caillou de cinquante livres, les crucifiements, l’épreuve du brasier, etc., etc., comment regarde-t-on encore à quelque chose ?
« M. H…, tout luthérien qu’il est, m’a attesté, dit le célèbre Caraccioli, avoir été conduit, au mois de septembre dernier, dans une maison de secouristes, et y avoir déployé toutes ses forces pour pouvoir faire entrer son épée dans tous les endroits d’un corps vivant, sans avoir pu jamais en venir li bout. Il m’a ajouté que MM. de LA CONDAMINE et TOUSSAINT, personnages qui ne sont pas gens à croire au hasard, avaient tout examiné avec la plus sérieuse attention, et qu’ils étaient demeurés convaincus du surnaturel, même au point d’en être effrayés. Ils virent tous clouer la main d’une femme, et le clou qui passait au travers ; et aussitôt la plaie toute couverte de sang se referma et ne parut qu’une simple cicatrice de trois mois. Mais qu’ai-je besoin de ce témoignage ? Je connais plus de mille personnes, dignes de toute croyance, qui m’ont assuré le même fait, avec des circonstances si extraordinaires, qu’en me les rappelant je m’imagine quelquefois rêver. »
Ainsi donc, les jansénistes, les jésuites et de grands savants tombent parfaitement d’accord sur la réalité des faits et sur leur surnaturel. Les médecins modernes avouent aussi les faits, et font pour les expliquer naturellement des efforts surhumains… et complètement inutiles, nous allons le prouver tout à l’heure. Les magnétiseurs seuls, et à leur tête le savant docteur Bertrand, revendiquent tous ces faits pour leur agent extatique et mystérieux, et jusqu’à ces derniers temps n’y voyaient que l’action d’un fluide.
Tous se trompaient étrangement. Le Dictionnaire des sciences médicales ne laisse pas échapper non plus cette identité [p. 181] des faits magnétiques avec tous ceux que nous venons de rapporter. Commençant par admettre la réalité des faits les plus bouleversants, le docteur Montègre avoue franchement qu’il ne peut les refuser, parce qu’ils ne lui paraissent pas moins prouvés que tous les autre . Ce sont, dit-il, les mêmes témoignages, et les faits sont d’ailleurs ici bien autrement clairs et précis. Il s’agit moins de guérison que de faits apparents et extérieurs, sur lesquels il ne peut s’élever la moindre équivoque. »
Voilà ce qu’on appelle de la franchise et de la logique.
« Les phénomènes du magnétisme, reprend-il, et ceux que présentent les possessions et fascinations, se rattachent à ceux qui caractérisent les convulsionnaires, non-seulement par la ressemblance la plus complète, mais encore par la cause qui les détermine. Il n’est pas un seul phénomène observé chez les uns qui ne se retrouve chez les autres. »
D’accord ; mais les faits sont entendus : passons maintenant aux théories qu’on en donne.
IV.
Théories névropathiques proposées à ce sujet. —Analyse et discussion.
A présent que ces faits, appuyés, dit-on, sur les autorités les plus juridiques, sur les attestations les plus sacrées, sont acceptés paf les manigraphes les plus difficiles, nous pouvons, encore une fois, suivre le conseil de Bayle et ne plus nous occuper de ces dénégateurs obstinés qu’il déclare, quelque part, « indignes même d’une réponse ; »
Laissez-nous, leur dirons-nous, laissez-nous nous entendre ou nous débattre avec ces savants de bonne foi, qui s’avouent subjugués par ces nuées de témoins, et qui comprennent parfaitement que la science elle-même n’aurait plus qu’à se voiler et à s’envelopper dans son manteau, si la puissance du témoignage devait s’écrouler à ce point-là. [p. 182]
Il ne s’agit donc plus avec eux que d’une discussion en famille et en petit comité sur des bases acceptées à l’avance.
Commençons par ne pas nous inquiéter beaucoup des théories du docteur Bertrand, qui se réduisent en définitive à expliquer l’extase par l’extase, car ce n’est pas l’expliquer autrement que de dire avec lui : « L’homme est susceptible de tomber dans un état particulier… que l’on peut désigner sous le nom d’extase ; cet état, le même qui s’observait chez les possédés des siècles précédents… n’est pas une maladie proprement dite… Une exaltation morale portée au plus haut degré y prédispose éminemment… et cet état ne cesse de se reproduire journellement sous nos yeux dans les traitements des magnétiseurs, où il se maintient ignoré ou méconnu de nos savants depuis quarante ans. (p. 474).
Bertrand donne ici le signalement de la GRANDE PUISSANCE, mais c’est un passe-port bien incomplet, celui qui n’oublie que le lieu de la naissance et le nom du voyageur qui en est muni.
Ce n’est pas non plus expliquer cette puissance que de l’attribuer, avec le docteur Montègre et le Dictionnaire des sciences médicales, « à l’influence réciproque du moral sur le physique, car enfin ce n’est pas précisément du moral que cette broche qui ne peut même effleurer l’épiderme d’un estomac, dans lequel cinq ou six vigoureux gaillards s’efforcent de l’enfoncer.
Cherchons ailleurs. On a beaucoup vanté le docteur Becquet, témoin des faits de Saint-Médard, et auteur d’un traité fort estimé jadis sur leur naturalisme.
Voyons-le. « Cette contagion, dit-il, avait lieu par voie d’ondulations d’une personne à l’autre… Ainsi, d’une part, les esprits agités et vivement poussés à l’habitude du corps dans la convulsionnaire vont se heurter contre la peau du spectateur, et par là imprimer dans les esprits qui y sont une sorte de trémoussement… » (p. 39)_
Et plus loin, après avoir dit que « c’est un esprit qu’il y a à [p. 183] examiner, il nous explique, sans esprit, le support des poids démesurés, « par la vertu systaltique des solides qui s’accroît alors, pour se soumettre les fluides soulevés contre les solides. (p. 56). « L’infatigabilité (sic) aux milliers de coups de bûche et de barres de fer, assenés par des hercules dans le creux de ces estomacs de jeunes filles, s’explique par le parallélisme des fibres, etc. » Quant aux hurlements, il les explique par l’histoire de Nabuchodonosor ; la divination, par l’antre de Trophonius ; les postures impossibles, par ce possédé qui marchait à la voûte d’un temple, la tête en bas, etc. »
Assez, assez ! Et c’est là l’homme que M. le docteur Dubois (d’Amiens) nous citait, dans son ouvrage sur le magnétisme, comme ayant établi le naturalisme des convulsions !…
Écoutons maintenant le célèbre docteur Foderé, que de sérieux travaux sur la pneumatologie médicale auront peut-être rendu plus clairvoyant.
Après avoir narré les principaux faits de Saint-Médard, « c’est, dit-il, avoir montré bien peu de critique (mieux que cela), que d’avoir attribué ce délire de convulsions uniquement à l’érotomanie, comme le fait le docteur Hecquet, ou à l’action des jésuites, comme le fait M. Dulaure, puisque ce ne furent pas seulement des jeunes filles qui en furent attaquées, et qu’il fut partagé par des personnages graves et éclairés d’ailleurs.
A merveille, mais qu’est-ce donc à vos yeux ? « Celle explosion gigantesque de névroses pourrait bien tenir à une maladie du bas-ventre, les borborygmes, les vers, etc. » Quoi ! des centaines de personnes de tout âge et de tout sexe, attaquées subitement et par le simple contact d’un marbre, de maladies vermineuses, et devenant aussitôt des thaumaturges de premier ordre ! « Oui, dit le docteur Foderé, c’est une altération du sens interne, dont les fausses notions viennent d’une perversion naturelle des milieux mandants et des sens recevants. »
Comprenez-vous, Messieurs ? Quant à nous, notre sens interne ne nous révèle rien sur tous ces milieux. [p. 184]
Et M. Foderé nous parait d’autant plus inexcusable que son érudition lui fournissait une foule d’analogues sur lesquels il pouvait s’appuyer, et qu’il semble même, en certain endroit, adopter complètement l’explication donnée par Jamblique dans ses Mystères égyptiens, à propos de phénomènes tout semblables. « Leurs actions, disait ce gnostique, ne sont pas de l’homme, car ils passent partout sans qu’on les voie. Ils prédisent l’avenir et sont agités diversement suivant le dieu qui les inspire. De là, les uns se meuvent avec rapidité, ou de tout leur corps ou de quelques-uns de leurs membres… Il en est qui paraissent transportés dans les airs, d’où ils retombent ensuite… Leur âme semble se reposer, et UN DIEU EN AVOIR PRIS LA PLACE. » Encore une fois, monsieur Foderé, il ne faut pas commencer par cette dernière théorie et la citer avec éloges, lorsque l’on veut lui substituer, à quelques pages de là, celle des principes principiants et des maladies vermineuses.
Voyons donc enfin si nous serons plus heureux avec M. le docteur Calmeil, qui, venu le dernier, pourrait ou plutôt devrait être mieux inspiré. Voyons comment il va se tirer du mauvais pas dans lequel sa consciencieuse loyauté l’a forcé de s’engager.
Commençons par ce groupe de phénomènes qui caractérisent, selon lui, l’hystéro-démonopathie. « Assez souvent, dit-il, on voit encore à présent la lésion des sentiments religieux s’associer à la lésion des sens et à la perversion des mouvements volontaires ; les hallucinations qui font croire à l’obsession diabolique, les tressaillements spasmodiques, les contractions musculaires disharmoniques, les convulsions générales momentanées, forment quelquefois encore aujourd’hui le cortège de l’aliénation religieuse affective. (T. I. p. 58). Plus loin, il dit encore : « La démonomanie et la démonopathie sont une variété de monomanie et un genre d’aliénation. » Nous allons voir ce qu’il en est, et nous n’oublierons, monsieur Calmeil, ni le principe posé par tous vos collègues, que [p. 185] ce n’est pas l’hallucination, mais bien la confiance absurde dans l’hallucination, qui constitue le commencement de la folie ; ni celui que vous posez vous-même en cent endroits, que ces malheureux ne pouvaient pas ne pas croire à une théorie forcément partagée alors, non-seulement par tout le clergé, mais encore paroles médecins les plus distingués. Donc, si personne alors ne pouvait n’y pas croire, non-seule ment il n’y avait pas folie à le croire, mais il n’y avait même pas déraison.
Commençons notre triple examen par Loudun, et prenons un fait au hasard. Lorsque la sœur Sainte-Agnès adjurée devant le duc d’Orléans d’adorer le saint-sacrement (après avoir, dites-vous, passé son pied derrière la tête jusqu’au front, en sorte que les orteils touchaient quasi le nez), eut proféré, tout en obéissant, ses épouvantables blasphèmes… le duc lui demanda, incontinent après la crise, si elle avait quelque souvenance. « De quelques choses, répondit-elle, mais pas de toutes ; quant aux réponses sorties de ma bouche, je les ai ouïes comme si un autre les eût proférées » (p. 27).
On n’a pas manqué de crier à l’imposture ; mais, comme vous le dites fort bien, « cette religieuse n’en imposait pas, seulement elle ne pouvait pas savoir que c’était un effet de sa maladie… dans certaines affections nerveuses, la personne qui parle croyant entendre parler une autre personne par sa bouche » (Ibid.). Eh ! voilà précisément la question, monsieur Calmeil. Voilà, répétons-le toujours, ce qui fait que notre fille est muette, et que cependant elle parle ! Mais, de grâce, pourquoi cela se passe-t-il ainsi dans cette classe d’affections nerveuses, selon vous, toutes différentes des autres ? Y-a-t-il alors dédoublement du moi, comme le pensent encore beaucoup de psychologistes, ou véritablement y a-t-il deux êtres en un seul ? Nous avouons naïvement que lorsque l’un de ces deux êtres, tout en parlant latin, grec, hébreu, toutes les langues enfin, y compris celles des sauvages, blasphème, renie et cabriole, pendant que son associé n’a jamais su qu’adorer, prier, s’agenouiller [p. 186] et parler bon français, nous nous décidons pour la seconde hypothèse .
A un autre. Lorsque l’abbesse, madame de Sazilli, cette femme supérieure que vous vengez si justement, reçut aussi de l’exorciste l’ordre d’aller baiser le pied du ciboire, et qu’après avoir roulé par la chapelle, et fait plusieurs extensions de jambes, telles qu’elle touchait du périnée contre terre, elle s’en alla rampant, et la langue énorme et pendante, obéir avec cris et tremblement, vous nous dites : « L’exorciste provoque ici, et à son insu, la catalepsie, les convulsions hystériques… Aujourd’hui, la puissance magnétique détermine une partie de ces effets. Mais maintenant, nous voici tout en peine de l’exorciste. Ce n’est plus la possédée qui nous occupe, c’est le guérisseur, Où ce malheureux a-t-il pris cette effroyable puissance magnétique de faire hurler les gens, et de les faire se tordre et obéir en blasphémant ? Encore une fois donc, qu’est-ce que cette puissance magnétique, dont vos confrères se moquent, à laquelle d’ailleurs vous croyez à peine, et que vous vous gardez bien de définir ? Décidément nous n’avançons guère ; seulement vous convenez qu’alors madame de Sazilli agissait sans la participation de sa volonté, ou sous l’empire d’une volonté pervertie par la maladie r (p. 29). C’est toujours bon à se rappeler.
Toujours est-il que c’est une maladie ; mais qu’est-ce que celte maladie ? Contagion nerveuse, répondez-vous, ou mieux, hystéro-démonopathie, Ce n’est pas là la question. Quelle était la nature de cet agent épidémique et contagieux ? car, vous le savez mieux que nous, il y a toujours derrière ces deux mots, ou plutôt, malheureusement, ces deux choses, un principe, un agent, un divinum quid, un τό θεἳον. Or nous croyons que nous sommes précisément ici dans ce dernier cas, que c’est là le sens de cette expression d’Hippocrate qui vous a fait enfanter tant de volumes. Oui, τό θεἳον, autrement dit, surhumain ! Et puisque nous sommes d’accord sur les symptômes de la maladie, c’est de son étiologie (42) qu’il faut nous occuper. [p. 187]
Vous le savez encore : pour faire de la bonne étiologie, il faut tâcher de remonter au point de départ ; c’est à sa naissance qu’il faut étudier le fléau. Vous ne pouvez pas vous dissimuler que Grandier, « ce prêtre si scandaleusement brillant, aux mœurs galantes, haineuses, et véritablement superbe », n’ait été le mauvais génie de toute cette affaire, ce sont là vos expressions, et elles sont justes. C’est à lui, dites-vous, à sa connivence avec les puissances de l’enfer (p. 32), que les ursulines de Loudun attribuèrent le dérangement de leur santé . Et vous remarquez avec raison que dans toutes les épidémies analogues il y avait un importateur. A Chinon, c’était Barré ; à Louviers, c’était Picard ; à Madrid, c’était Garcia ; et vous attribuez à l’hallucination qui présentait aux victimes ces hommes acharnés à leur perte, le développement de leur maladie et la persévérance avec laquelle elles osaient les accuser. Mais puisque vous croyez à la bonne foi de ces religieuses, croyez-y donc une fois de plus, et surtout croyez-y, lorsque toutes vous affirment que la maladie, l’épidémie, la contagion nerveuse, si vous le voulez, fit son entrée dans le couvent, précisément après que Grandier, refusé pour directeur, eut lancé ses bouquets par-dessus les murailles du couvent. « Per flores, » disaient toutes les possédées ; et le Père Surin ajoute : « Toutes celles qui le flairaient étaient prises à l’instant. » Oui, nous qui croyons au magnétisme, mais qui l’expliquons, nous avons le droit de dire qu’il n’y a pas un seul magnétiseur qui ne reconnaisse ici les auxiliaires ou les talismans magnétiques. Plaisantez-en tant que cela vous fera plaisir, mais il n’en sera pas moins excessivement probable que les fleurs sont encore ici ce que le souffle est aux camisards, la terre de Saint-Médard aux convulsionnaires de Pâris, l’eau magnétisée à Mesmer, le morceau de craie à M. Du Potet, lorsqu’il trace sur son parquet ses lignes magico-magnétiques, de même que, dans l’ordre mystérieux opposé, nous voyons les médailles, les images miraculeuses, les amulettes de tout genre, devenir le véhicule de la [p. 188] sainte influence, pour les pieux croyants qui s’y confient (43).
D’ailleurs il faut hien qu’il y ait ici une influence étrangère, car avec votre simple prédisposition hystérique vous n’expliquerez jamais cette soudaineté, cette simultanéité de l’explosion maladive dans le couvent ; encore moins celle des milliers de victimes à Saint-Médard, et des huit mille dans les Cévennes. Qu’est-ce qu’une prédisposition hystérique qui se développe au premier geste du premier individu, et subitement, chez une multitude de gens de tout âge et de tout sexe ? Et que diriez vous de celui qui définirait le choléra, une prédisposition gastro-entéritique ? Vous lui répondriez (au moins nous aimons à le penser), qu’il ne s’agit pas ici de ses symptômes, mais de sa nature, de son essence ; et s’il hésitait encore, vous lui signaleriez ce géant voyageur, cet agent (mystérieux à sa manière) qui des bouches du Gange s’élance à la conquête du monde, le dévaste par étapes et le fauche en coupes réglées.
Ainsi, répétons-le bien ; les fleurs de Grandier ont été, non pas l’agent, mais le véhicule de la contagion névropathique. Elles ont été l’auxiliaire, le propagateur, comme le ballot de laine est le véhicule de la peste. Or, contre ce genre d’épidémies, on pensait en ces temps-Ià, d’après l’Évangile et les apôtres, que les sacrements de l’Église étaient la seule mesure prophylactique (44), comme on voulait aussi que l’inquisition fût le lazaret, et l’exorciste le thérapeute.
Continuons en abrégeant.
Lorsque, sur la fin de l’exorcisme cité, la même religieuse exécute un ordre que le duc venait de communiquer mentale ment à l’exorciste, vous l’expliquez ainsi : « Dans cent occasions, on put croire, en effet, que les énergumènes lisaient dans la [p. 189] pensée des religieux chargés de combattre les démons. Il est certain que ces filles étaient douées, pendant leurs accès…, d’une pénétration d’esprit unique ; mais souvent aussi cette pénétration les abandonnait. (p. 29).
Cela ne répond à rien. Dites-nous donc en quoi consistait cette pénétration unique ? Ne serait-ce pas, par hasard, dans l’obéissance à tous les ordres tacites, soit du prince, soit des évêques, puis dans la révélation des plus profonds secrets des consciences, comme il advint à M. de Queriolet, puis dans le parler de toutes les langues, triple habileté que nous voyons attestée par une masse de témoins, selon vous, irrécusables ? Si c’est là ce que vous entendez par pénétration unique, nous ratifions votre pensée, mais nous ne ratifions pas votre laconisme, car la chose demandait explication.
Plus loin, « mettant en avant, dites-vous, l’autorité des démons, elles trahissaient quelquefois sans scrupule les secrets de l’enfer » (p. 30). Sans scrupule ! Comment en auraient-elles eu, puisque vous venez de nous dire « qu’elles n’en imposaient pas, et que c’était un effet de leur maladie ? » C’est donc la maladie ou plutôt l’agent morbide qui, par elles et malgré elles, révélait ces secrets ! Mais vos conclusions approchent. Attention ! Tant d’actes déraisonnables, tant d’emportements, tous ces élans de fureur, ces blasphèmes, ces hurlements, cette association d’idées étranges… trahissent. . » — Quoi, mon sieur Calmeil ? Achevez, nous vous en conjurons ! — « trahissent… L’EXISTENCE D’UN MAL CRUEL. »
Oui, bien cruel, en vérité ; mais après toutes vos prémisses, après tout ce que vous aviez dit et surtout entrevu, nous avions le droit d’espérer autre chose. Plus haut, nous avons dû vous dire tout ce que votre mérite d’historien nous laissait à désirer ; permettez-nous d’ajouter que celui du philosophe nous paraît bien autrement incomplet.
Quant aux trembleurs des Cévennes, vous commencez par un rapprochement des plus curieux avec les anabaptistes, et là où la foule trompée par les lieux communs de l’histoire [p. 190] n’aperçoit que le côté moral du fanatisme ou les pratiques d’une sainte réforme, vous voyez, vous médecin judicieux et de bonne foi, un tout autre ordre d’incitation. Pour vous, ce ne sont plus seulement des croyants passionnés, ce sont de véritables malades, et vous le prouvez admirablement.
« … Oui, tous ces inspirés qui se posaient en réformateurs du catholicisme romain, oui… ces nuées de prophètes qui choisissaient le plus dangereux des métiers… » (p. 261).
Oui, tous, tous étaient, selon vous, des monomanes, mais à présent il faut tâcher de nous donner une explication, un peu plus rationnelle que pour Loudun, des causes premières ou de l’étiologie de cette terrible contagion.
C’est, direz-vous, « en première ligne l’enthousiasme religieux, le zèle des prédicateurs, la foi des élus, etc., etc. Il Belle raison, vraiment ! Nos Ravignan, nos Ventura, nos Lacordaire… ou si vous l’aimez mieux nos missionnaires de France, dont tant de fois on gourmanda et punit le prétendu fanatisme, n’ont-ils donc jamais prêché avec chaleur et conviction ? Les saint Jérôme et les Bouche d’Or, les saint Bernard ou les Bridaine manquaient-ils donc aussi d’un certain enthousiasme ? Les martyrs qui bravaient toutes les morts à la voix de leurs apôtres, et qui voyaient constamment le ciel ouvert, ne devaient-ils pas être, n’étaient-ils pas éminemment prédisposés au délire de la théomanie ? Pourquoi donc, encore une fois, n’offrirent-ils jamais rien de comparable, et ne rugirent-ils jamais comme des lions, en se tordant dans des convulsions effroyables ? Pourquoi cette Église romaine, si superstitieuse à vos yeux, est-elle si sobre, au contraire, de saintes extases, et si pure de ces folies convulsives que l’on retrouve à la tête et à la base de toutes les sectes qui lui sont op posées ?
Continuons.
« Je ne connais, dites-vous, que l’hystérie et l’épilepsie qui puissent produire de semblables accidents » (p. 285). Et plus loin : « Tout bien considéré, on doit rapporter au type hystérique [p. 191] que la plus grande partie de ces désordres » (p. 287). Mais vous oubliez que vous nous avez déjà dit pour Loudun « qu’il s’agissait de maladies tout à fait différentes de toutes celles observées jusque-là. » Et vous nous direz tout à l’heure que tous ces médecins, témoins et partisans de la possession, étant des savants du premier ordre, excellaient surtout dans la connaissance des maladies nerveuses, et n’étaient pas loin de nous, en fait d’anatomie encéphalique ; » par conséquent ils connaissaient aussi bien que vous votre type hystérique ; mais s’ils étaient unanimes à ne pas le reconnaître ici, c’est probablement parce qu’ils savaient, eux, distinguer, des névropathies normales, les névropathies mystérieuses. En effet, voire type hystérique ne nous expliquera jamais ce que vous nous donnez comme certain, par exemple « que ces catholiques qui se laissaient surprendre par la contagion… en fréquentant les assemblées des fanatiques… déblatéraient aussitôt contre la messe avec la même ardeur que les calvinistes ; il ne nous expliquera pas non plus la conversion au catholicisme de la plus fameuse de toutes ces prophétesses (Isabeau), conversion qui lui fit perdre subitement toutes ses facultés prophétiques, et lui enleva comme avec la main jusqu’aux moindres traces d’affection maladive.
Singulière névrose, convenons-en, qui cesse à l’instant même en changeant de dogme et de pasteur ! Singulière contagion que celle qui infuse dans l’esprit de ses victimes, subitement et de vive force, tout un système d’idées entièrement étrangères et nouvelles, et qui, dès qu’elle se retire, laisse revenir toutes les opinions habituelles et contraires. Or, quel peut être l’agent d’une contagion d’idées ? Qu’est-ce, encore une fois, si ce n’est un agent intelligent lui-même, un ESPRIT, en un mot ?
Vous le voyez donc bien, votre type hystérique n’explique en rien les camisards.
Mais si nous ne nous trompons, Saint-Médard est le coup de grâce pour vos théories purement névropathiques et pour [p. 192] tout le rationalisme moderne. Il s’agit cette fois, comme vous nous le dites fort bien, de vraies afflictions sociales ; on regrette seulement qu’après avoir si bien mérité de la vérité, en rétablissant tant de bases historiques indignement falsifiées, vous entrepreniez, pour les expliquer naturellement, un de ces travaux d’Hercule qui n’aboutiront jamais qu’à l’erreur.
Quel est en effet le point de départ ? Il ne s’agit plus ici, comme à Uvertet, d’une cuisinière qui lance un sort et qui avoue ses maléfices ; ou, comme chez le possédé de la Chine, d’une communion indigne ; ou, comme à Loudun, du bouquet de fleurs de Grandier ; ou, comme à Chinon, du mauvais prêtre Barré ; ou, comme à Louviers, du directeur Picard ; ou, comme à Peyra, du souffle du premier théomane : non, il s’agit d’un diacre mort en état d’opposition avec l’Église, et c’est la terre de sa tombe qui va servir cette fois d’auxiliaire magnétique (45).
Nous vous avons entendu raconter Saint-Médard, monsieur Calmeil, et cette fois il ne s’agit pour vous que « de phénomènes musculaires, offrant une grande ressemblance avec ceux de l’hystérie ; il ne s’agit que de folie mystique, d’initiation, d’état morbide des agents de l’innervation, d’hallucinations… » Ah ! nous vous arrêtons ici, et nous sommes bien tenté de vous rappeler vos aveux et d’affirmer avec vous que ce n’étaient plus alors les malades, mais Paris tout entier qui était halluciné ; car (p. 373) vous nous dites : »Se serait-on résigné à croire jamais, si la population tout entière de Paris ne l’eût affirmé, que plus de cinq cents personnes du sexe aient poussé la rage du fanatisme, ou la perversion de la sensibilité, au point de s’exposer à l’ardeur du feu, etc. » Ainsi l’hallucination n’était pas chez les victimes : elle était chez ces nuées de témoins qui prenaient probablement alors un peu de phosphore pour un brasier ardent, et des coups d’éventail ou d’épingle pour des coups de broches, d’épées ou de barres de fer. Mais [p.193] comme vous ne faites pas partie de ces hallucinés, Monsieur, et que vous croyez bel et bien à l’excellente qualité et du fer et du feu (et vous avez raison), il faut donc vous exécuter hardiment, et nous rendre compte, autrement que par un vocabulaire pathologique, des énormités que vous êtes forcé d’enregistrer. Ici le vague n’est plus possible, et puisque vous êtes médecin, nous faisons de notre côté appel à votre secours, secours héroïque cette fois, ni plus ni moins que tous ceux de Saint-Médard.
Par exemple, il ne faudra pas nous passer sous silence la persistance infatigable et l’incombustibilité de la Sonnet sur les brasiers ardents, — persistance qui lui avait fait donner par tout Paris le nom de Salamandre. — Il ne faudra pas non plus, après nous avoir parlé des broches et des coups qui venaient expirer dans les chairs, se contenter de nous dire : « Cette énergique résistance de la peau, du tissu cellulaire de la surface du corps et des membranes est certainement faite pour camer de la surprise » (p. 386). Il ne suffira pas de nous citer « plus de vingt occasions où l’on a vu de larges ecchymoses et d’innombrables contusions. » Des ecchymoses, grand Dieu ! Vingt fois des ecchymoses lorsqu’il s’agissait de moyens capables d’enfoncer, pardonnez-nous l’expression, tout un régiment de cuirassiers ! Des ecchymoses « après quatre mille coups de bûche assenés par les hommes les plus robustes sur les plus délicates des jeunes filles ! après la décharge dans le creux de leur estomac d’une série de coups de chenet dont le vingt-cinquième culbutait le mur sur lequel la victime était appuyée! après la projection cent fois répétée du caillou de cinquante livres du haut du plafond sur le sein d’une jeune fille! après les écartelages, les danses furieuses d’une vingtaine d’énergumènes sur le ventre des inspirées, sur leurs yeux, sur leur gorge! (p. 37) ; après la torsion des mamelles à l’aide des tenailles et de tous les instruments inventés par l’enfer ! Ah ! des ecchymoses ! Une vingtaine d’ecchymoses sur huit ou dix mille épreuves du même genre ! Ah ! de grâce, monsieur Calmeil, retirez- [p. 194] nous ce mot-là, car c’est probablement une faute d’impression ; et il aura passé par mégarde ! Il est vrai que plus loin vous vous servez encore d’un autre mot et que vous appelez tout cela un massage salutaire (p. 367). Encore une faute d’impression probablement ! retirez-la bien vite, pour que la clientèle n’aille pas s’imaginer que ce massage est dans les habitudes de la faculté de Paris et ne se retire pas à son tour. Grand Dieu ! quel massage ! C’est si bien une faute d’impression, que pour chercher un semblant d’explication à cette « énergique résistance de la peau, si bien faite, dites-vous, pour causer de la surprise, vous vous reportez aux athlètes et aux boxeurs chez lesquels l’éréthisme de tout l’organisme, l’état de spasme, de turgescence des enveloppes charnues, développe la possibilité de braver jusqu’à un certain point les dangers de leur profession. (p. 386). Vous avez été bien inspiré de dire jusqu’à un certain point, car ce point-là, nous le connaissons tous, et nous savons que, vingt fois sur vingt-cinq, les ecchymoses suspendent forcément la lutte, et que les yeux enfoncés, les dents brisées et les membres luxés composent encore les meilleurs jours de ces massages infiniment peu salutaires.
Oh ! non ; vous avez beau appeler à votre aide toutes les ressources de votre érudition pathologique, et personne n’en a plus que vous, jamais, jamais vous ne pourrez vous tirer naturellement du mauvais pas historique dans lequel vous vous êtes imprudemment engagé.
Jamais, par de pareils expédients, vous ne parviendrez à nous expliquer comment cette veuve Thévenet, si rudement secouée et tordue tant que dure sa foi jansénique, se trouve subitement et complétement guérie au moment où, retournant à la foi catholique, elle remet à son frère le portrait du diacre Pâris et deux paquets de terre de son tombeau.
Vous ne vous expliquerez pas plus facilement la conversion du secrétaire des commandements de Louis XV au jansénisme, de ce pauvre inspiré sans le savoir, condamné à une pirouette de six mois et à des jeûnes de quarante jours pour avoir lu un [p. 195] simple chapitre de Quesnel (p. 332). Grâces ineffables, assurément, mais grâces bien gênantes et surtout bien déplacées lorsqu’elles vous saisissent inter pocula et liberos, c’est-à-dire au milieu d’un grand dîner. A cela que nous direz-vous, Monsieur ? Rien, si ce n’est qu’il est présumable qu’on avait parlé devant lui avec enthousiasme des miracles, etc. » (p. 333). Que dites-vous là ? pirouetter pendant six mois, parce qu’on s’est exprimé devant lui avec un certain enthousiasme ? Quel homme impressionnable et faible ! Mais non, certes, il fallait qu’il fût aussi robuste que sa foi pour résister à toute cette miraculeuse gymnastique.
Vous avez donc bien raison de vous écrier : « Il faut en convenir… tout cela dut produire une grande impression sur l’imagination des partisans du miracle » (p. 338). Oui, une impression telle que nous doutons qu’ils vous eussent bien compris, si vous leur aviez dit, comme aujourd’hui, pour expliquer ce fameux jeûne de quarante jours, que. sa prolongation pourrait bien n’avoir pas d’aussi prompts inconvénients sur les théomanes que sur les hommes sains d’esprit » (p. 339) ; ils vous demanderaient sans doute comment « l’exemple des aliénés de votre service, revenant à la vie après quelques abstinences prolongées, » pourrait être ici de quelque poids ; et ils le comprendraient d’autant moins, que vous ajoutez incontinent : « Malgré cela, la plupart de ces aliénés de notre service finissent par succomber, » ce qui nuit tant soit peu aux rapprochements que vous vouliez faire. « Plusieurs théomanes, dites-vous plus loin, parlaient comme si les lèvres, la langue, tous les organes de la prononciation eussent été remués et mis en action par une force étrangère. Il leur semblait qu’ils débitaient des idées qui ne leur appartenaient aucunement, et dont ils n’acquéraient la connaissance qu’au moment où leurs oreilles étaient frappées par le son des mots qu’ils se croyaient forcés d’articule… ils se comparaient à un écho… » (p. 352).
Du moment où vous admettiez la réalité de ces affirmations, [p. 196] vous deviez vous trouver averti, et ne plus glisser aussi légèrement sur le parler des langues étrangères, phénomène que tout Paris vous attestait également, phénomène qui domine, à notre avis, tous les autres, et que vous passez néanmoins sous silence, à propos de Loudun comme à propos des Cévennes. Il fallait aussi nous expliquer la métamorphose de cet enfant auquel vous prêtez l’apparence d’un idiot, et qui « pendant la durée de sa convulsion représentait une personne ayant de grands talents naturels et l’éducation la plus parfaite » (p. 348). Il le faudra bien expliquer, car si la surexcitation cérébrale peut à la rigueur développer de grands talents, elle ne remplacera jamais l’éducation et les connaissances acquises.
Arrêtons-nous, car nous croyons en avoir dit assez pour prouver d’une part la reconnaissance, par la science la plus avancée, de faits prodigieux dénaturés jusqu’ici, et de l’autre son impuissance à en donner une seule explication qui ne soit mille fois moins explicative que le fait n’est prodigieux. Après M. le docteur Calmeil, personne, je crois, ne sera tenté d’en faire agréer une meilleure, et certes, s’il a échoué, c’est que l’entreprise était surhumaine.
Et cependant, en regard de ces insuffisantes théories, il avait les théories de ses premiers maîtres, il les sait par cœur, il les développe à merveille ; et ne croyez pas qu’il les méprise, il vous démentirait sur-le-champ. Vous qui parlez avec tant de pitié des ténèbres philosophiques et scientifiques des siècles qui sont derrière nous ; vous qui, sous le rapport médical surtout, vous croyez illuminés par rapport à ces grands hommes, vous avez ici la meilleure des leçons à recueillir. Lisez M. le docteur Calmeil, et voyez avec quelle justice il en parle ; voyez quel hommage il sait rendre à leurs travaux et même à celles de leurs théories qu’il combat aujourd’hui.
Permettez-nous encore quelques pages, et vous verrez si nous avions raison de dire en commençant qu’il n’y avait pas, à notre avis, un abîme infranchissable entre ses propres tendances et notre foi. Et si cette possibilité ne vous frappe pas, [p. 197] vous conviendrez au moins que la loyauté de sa philosophie ne lui permet jamais ce mépris pour les anciennes doctrines, qui parait inspirer chacun de ses confrères.
On sait qu’il combat, comme eux, la doctrine des esprits, mais on ne sait pas avec quelle réserve, et combien de circonstances atténuantes et presque favorables il insère dans son verdict d’accusation.
Ainsi, quand il parle des théologiens des derniers siècles, on rencontre fréquemment des phrases comme celles-ci : « Qu’on e donne la peine de consulter au moins quelques-unes des nombreuses dissertations théologiques composées depuis le règne de saint Louis jusqu’à celui de Louis XIV, qu’on daigne surtout parcourir quelques-uns de ces recueils qui servaient de guide aux ecclésiastiques… et ce ne sera pas sans surprise qu’on y apprendra à connaître le rôle que la théologie et la philosophie transcendante s’accordaient, pendant un temps, à faire jouer ici-bas aux êtres surnaturels… Cette manière d’interpréter les effets qui s’opèrent dans la nature détruisait évidemment de fond en comble la théorie qui nous sert actuellement… Mais il était plus difficile qu’on ne le pense aux théologiens du XVIe siècle (46) de ne pas se jeter à corps perdu, si on peut le dire, dans la métaphysique des causes surnaturelles (47).
En effet, de quelque côté qu’ils portassent leurs regards… passé sacré ou profane, philosophie, poésie, croyances populaires ou témoignage des sens… tout résolvait cette question par l’affirmative… » (p. 91).
« Ils étaient liés par le texte même des Écriture… (48). En outre, le nombre des faits particuliers qui pouvaient sembler propres à démontrer ou à confirmer l’existence des essences spirituelles… est presque effrayant pour l’imagination… [p. 198]
« Il faut donc bien l’avouer, au risque d’encourir le reproche de vouloir tirer la logique des théologiens du discrédit où elle est aujourd’hui si justement tombées (49). Quand une fois on a admis sérieusement l’existence d’un grand nombre d’êtres spirituels, tout cet échafaudage de superstitions n’est pourtant pas aussi absurde qu’on est d’abord porté à se le figurer. Bayle, qu’on n’accusera pas trop de crédulité, a imprimé quelque part… « Je ne sais ce qui arrivera, mais il me semble que, tôt ou tard, on sera contraint d’abandonner les principes mécaniques, si on ne leur associe les volontés de quelques intelligences, et franchement il n’y a pas d’hypothèse plus capable de donner raison des événements… » « A ce compte, il semblerait, répond M. Calmeil (p. 110), que le plus grand tort des théologiens était d’avoir outré les conséquences de la doctrine… et finalement on est bien forcé de confesser que cette théorie ne pouvait paraître que séduisante à des spiritualistes renforcés. »
Et même… « ces anciens théologiens connaissaient pourtant, tant bien que mal, les principales destinations de l’appareil nerveux dans l’économie vivante, et ils avaient analysé avec assez de soin le mécanisme de l’action nerveuse pendant les différents temps de chaque sensation… On juge même qu’ils possédaient passablement les principes de la théorie physiologique qui nous sert aujourd’hui à expliquer la manifestation des sensations morbides. »
Ceci est beaucoup, sans doute, mais ce n’est pas assez. Il fallait dire encore avec quel soin les rituels distinguaient les affections nerveuses, simples, telles que l’hystérie, l’épilepsie, etc., de celles qui pouvaient offrir le caractère magique ; il fallait mettre certaines pages de pathologie cléricale en regard des accusations ordinaires d’ignorance, et ce ne serait pas sans étonnement qu’on parcourrait certains traités médicaux émanant des sacristies, et que l’on croirait plutôt l’ouvrage d’une plume [p.199] contemporaine. Il fallait insister davantage encore sur l’excessive prudence avec laquelle le clergé recommandait de recourir aux médecins avant tout, et les précautions infinies qu’il enjoignait à ses membres pour ne jamais agir que sur le dire de ceux-ci. C’est donc, s’il y avait erreur ou faute, c’est donc surtout sur les médecins qu’il convenait de la rejeter. Il nous reste à voir ce que M. Calmeil en va dire, et quelle opinion il va nous donner de ces esprits si enténébrés, disait-on. Parlons avec autant de vénération que l’on voudra de ceux qui leur succédèrent, mais voyons enfin ce que nous devons croire- de ces hommes éminents par leur talent et leur savoir (c’est M. Calmeil qui parle), placés tout à fait en dehors de la corporation du clergé, et parmi lesquels on peut citer surtout Barthélemy de Lépine, Fernel, Ambroise Paré, Bodin, Leloyer, Boguet, etc. »
« Fernel, qui s’est acquis l’immortalité, non-seulement par ses ouvrages de médecine, mais encore en procédant expérimentalement et par le calcul à la détermination de la grandeur de la terre, posséda quelques notions sur la frénésie, l’épilepsie, la manie, l’hypocondrie et la mélancolie, dont il admet plusieurs espèces… Selon lui, les possédés ressemblent aux maniaques ordinaires, mais ils ont le privilège de lire dans le passé et de deviner les choses les plus secrètes… Il a été témoin d’un cas de cette sorte… qui fut d’abord méconnu par les plus doctes médecins de l’époque (50). » [p. 200]
« Ambroise Paré, ce prince de la chirurgie moderne, décrit quels signes les démons peuvent donner de leur présence… mais insiste surtout sur l’entassement par eux, dans le corps des personnes vivantes, et notamment chez Ulric Neussesser, de clous, épines, cheveux, lames de fer, etc.
« Bodin n’ a qu’un but, celui de démontrer que les démonolâtres ne déraisonnent pas, que leurs assertions ne dénotent aucun vice de la sensibilité. »
Wier, « qui n’est que trop versé dans la science des démons, n’en pose pas moins les vrais fondements de la pathologie mentale. (p. 190).
Leloyer, malgré ses convictions surnaturelles, émet néanmoins, dans son chapitre des sens corrompus, des remarques d’une haute importance sur les méprises possibles de la vue, de l’ouïe, etc.
Plus tard, « les Plater, les Sylvius, les Sennert, les Willis et les Bonnet ayant contribué à asseoir la physiologie et la pathologie intellectuelles sur leurs véritables bases » (p. 359), peut être va-t-il nous être permis d’espérer de leur part une réforme radicale sur les superstitions en question ?
Pas le moins du monde. « Félix Plater, qui discourt si bien sur la pathologie cérébrale, sur l’épilepsie, l’hypocondrie, la mélancolie, la manie, la chorée, n’en est pas moins convaincu, d’après ce qu’il a lui-même observé, que la folie démoniaque, tout en présentant à peu près les mêmes symptômes que la manie ou la mélancolie ordinaire, peut cependant en être distinguée par des signes presque certains » (p. 375). Ces signes sont : « les courbures extraordinaires du corps, la prédiction, la divination des choses cachées, le parler des langues non sues avant la maladie, etc. » (p. 376). Et dès lors il renvoie ces derniers malades aux théologiens.
Et pourtant- l’ouvrage de Plater, dit M. Calmeil (p. 377), s’il était possible d’en retrancher ces passages, paraîtrait avoir été composé tout récemment. »
« Senner, qui définit si bien la manie, une lésion de [p. 201] l’imagination et du raisonnement (p. 381), n’en reconnaît pas moins qu’il existe une variété d’extase qui est provoquée par des influences diaboliques (p. 383).
« Enfin Thomas Willis, dont les écrits concernant les différents genres d’affections convulsives, la manie, la mélancolie, la frénésie, le délire aigu, l’apoplexie, la paralysie, le cauchemar, le vertige, etc., représentent un traité complet de pathologie encéphalique ; Willis, qui excelle, en général, dans la distinction des maladies en espèces…, avec lequel il y a continuellement et beaucoup à apprendre, tant ses connaissances en anatomie, physiologie, pathologie de l’appareil nerveux, sont des plus étendues (p. 388) ; WilIis, savant du premier ordre (lb.), névrotomiste aussi savant qu’habile, et qui, pour la première fois, s’empare de la stimulation, la fait voyager dans le cerveau, le cervelet, à travers le bulbe rachidien et la tige rachidienne, à travers toutes les subdivisions du système nerveux, etc. (p. 400) ; Willis enfin qui possédait, il y a près de deux siècles, la plupart des connaissances que nous sommes si fiers de posséder aujourd’hui (p. 406)… eh bien ! Willis, en ce qui concerne l’action des esprits sur l’économie humaine, ne s’en prononce pas moins et sans restriction pour l’avis des théologiens. Il ne répugne nullement à la raison de ce logicien sévère… d’admettre que l’âme peut être momentanément éclipsée, que les démons peuvent, en quelque sorte, en s’insinuant dans les couloirs nerveux, agir à sa place, au moins dans certaines limites, et il professe que c’est à l’action stimulante de ces êtres nuisibles, ou à celle des poisons subtils qu’ils ont l’adresse d’introduire dans l’organisme, que sont dues mille lésions fonctionnelles, et surtout celles que l’on note sur les véritables énergumènes » (p. 407).
Quel point de vue tout nouveau ! quelle réhabilitation magnifique ! Et c’est vous, savant du premier ordre, c’est vous, docteur Calmeil, qui la faites ! En vérité, de là à changer en lumières toutes les ténèbres du moyen âge il n’y a pas loin !
Terminons par l’examen de votre argument favori : « Aujourd’hui [p. 202] la puissance magnétique développe des phénomènes tout semblables… et l’état de ces malades ressemble trait pour trait à celui de nos somnambules magnétiques… » Mais lorsque nous cherchons à deviner votre opinion sur cette puissance et sur les somnambules, nous nous apercevons que, pour rendre l’analogie plus complète, vous leur avez fait subir le même traitement qu’à vos malades, c’est-à-dire que vous les avez mutilés jusqu’à ce qu’ils s’ajustassent parfaitement sur sur théories. Ainsi, pour vous, les ursulines acquéraient « une pénétration d’esprit unique, » et les somnambules conversent « sur des objets qui leur sont presque étrangers, » mais vous vous gardez bien de sortir de ce programme. De même encore que vous taisez chez les premières la révélation des choses secrètes, l’obéissance aux vœux tacites, le parler des langues étrangères, etc., de même aussi vous les refusez aux somnambules ; et c’est vraiment heureux, puisque dans le cas où une seule de ces mille citations (dont un grand nombre cependant émanent de vos pairs) eût trouvé grâce et crédit à vos yeux, vous déclarez solennellement « qu’il ne vous répugnerait aucunement alors d’ajouter foi aux assertions de Torralba, des possédés de Loudun, etc., mais qu’il faudrait en même temps Ise hâter de jeter au feu tous les écrits modernes sur l’aliénation mentale, car ils ne seraient plus alors que de pitoyables romans » (T. II, p. 475). ‘
Non, non, monsieur Calmeil, ces romans renferment trop d’histoires, trop de recherches, trop de génie scientifique pour être ainsi sacrifiés, et, tous les autres le fussent-ils, les vôtres ne le seront jamais; mais vous les compléterez, et vous De craindrez pas de revenir à l’avis de ces grands maîtres si noblement vengés par vous tout à l’heure ; comme eux, vous finirez par séparer soigneusement des névropathies normales les névropathies mystérieuses qui forment une classe toute spéciale, et se distinguent des premières, précisément par ces mêmes traits qui distinguent le somnambulisme magnétique du somnambulisme ordinaire.
Et si vous nous permettez de vous le dire, vous les distinguez [p. 203] déjà parfaitement, et vous n’êtes plus séparé de la vérité que par un cheveu ; car voici, par exemple, un fait que vous admettez, et qui à lui seul déciderait la question. C’est celui qui consiste dans l’accomplissement ponctuel de la prédiction somnambulique. Oui, vous l’admettez, puisque vous dites : « On s’aperçoit bientôt que si, dans de semblables cas, les prédictions des somnambules s’accomplissent ponctuellement, cela tient… {voyons !) non pas à ce que les extatiques voient les mouvements qui se préparent à présent, soit dans leurs organes, soit dans les organes des autres, mais bien… « (voyons encore !) à ce que l’action du cerveau est pour ainsi dire reflétée par l’intermédiaire des nerfs, sur telle et telle partie, soit de leur machine, soit de celle d’autrui (quel aveu !) C’est donc parce que le somnambule est convaincu maintenant qu’il aura un certain jour la migraine, des attaques convulsives, ou parce qu’il a réussi à persuader qu’on aura tel ou tel accident, qu’en réalité tous ces accidents surviennent à point nommé » (T. Il, p. 483).
Ah ! ceci, par exemple, devient un peu trop fort. Pour enlever aux somnambules la prévision de l’avenir, vous leur accordez la puissance d’influencer celui d’autrui !
Nous craignons bien que de Charybde vous ne soyez tombé dans Scylla, et que ce dernier abîme ne soit bien autrement profond que le premier.
Mais, encore une fois, laissons donc là le magnétisme, qui peut nous offrir à coup sûr de fréquentes analogies, mais analogies en miniature auprès des larges traits que nous venons d’esquisser, Dissimule-t-il ses forces aujourd’hui, ou varie-t-il ses phénomènes suivant les temps, les individus, les théâtres ? En un mot, y-a-t-il identité parfaite, ou seulement une sorte d’élément spirituel et commun où les esprits bons et mauvais pourraient puiser également tour à tour ? Là repose toute la question, et, sans la résoudre entièrement dans ce mémoire, nous ne le terminerons pas sans l’avoir hardiment attaquée (51).
Notre but principal est atteint, et désormais nous n’aurons plus à continuer qu’une démonstration commencée. Devant ces nouvelles et nombreuses confessions d’une science interdite et rendue, qui donc oserait continuer encore les pauvres railleries de Fontenelle et de Voltaire sur ce qu’ils appelaient les sottes crédulités du moyen âg ?? Vous l’avez entendu ; c’est la science la plus haute qui réhabilite ces sottises, et pendant que certains dépositaires de la vérité détournent eux-mêmes la tête en souriant, cette science nous y ramène, nous la rappelle avec effroi, et se demande en tremblant si ces terribles ennemis ne se cachent pas aujourd’hui sous des dehors et sous des noms moins redoutables. Quelle leçon ! Le comte de Maistre nous prophétisait, il y a quelques années, « que nous ririons bientôt de ceux qui riaient naguère des ténèbres du moyen Age. » Or, répétons-le bien haut, la prophétie s’accomplit tous les jours, et, pour sa part, le docteur Calmeil vient de l’accomplir dans la science médicale.
Notes
(1) Maladies nerveuses.
(2) De la folie… Exposé des condamnations auxquelles la folie méconnue a souvent donné lieu. 2 vol. gr. in-8°, chez Baillière ; 1845.
(3) Empoisonnements.
(4) Je ne sais pas parler latin.
(5) Id., ib., p. 424.
(6) Calmeil, t. II, p. 254.
(7) Auteur des Lettres sur la géologie, petit chef-d’œuvre comparable, pour le charme et pour la clarté, aux Mondes de Fontenelle.
(8) De l’Extase, p. 339. [en ligne sur notre site]
(9) « Si les ennemis de Grandier avaient, comme on l’a dit, voulu le faire périr, ils avaient un moyen beaucoup plus facile de parvenir à leurs fins. Grandier, en effet, était accusé de crimes commis dans son église, crimes qui constituaient des sacrilèges que la loi aurait punis de mort, de l’aveu même de ses défenseurs. Plus de cent cinquante témoins déposaient contre ses mœurs ; il était donc beaucoup plus simple de s’arrêter à une accusation vraisemblable, et qui paraissait facile à prouver, que d’aller se jeter dans l’accusation de magie à laquelle on ne croyait plus guère, et qui nécessitait un nombre si considérable de faux témoins, un appareil de preuves si difficiles à rassembler, qu’il semble que jamais on n’aurait pu venir à bout d’une semblable entreprise. » (Traité du somn., 341.)
(10) Ils refusaient d’y venir sous prétexte de scrupules religieux.
(11) Il s’agit ici du protestant Aubin, que le siècle dernier a si bien cru sur parole.
(12) Choisis surtout, vous venez de nous le dire, parmi les plus grands hommes de bien de la province.
(13) M. Calmeil nous permettra d’intervertir parfois l’ordre de ses assenions, notre cadre l’exigeant : mais jamais nous ne nous permettrons d’altérer le sens d’un seul mot, ou de l’isoler perfidement pour déguiser sa pensée. Nous ne le voulons, ni n’en avons besoin.
(14) C’est probablement là un des symptômes qui engagent les magnétiseurs à réclamer Loudun comme une de leurs œuvres les plus éclatantes.
(15) Second symptôme analogue.
(16) Rien ne fut plus réel que cette possession, invoquée par le P. Surin sur lui-même ; mais que dire de l’historien protestant, qui n’admet que cette dernière, et ne permet plus cette fois que l’on en doute ? Ceux qui l’ont cru si docilement sur parole le croiront-ils jusqu’au bout ?
(17) On appelle nosologie la classification des maladies.
(18) Histoire des diables de Loudun, p. 182.
(19) Voyez à ce sujet les Mémoires de Mme de Motteville.
(20) C’est l’auteur du Traité de la Mélancolie qui l’affirme. Plus lard nous entendrons M. Calmeil faire de cet auteur un éloge mérité.
(21) Procès-verbal est dressé de ce fait cité dans l’interrogatoire et dans l’extrait de la commission.
(22) Bertrand. De l’Extase, p. 442. [en ligne sur notre site]
(9) « Si les ennemis de Grandier avaient, comme
(23) La communauté fut ruinée par suite du retrait soudain de toutes les pensionnaires, et les religieuses furent longtemps réduites au seul travail de leurs mains.
(24) Lorsqu’on examine à fond les principes et la marche de toutes ces procédures, on reste stupéfait devant le nombre des précautions prises et des preuves exigées dans l’intérêt de l’accusé. En voici quelques-unes : « Ces preuves devant être plus claire que le jour, luce clariore, on ne se contente plus des témoignages requis dans toutes les autres affaires ; le nombre des témoins est doublé, et sur chacun d’eux on fait une très-sévère enquête ; on récuse tous ceux qui ont eu de mauvais rapports avec le suspect ; quelque fois on forée au serment, non-seulement toute une paroisse, mais encore tout le voisinage, totam viciniam ; mais c’est surtout le faux témoin qu’on s’attache à frapper de terreur ; pour lui, deux sortes de peines : les temporelles, qui le vouent sans miséricorde à la prison perpétuelle, et les spirituelles, qui le frappent d’excommunication et ne lui pardonnent qu’à la condition du jeûne au pain et à l’eau pour tout le reste de ses jours… Qu’on juge de la terreur que de telles menaces devaient faire naître dans ces siècles de foi, et des facilités qu’on devait rencontrer pour la mise en scène de ces prétendues comédies !
(25) M. Calmeil reconnaît que la contagion avait gagné cette ville.
(26) Soirée de Saint-Pétersbourg. T. 1.
(27) Jean Cavalier, roman nouveau de M. Eugène Sue.
(28) Hist. De B., I. XI, n° 15.
(29) Cette publication récente ayant produit une assez vive sensation parmi les coreligionnaires de l’auteur, et même dans la presse philosophique, elle justifie davantage encore l’actualité de notre polémique.
(30) Leur nom, dit Édouard Charton, venait soit de leurs expéditions nocturnes, appelées camisades, soit de deux mots languedociens camas-ard, brûleurs de maisons.
(31) M. Bost a bien pressenti l’objection, car, dans une de ses notes, il parle « des scrupules que peuvent faire naître dans une âme fidèle ces agitations corporelles, parce que, dit-il, elles accompagnaient ordinairement et accompagnent maintenant en tout lieu, chez les idolâtres ou les incrédules, les prédictions des pythonisses ou de ceux qui prétendent à une inspiration extraordinaire… A cela il est facile de répondre, ajoute-t-il, qu’il ne suffit pas qu’un vrai prophète ait quelque chose de commun avec un faux, pour en conclure qu’il est faux prophète lui-même… l’extase n’ayant pas de rapport nécessaire avec la religion… » D’accord ; mais alors pourquoi convenez-vous « qu’il est très-vrai que les prophètes du Nouveau Testament ne nous offrent absolument rien de semblable ? » Vous avez beau vouloir nous l’expliquer en ajoutant : « C’est parce qu’on ne décrit pas leur état. » Cette raison est bien mauvaise, car nous les voyons, au contraire, bien plus dans le détail de leur vie, et si jamais on n’a ouï parler de convulsions, c’est qu’ils n’en eurent jamais.
Alors vous êtes obligé de vous rejeter sur l’Ancien Testament, et vous nous citez Balaam. Mais vous oubliez que l’homme aux yeux fermés et qui tombait à terre (expressions qu’on n’a jamais remarquées, et qui en feraient [p. 166] presque un somnambule), était classé parmi les prophètes du démon, et qu’il dérogeait, pour cette fois seulement et forcément, à l’erreur. L’exemple de Saül ne nous parait pas mieux choisi, puisque chez lui l’agitation corporelle, la convulsion était toujours le prélude de l’invasion démoniaque, comme l’apaisement résultant des sons de la harpe était celui do retour de l’Esprit divin. Vous voyez donc bien que vos comparaisons tournent contre vous. Nous autres catholiques, nous n’oublions pas que le concile qui s’assembla pour juger Montan et Marcion, déclara que le Saint-Esprit n’avait pas pour habitude de détériorer ceux qu’il venait éclairer, ni de leur faire perdre l’usage de leurs sens et de leur raison, mais bien de les améliorer.
Maintenant, si nous passons au magnétisme, nous retrouvons encore cette tendance aux mêmes phénomènes. De là vient sans doute le nouveau nom de transe, que M. Du Potet, d’accord avec les magnétiseurs américains, donne à l’état magnétique. De là, probablement encore, cette opinion formulée dernièrement par un savant de Milan, que le magnétisme était un agent « essentiellement morbide. »
Enfin, si nous en arrivons aux faits tout récents des chaînes humaines développant l’aimantation rotatoire, nous voyons quelquefois des malheureux trembler encore le lendemain, par suite de l’influence spirituelle à laquelle ils se sont frottés. (Voyez les derniers chapitres.)
(32) Il faut que la réalité de ces terribles scènes lui ait paru bien [p. 167] inattaquable, pour que cette fois-ci, et par exception, M. le docteur Dubois (d’Amiens) veuille bien reconnaître que la simulation n’y jouait aucun rôle. Mais à qui pourra-t-il persuader que des épidémies toutes semblables, et dont les phénomènes sont littéralement calqués les uns sur les autres, soient réelles de ce côté-ci de la rivière et simulées sur l’autre rive ? Ce n’était pas des vérités de fait que Pascal disait : « Vérités au delà des Pyrénées, erreurs en deçà ». Il est vrai que même â propos de ces phénomènes camisards, M. Dubois fait encore des réserves et les trouve étrangement amplifiés. Nous, nous les trouvions au contraire étrangement mutilés, et nous avons prouvé qu’ils l’étaient. Que M. Dubois prenne soin de recourir aux sources historiques, et il pourra s’assurer que nous sommes restés encore en deçà de la vérité. Mais, de grâce, qu’il ne se permette plus de choisir arbitrairement et au hasard entre les innocents et les coupables, et d’appeler tour à tour blanc ou noir, à sa fantaisie, ce qui est exactement de même couleur. Car cette fois-ci, ce serait plus qu’un crime, ce serait une faute, oui, une faute contre la logique, et celle-ci ne se pardonnerait pas chez un homme d’esprit.
(33) De par le roi défense à Dieu
De faire miracle en ce lieu.
On est attristé d’entendre M. Arago, dans l’article de l’Annuaire précédemment [p. 168] cité (1853), alléguer ces deux vers comme une des preuves de la fausseté des faits de Saint-Médard ; nous possédons peu de vérités, mais à ce titre-là, et si la plus pauvre plaisanterie devait en décider, il n’en subsisterait pas une seule. Au reste, nous croyons le temps des plaisanteries définitivement passé, et nous savons que sur tous ces sujets ce n’est pas l’Académie des sciences qui rit le plus en ce moment, ou du moins qui rit le plus franchement.
Quant à ces faits de Saint-Médard, M. Arago va pouvoir s’assurer une fois de plus qu’ils étaient attestés uniquement par plusieurs personnes distinguées, et s’il n’y avait pas ici tout à la fois, en fait de témoins, et qualité et quantité. (Voyez l’Annuaire, p. 434 et 435.)
(34) Ce même sujet a été déjà traité plusieurs foi au même point de vue et tout spécialement, il y a une vingtaine d’années, par M. M*** (de la Marne) dans le savant ouvrage intitulé : « la Religion constatée universellement. »
(35) Essai philosophique sur l’entendement, p. 10.
(36) A ceux qui pourraient croire que le froid du marbre était pour quelque chose dans ce début, nous répondrions sur-le-champ, qu’un peu de terre ramassée auprès du tombeau, et délayée dans un peu d’eau et de vin, [p. 170] produisait exactement le même effet. Ainsi, cette fois, le toucher du marbre était le point de départ convenu, comme l’imposition des mains et le souffle dans la bouche des camisards.
(37) Janséniste.
(38) Les partisans du diâcre Pâris.
(39) Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que la contagion tournante ne date pas de 1853 ; rappelons seulement qu’en fait de tours de force, la plus belle pirouette à l’Opéra ne dure pas une demi-minute, et que, d’un [p. 173] autre côté, les secrétaires de la cour cèdent rarement à la tentation de perdre place et crédit. Au reste, nous pouvons encore invoquer ici l’attestation d’un pieux et savant ecclésiastique de notre connaissance. Cet ecclésiastique nous racontait qu’un jour, au moment de donner l’absolution à une femme âgée de soixante ans, et d’une dévotion très-suspecte, cette femme, entraînée aussi par une puissance irrésistible, se mit à tourner sur son pouce avec une rapidité éblouissante, et sans que rien pût l’arrêter. Singuliers effets qui se calquent exactement les uns sur les autres à un ou plusieurs siècles de distance !
(40) Morand, le chirurgien de l’Hôtel-Dieu, décrit encore dans ses Opuscules chirurgicaux l’impassibilité avec laquelle la sœur Sonnet, appelée pour cette raison la Salamandre, se couchait et restait couchée au travers d’un brasier ardent : « Scène remarquable, dit le Grand Dictionnaire des science, médicales, en ce qu’on voit figurer, parmi les nombreux témoins qui en certifient la réalité, un lord anglais qui en fut si frappé, qu’il se convertit, et le [p. 176] frère de Voltaire, Armand Arouet, trésorier de la cour des comptes (art. CONVULSIONS). »
Au reste, il y a seize cents ans que Jamblique décrivait toutes ces scènes dans son livre : De mysteriis Ægyptiorum… Chacune des pages de l’histoire nous les eût aussi montrées dans les fameuses épreuve par le feu … Mais il faut bien, pour que nous ayons confiance, que ce soient Hume et Dulaure qui se portent garants, et nous cautionnent la vérité !
(41) Diderot, Pensées philosophiques.
(42) Cause des maladies.
(43) Quant au fantôme de Grandier, qui poursuit, à partir de ce moment, les religieuses, nous en retrouverons bientôt l’analogue au presbytère de Cideville, où nous le verrons surgir aussi tout à coup après le toucher d’un berger.
(44) Détournante.
(45) Pourquoi donc le tombeau de sainte Geneviève, usé par vingt générations, n’a-t-il jamais rien produit de semblable ? Quelle bizarre différence !
(46) Et à ceux de tous les siècles.
(47) Causes hypernaturelles est mieux. Les esprits ne sont qu’un degré plus élevé dans la grande échelle des êtres et de la création. N’admettons-nous pas une multitude de causes inappréciables par les sens ? Il ne s’agit donc que de savoir si, parmi ces dernières, il y en a d’intelligentes. Voilà tout.
(48) Avis à beaucoup de théologiens.
(49) C’est ce qui va bientôt arriver sans qu’on ait à craindre le retour aux bûchers de la politique. On peut retourner à l’Évangile et à Platon sans rétrograder jusqu’à Philippe Il et même jusqu’à Louis XIV.
(50) C’est le détail des faits qu’il faut lire. Lui seul met à nu la force el les raisons de la conviction. Voyez, par exemple, dans les Œuvres universelles de ce Fernel, le récit de la maladie d’un gentilhomme, « maladie contre laquelle, dit-il, nous fîmes tous nos efforts pendant deux mois, étant de plus de cent lieues éloignés de la vraie cause… lorsque, le troisième mois, l’esprit se déclara de lui-même, en parlant par la bouche du malade, du grec et du latin à foison, encore que ledit malade ne sût rien en grec. Il découvrit alors les secrets de ceux qui étaient là présents, et principalement des médecins, se moquant d’eux pour ce qu’il les avait circonvenus, et qu’avec leurs médecines inutiles ils avaient presque fait mourir leur malade. Etc. » Ce fait se renouvelle tous les jours, mais aujourd’hui l’esprit n’en avertit plus les médecins, et se contente do rire à part lui.
(51) On verra dans la suite de cet ouvrage combien de névropathies, toutes [p. 204] semblables, subsistent encore à l’heure qu’il est dans nos deux hémisphères, et combien de malheureux sont victimes, au XIXe siècle, de l’oubli d’un vieux dogme et dos obstacles qu’il savait opposer au fléau.



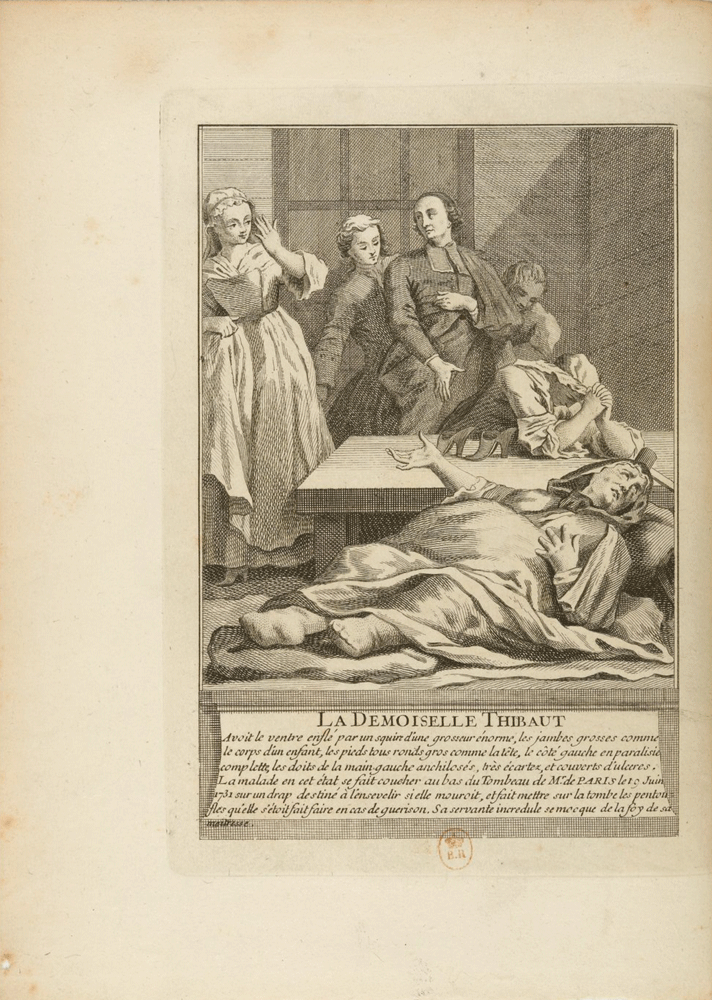

LAISSER UN COMMENTAIRE