 Albert Kaploun. Le rêve différe-t-il de la veille comme l’individuel diffère du social. Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologique », XXe année, (Paris), 1923, pp. 440-450.
Albert Kaploun. Le rêve différe-t-il de la veille comme l’individuel diffère du social. Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologique », XXe année, (Paris), 1923, pp. 440-450.
Nous n’avons pas trouvé de renseignements bio-bibliographqiue sur Albert Kaploun. La seule publication que nous connaissons est :
Psychologie générale tirée de l’étude du rêve. Lausanne, Payot, 1919. 1 vol. in-8°, 205 p., 2 ffnch.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons corrigé quelques fautes de typographie. – Par commodité nous avons renvoyé les notes de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 440]
LE RÊVE DIFFÈRE-T-IL DE LA VEILLE
COMME L’INDIVIDUEL DIFFÈRE DU SOCIAL ?
S’il est une fonction que la psychologie individuelle espérait réfractaire à une absorption par la sociologie, c’est bien la mémoire. M. Halbwachs (1) a tenté de montrer que la sociologie pouvait s’incorporer même cette fonction. Dans une étude aussi fine que propre à apporter aux psychologues « purs » de nouvelles inquiétudes, il pense pouvoir expliquer par la société aussi bien la conservation des souvenirs que leur évocation.
N’est-ce là qu’une fausse alerte ? Il nous a paru, en tout cas, que si l’argumentation de M. Halbwachs constitue un danger pour la psychologie individuelle, ce danger n’est pas tout à fait nouveau. Nous espérons montrer, en effet, que ce n’est pas sur la mémoire que porte en réalité la thèse de M. Halbwachs, mais sur l’intelligence. Et ici, nous sommes dans un domaine familier ; les psychologues ont déjà appris, en effet, à défendre l’intelligence contre ceux qui en veulent faire honneur à la société. Peut-être même réussirons-nous à apporter quelque modeste contribution à cette défense de l’intelligence, conçue comme l’apport, avant tout, de l’individu.
*
* *
Selon M. Halbwachs, un fait ne se fixe dans notre mémoire que parce que, comme la brodeuse qui fixe un dessin sur son canevas, nous le piquons en quelque sorte sur le filet virtuel dont l’espace et le temps constituent les mailles essentielles. Et, de la même façon, [p. 441] sans ce réseau qui supporte notre passé, nous serions incapables d’évoquer un souvenir, car pour saisir un vrai souvenir — et non une simple image, vague et flottante, dont on ne pourrait même dire si elle est un souvenir — il faut saisir d’abord le filet, puis suivre les mailles dans lesquelles le fait se trouve pris jusqu’à ce qu’on l’atteigne, et, en même temps que lui, le petit réseau aux brins duquel il est accroché, qui le situe et nous le fait reconnaître.
Jusqu’ici, M. Halbwachs nous paraît traduire avec exactitude le mécanisme de la mémoire. Nous-même avons signalé naguère l’importance de ce réseau qui, en veille, sous-tend toute notre pensée. Le lecteur voudra bien nous excuser si nous citons quelques brefs passages de notre ouvrage, qui corroborent la pensée de M. Halbwachs. « Sans se représenter le fait, disions-nous, on sait qu’il a eu lieu. Sa rétention est un processus intellectuel ; on situe implicitement Le fait, dans l’espace et le temps, on en pense virtuellement l’origine et la portée (2). Tout comme M. Halbwachs, nous affirmions même que ce qui sous-tend ainsi nos souvenirs, ce n’est pas simplement le double cadre abstrait du temps et de l’espace — cela, on le sait assez depuis Kant — mais tout un système de connaissances concrètes, d’événements déterminés, que leur caractère virtuel, ou plutôt latent, n’empêche nullement, bien au contraire, d’agir énergiquement en nous, « à tel point que bien des connaissances latentes sont autrement vigoureuses et déterminantes que les perceptions ou les connaissances conscientes » (op. cit., § 58). « Toute notre vie psychique passée, ainsi que la connaissance de la réalité présente, sont toujours latentes dans notre esprit, prêtes à se réaliser sur-le-champ dans celle de leurs parties à laquelle s’appliquera notre pensée. Ces connaissances ainsi maintenues dans leur totalité par la tension de veille, sont toujours implicitement ordonnées, systématisées. » § 3). C’est même ce qui fait qu’en veille nos pensées et nos actions sont sensées. « En veille, le faisceau des connaissances relatives aux faits particuliers est sans cesse sous-jacent au travail conscient de notre esprit, qui reste continuellement en rapport avec la réalité présente, passée et future. Elles sont toujours à notre disposition, nous les tenons « sous pression », et c’est leur incessante présence [p. 442] qui fait que notre vie de veille est adaptée à la réalité. » (§ 59).
Nous ne pouvons donc qu’accorder à M. Halbwachs que les dates, les repérages sur les cartes géographiques, les mots, sont autant de « clous » avec lesquels sont fixés nos souvenirs (loc. cit., p. 79).
*
* *
Mais M. Halbwachs va plus loin. De même que ce réseau soutient nos souvenirs, il se demande par quoi, à son tour, le réseau est soutenu. Et c’est ici qu’il fait intervenir la société. « C’est, dit-il, dans la mesure où ils ont été liés à des images de signification sociale, et que nous nous représentons couramment par le fait seul que nous sommes membres de la société… que nous gardons quelque prise sur nos anciennes dispositions internes. » (ibid., p. 80). Et un peu plus loin : « Quand nous nous souvenons, nous partons du présent, du système d’idées générales qui est toujours à notre portée, du langage et des points de repère adoptés par la société, c’est- à-dire de tous les moyens d’expression qu’elle met à notre disposition, et nous les combinons de façon à retrouver soit tel détail, soit telle nuance des figures ou des événements passés. » (p. 82).
Même nos états les plus intimes n’échapperaient à l’anéantissement que parce qu’ils sont sauvegardés par notre milieu : « Les sentiments, pas plus que nos autres états de conscience, n’échappent à cette loi : pour s’en souvenir, il faut les replacer dans un ensemble de faits, d’êtres et d’idées qui font partie de notre représentation de la société. » (p. 88).
Ce qui prouverait encore que cet échafaudage qui supporte l’édifice de notre mémoire n’est pas disposé par l’individu, c’est qu’il est rigide, immuable, et échappe dans une certaine mesure à notre prise ; les images du passé « se rangent en effet dans des cadres immobiles qui ne sont pas notre œuvre exclusive, qui ne se transforment pas avec nous et suivant notre caprice, … il y a un principe d’objectivité qui s’impose à eux du dehors. Les souvenirs… ne nous mettent pas seulement en rapport avec notre propre passé, mais nous replongent dans une époque, nous replacent dans un état de la société dont il existe, autour de nous, bien d’autres vestiges que ceux que nous en trouvons ainsi en nous-mêmes… Nous retrouvons [p. 443] nos souvenirs en nous aidant, du moins en partie, de la mémoire des autres. » (p. 76-77).
Disons tout de suite que, dans cette solution, M. Halbwachs trouve du même coup l’explication d’un fait d’un autre ordre : en rêve, il est remarquable qu’un souvenir ne revient jamais complet et réellement reconnu. Cela s’explique parce que « ce n’est pas dans la mémoire, c’est dans le rêve que l’esprit perd tout contact avec la société » (p. 97). L’évocation des souvenirs, on vient de le voir, repose sur la société ; or « le rêve ne repose que sur lui-même, alors que nos souvenirs s’appuient sur ceux de tous les autres, et sur les grands cadres de la mémoire de la société » (p. 97). Le rêve constitue ainsi, en conclusion, la contre-épreuve négative de la théorie de M. Halbwachs. « Si la psychologie purement individuelle cherche un domaine où la conscience se trouve réellement isolée et livrée à elle-même, c’est dans la vie nocturne, c’est là seulement qu’elle le trouvera. » (p. 97).
*
* *
Voyons si désormais les psychologues devront se résigner à cette maigre pitance que leur laisse la thèse de M. Halbwachs.
Mais auparavant, il convient de reprendre la question de plus loin, et d’examiner la nature et le mode de formation de ces « cadres » sans lesquels il n’y a pas de mémoire, et tout d’abord des deux cadres principaux, l’espace et le temps.
Nous n’avons pas besoin de rappeler qu’il y a lieu de distinguer entre l’espace et le temps abstraits et généraux, qui sont l’étoffe dans laquelle les mathématiques et la mécanique taillent leurs objets, et l’espace et le temps singuliers, c’est-à-dire les deux milieux uniques, effectifs, dans lesquels notre esprit situe les objets et les événements que son expérience lui donne réellement et concrètement.
Supposons pour commencer que l’espace et le temps généraux soient d’origine et de nature sociales. Cette concession ne donnerait pas encore gain de cause à M. Halbwachs, car c’est à des cadres singuliers que nos souvenirs doivent être accrochés. Les faits vécus jouissent de ce que la scolastique appelait l’haecceitas ; nous ne [p. 444] pourrions donc leur donner comme points de repère des universaux ; ce n’est pas sur un canevas général, mais sur son canevas singulier que la brodeuse peut fixer ses dessins. Dès lors, il devient moins évident, nous le montrerons tout à l’heure, que l’armature de nos souvenirs soit de nature sociale.
Et lorsque M. Halbwachs, avec raison croyons-nous, précise sa pensée et ajoute que l’armature de notre mémoire consiste encore dans des éléments déterminés et concrets, dans « un ensemble de faits, d’êtres et d’idées » comme « des personnes, des groupes, des lieux, des dates », « des repérages sur les cartes géographiques », il devient difficile de ne pas songer qu’il attribue à la société une tâche que celle-ci n’est pas apte à remplir.
En effet, si à la rigueur les cadres vides sont à tout le monde, les faits qui pour chacun de nous y constituent autant de points de repère sont-ils aussi « propriété publique » ? Cet espace que nous portons toujours en nous, l’avons-nous toujours exploré à plusieurs, et le temps que nous avons vécu, l’avons-nous toujours parcouru en compagnie ? Les choses que nous avons vues seuls, les événements que nul ne connaît que nous, et qui sont des points de repère tout aussi bien que les faits vécus en commun, ont-ils la plus petite part dans la constitution du schème qui sous-tend notre passé? La société peut- elle, de plus, nous suivre pas à pas, et modifier pour nous notre représentation de l’espace, à chacun de nos déplacements, ou notre notion du temps, à chaque heure qui s’écoule ? C’est moi qui dois me rappeler la disposition de mon appartement, la situation de mes meubles, le contenu de mes tiroirs, les relations des personnes que je connais. Ce n’est pas la société qui peut introduire en nous, et l’y adapter à chaque instant aux situations nouvelles, le système de ces connaissances latentes dont nous avons parlé, et qui équilibrent notre activité ; car ce ne sont pas des « cadres immobiles » (p. 77), nos points de repère ne sont pas soumis à un « ordre immuable » (p. 76) comme le dit M. Halbwachs.
Répondra-t-on que les choses et les événements qui forment comme les « nœuds » de ce système virtuel ne sont en nous que grâce à la société, dont proviennent toutes les catégories sans lesquelles il n’y aurait même pas d’« expérience » ? Mais alors nous rencontrons bien, comme nous l’annoncions, une théorie familière : la provenance [p. 445] sociale des formes de l’intelligence. Certes, sans les catégories de Réalité, de Nombre, de Cause, etc., nous ne pourrions ni fixer, ni rappeler nos souvenirs, ni même percevoir, — mais la question de l’origine et de la nature, individuelles ou sociales, de ces catégories reste entière.
D’autre part, pour prouver que le système du passé est porté par la société, il ne suffit pas d’en signaler le caractère de contrainte. Certes, ce système s’impose à nous. Il comporte une objectivité qui s’oppose au caprice individuel. Mais « objectif » est-il synonyme de « social » ? Notre foi dans des réalités, ou des vérités, n’est-elle qu’un conformisme qui s’ignore ?
Mais revenons aux cadres mêmes, et voyons si l’espace et le temps, singuliers, mais vides, sont, eux du moins, une armature portée par la société. Eh bien, là non plus, nous ne pouvons suivre M. Halbwachs. Pour s’orienter, il faut nécessairement posséder soit la notion de l’espace, soit une autre notion susceptible de remplir l’office de « classeur » de l’espace. Or, il est de fait que les animaux s’orientent. Nous ne parlons pas de l’orientation sur de grandes distances des animaux migrateurs, mais de cette orientation, identique à la nôtre, dont sont capables les animaux domestiques comme les animaux sauvages, qui savent très bien s’y retrouver dans les maisons, les cités, les champs ou les forêts où ils ont coutume de vivre. Il ne sert de rien de dire qu’il n’est pas nécessaire pour cela de leur supposer une représentation de l’espace, car qu’entend-on par espace, sinon le quelque chose, peu importe comment on l’appelle, qui nous permet de situer les objets, et de les retrouver ? Si l’on admet que pour retrouver des objets que nous avons connus mais que nous ne percevons plus, il est nécessaire que nous nous les représentions comme présents, mais « ailleurs », cette nécessité existe tout aussi bien pour les animaux. Si plusieurs notions différentes peuvent remplir également cet office, alors qui me prouve, à moi, que vous avez la notion de l’espace, plutôt que la notion de l’un de ses succédanés ? Les animaux se conduisent comme nous dans l’espace, il n’y a pas de raison pour leur refuser une notion de l’espace analogue à la nôtre.
Les animaux, nous le savons, n’ont pas une mémoire aussi riche, ni aussi cohérente que la nôtre. Il est probable que cela provient de [p. 446] ce qu’ils n’ont pas une notion assez précise du cadre « Temps ». Mais si l’on partait de là pour affirmer la nature sociale de la mémoire, ce serait supposer démontré ce qui est en question, car il reste possible que ce soit parce que les hommes disposent d’une plus grande intelligence que les animaux, et non parce qu’ils s’appuient sur la société, qu’ils réussissent à former une notion suffisamment précise du temps.
Ainsi donc, l’espace singulier n’est pas fourni par la société, et il n’est pas prouvé que le temps singulier le soit.
M. Halbwachs reportera-t-il alors sa thèse sur l’espace et le temps abstraits, et dira-t-il que la société nous fournit des modèles indéterminés et généraux, en sorte qu’il ne reste à chacun qu’à individuel ces modèles, à former, à leur image, un espace et un temps singuliers ?
Dans ce cas, nous n’avons pas besoin de le dire, la théorie sociologique de l’espace et du temps se trouverait en concurrence avec beaucoup d’autres théories. La question de l’origine des notions générales de l’espace et du temps est l’une de celles qui actuellement suscitent le plus de recherches, et la sociologie ne peut pas encore considérer la cause comme entendue.
Au fond donc de la théorie de M. Halbwachs, ce que nous trouvons, c’est un postulat : sans la société, l’individu n’aurait aucune des formes mentales humaines. Mais ce postulat ne peut manifestement être conservé comme un bloc, et force est bien de considérer que dans la mentalité humaine, il est une part nécessairement naturelle et individuelle, celle sans laquelle l’individu ne serait pas viable. Si un être, dont l’habitat se présente avec une certaine complexité, ne possède pas naturellement la faculté de tracer dans cet habitat les grandes lignes qui le rendront « connu » et utilisable, la société ne pourra pas le faire pour lui, car on ne peut tout de même pas assimiler l’aide que nous apporte la société à celle d’un garde-malade sans cesse présent qui guide tous les gestes de l’idiot qui lui est confié ! Les animaux supérieurs, nous l’avons vu, possèdent le cadre spatial. Peut-on alors affirmer que si, dans leur conduite, les hommes ne sont pas incohérents, hagards, et perdus comme dans un chaos, c’est grâce à la société ? Si, dans un milieu physique comme le nôtre, un être vit, c’est qu’il est individuellement viable, c’est-à-dire qu’il [p. 447] possède les organes physiques et psychiques nécessaires. Que la société nous guide, qu’elle active ou complète notre éducation mentale, nous ne songeons pas à le contester. Mais elle ne peut pas aller jusqu’à nous fournir notre intelligence comme un présent que nous recevrions entièrement du dehors, auquel nous n’aurions pas à apporter une contribution personnelle. Helen Keller, sourde et aveugle, avant qu’elle pût comprendre le langage des hommes et recevoir par là leurs formes mentales, avant même qu’elle eût compris qu’il y eût un langage, savait très bien se conduire sainement et intelligemment, s’orienter, se rappeler ses expériences passées. La mémoire, et l’intelligence, ne nous paraissent pas pouvoir être fournies par l’éducation.
*
* *
Et quant à la contre-épreuve du rêve, il ne nous paraît pas qu’elle établisse davantage la thèse sociologique. D’après M. Halbwachs, quand nous nous endormons, il se produit une coupure dans notre psychisme : le social tombe, l’individuel reste. A priori, cela semble déjà bien surprenant, car on ne voit pas pourquoi nous quittons ainsi la société. Le sommeil est un repos ; on peut donc être sûr que ce qui tombe, quand nous nous endormons, c’est quelque forme de notre activité, de notre énergie. Certes, communier avec la société est fatigant ; mais ce n’est là que l’une des modalités de notre activité de veille ; c’est celle-ci dans sa totalité qui cesse dans le sommeil ; la vie de veille consiste dans une incessante adaptation de nos pensées et de nos actions à la réalité effective. C’est la nécessité de celte adaptation qui explique la rétention de ces cadres latents, du « filet » équilibreur dont nous avons parlé. Et c’est parce que c’est nous-mêmes, avec notre propre énergie, qui tenons ainsi nos points de repère « sous pression », que nous éprouvons le besoin de nous détendre à la fin de la journée. Ce n’est pas la société qui peut tenir, à notre place, les rênes de notre conduite. Il ne suffit pas que les cadres existent hors de moi, dans l’esprit des autres ; il faut que je les maintienne sans cesse en moi pour pouvoir vivre ; c’est moi qui veille, et c’est moi qui me fatigue. On le comprendra mieux encore, quand nous ajouterons que ce n’est pas notre passé seulement que [p. 448] nous devons ainsi maintenir à l’état latent, mais aussi notre avenir : ce n’est pas la société, c’est nous qui devons sans cesse penser à ce que nous devons faire, aux courses, aux rendez-vous, aux tâches à accomplir. Et c’est parce que cette rétention générale épuise peu à peu notre énergie de veille, que le soir nous nous endormons.
La contre-épreuve proposée par M. Halbwachs serait plutôt propre, croyons-nous, à mettre en lumière tout ce qu’il y a d’essentiellement individuel dans notre pensée de veille. Le rêve, en effet, n’est pas du tout dépourvu de ces formes de pensée que M. Halbwachs présente comme sociales. Il est moins irrationnel qu’irréel. « Les faits rêvés ont toujours quelque sens et quelque cohérence ; c’est un « monde », illusoire, limité et imparfait sans doute, mais c’est un monde qui a son sens, et non un chaos. » (3) Le sens des mots, le genre et les propriétés des objets, les usages sont dans une large mesure conservés (nous expliquons pourquoi ils ne le sont pas totalement au § 84). Et même, tout au moins dans nos rêves, les phrases sont toujours parfaitement construites, la structure grammaticale en est impeccable (§ 151). Ce sont pourtant autant de choses apprises de la société. Comment pourraient-elles se retrouver dans le rêve, si la vie nocturne nous séparait de la société. C’est qu’à vrai dire ce qui manque, en rêve, ce ne sont pas les représentations sociales (le monde du rêve est tout aussi peuplé d’hommes que le monde de la veille), mais une certaine façon de voir et de tenir les représentations sociales, et, ajoutons-le, toutes les représentations.
Une chose tombe, en rêve : la systématisation des faits singuliers, le Tout concret, — une chose reste, du moins dans une large mesure : les connaissances générales. Dès lors, si la vie nocturne nous détachait de la société, ce sont les secondes connaissances, bien plus que les premières, qui devraient disparaître ; or, c’est le contraire qui a lieu : les rêves sont irréels, mais non irrationnels. La contre-épreuve proposée par M. Halbwachs ne réussit donc qu’à mieux faire voir que ce qui caractérise la veille, c’est une activité que seul l’individu est capable de fournir : la rétention énergique et implicite de tout ce que nous vivons, sans cesse systématisé, et sans cesse regroupé conformément à notre expérience toujours nouvelle. Cette rétention et [p. 449]cette perpétuelle mise au point produisent une graduelle usure de notre provision d’énergie, et c’est pour refaire celle-ci que nous dormons.
Car enfin, à supposer que le sommeil consiste dans une rupture du lien social, on ne voit pas la raison d’être de cette rupture. Pourquoi la société ne prolonge-t-elle passa tutelle jusque dans nos rêves ? De fait, on peut dormir en public, et veiller dans la solitude. Aussi est-il plus naturel de penser que le sommeil consiste dans un abandon de l’énergie de veille, dans un détachement de toute la réalité concrète, et non dans un abandon de la société.
Nous ne croyons pas non plus que la théorie du rêve de la psychoanalyse, adoptée semble-t-il en partie par M. Halbwachs, soit exacte. Nous ne pouvons admettre que ce soit dans ses rêves qu’un sujet révèle sa nature dans ce qu’elle a de plus intime et de plus original. Nous ne croyons même pas qu’il y ait des formes mentales propres aux rêves, une « logique du rêve ». Les rêves ne révèlent pas un « moi » stable, défini, reconnaissable. Notre vie onirique n’a pas une nature propre. Il n’y a pas un « moi nocturne » différent du moi diurne et caractérisé par des formes mentales, des tendances, des sentiments spécifiques. Nous ne pouvons songer à fournir ici les observations qui étayent cette opinion, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à notre ouvrage. Nous répondrons seulement à M. Halbwachs que, si l’on veut trouver le moi profond, la vraie personnalité d’un sujet, c’est dans la vie de veille qu’il faut la chercher, car que suis-je, moi, sinon le faisceau d’attitudes réelles, agissantes, selon lesquelles j’appréhende le monde et y réponds à ma manière ; c’est ce faisceau original, vivant et déterminant qui me définit réellement et me différencie de mes semblables — et non les combinaisons de pensées purement accidentelles, instables, se construisant, se transformant ou se détruisant sous l’effet d’un malaise insignifiant, d’une association contingente, de la moindre poussière d’élément psychique qui vient à traverser mon esprit. Il n’est pas nécessaire d’un complexus psychique bien profond pour faire apparaître ou métamorphoser un rêve, et, de même qu’une secousse légère substitue au dessin du kaléidoscope un autre dessin complètement différent, un élément imperceptible et tout à fait insignifiant est capable de produire sur le théâtre du rêve un changement de scène complet. [p. 450]
En conclusion, s’il faut reconnaître que la fixation et l’évocation des souvenirs ont lieu en veille grâce à l’auxiliaire du système constitué par l’espace, le temps, et les catégories de l’intelligence, il n’est pas encore démontré que cet auxiliaire, et avec lui la mémoire, soient de nature sociale. Ce qui semble demeurer de la discussion, c’est l’indispensabilité de l’intelligence, car l’espace et le temps, tels qu’ils doivent être maintenus pour pouvoir efficacement encadrer nos souvenirs, semblent bien être, eux aussi, une systématisation intellectuelle. Et il est trop clair que le jour où il sera établi que notre intelligence est chose sociale, ce n’est pas seulement la mémoire qu’on aura incorporée à la sociologie, mais la psychologie tout entière, car l’esprit, dans toutes ses fonctions, est d’abord intelligence.
ALBERT KAPLOUN.
NOTES
- Voir Revue philosophique, janv.-fév. 1923, p. 57 et suiv.
- Psychologie générale tirée de l’étude du rêve, Payot, 1919, § 56.
- A. Kaploun, op. cit., § 38. Voir aussi § 87.

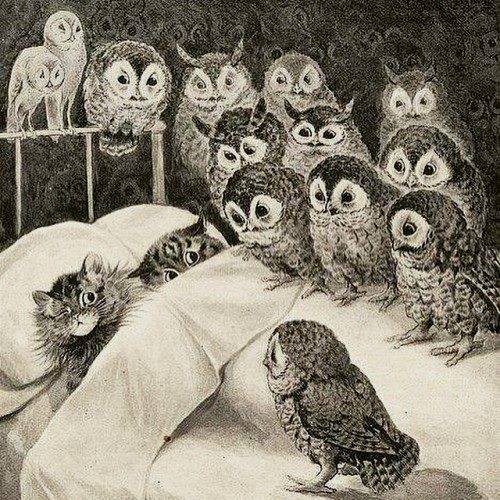
LAISSER UN COMMENTAIRE